 Yves Delage. Le rêve dans la littérature moderne. Extrait de la « Revue philosophique de la France et de l’Étranger », (Paris), quarante et unième année, tome LXXXI, janvier à juin 1916, pp. 209-274.
Yves Delage. Le rêve dans la littérature moderne. Extrait de la « Revue philosophique de la France et de l’Étranger », (Paris), quarante et unième année, tome LXXXI, janvier à juin 1916, pp. 209-274.
Yves Delage (1854-1920). Zoologiste reconnu, polémiste, créateur de la revue « L’Année biologique » en 1895, il est nommé membre de l’Académie des sciences en 1901. Il s’intéresse de très près à la psychanalyse et surtout au rêve sur lequel il publie de nombreux articles, dont celui que nous mettons ici en ligne, qui sea repris dans son l’ouvrage parut l’année de sa disparition : Le rêve. Etude psychologique, philosophique et littéraire. Paris, Presses Universitaires de France, s. d. [1919]. 1 vol. in-8°, XV + 696 p. En outre il publia cette critique de la psychanalyse ainsi que deux autres articles sur le rêve :
— La nature des images hypnagogiques et le rôle des lueurs entoptiques dans le rêve. Article paru dans la revue « Bulletin de l’Institut Général Psychologique », (Paris), 6e année, n°1, janvier-mars 1905, pp. 235-257. [en ligne sur notre site]
— Sur les images hypnagogiques et les rêves. « Bulletin de l’Institut Général Psychologique », (Paris), 6e année, n°1, janvier-mars 1905, pp. 114-122. [en ligne sur notre site]
— Psychologie du rêveur. “Bulletin de l’Institut Général Psychologique”, (Pais), 13e année, n°4, juillet-octobre 1913, pp. 195-206. [en ligne sur notre site]
— Portée philosophique et valeur utilitaire du rêve. Extrait de la « Revue philosophique de la France et de l’étranger », (Paris), 1, 1916, pp. 1-23. [en ligne sur notre site]
— Le rêve dans la littérature moderne. « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger« , (Paris), 1916.
— Une psychose nouvelle : la psychanalyse. « « Mercure de France », (Paris), vingt-septième année, n°437 ; tome CXVII, 1er septembre 1916, pp. 27-41. [en ligne sur notre site]
— La conscience psychique. A propos d’un livre récent de M. Kaploun. Article paru dans le « Bulletin de l’Institut Général Psychologique », (Paris), n° 4-6, 1919, pp. 163-187. [en ligne sur notre site]
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr
[p. 209]
Le Rêve dans la littérature moderne (1)
Pourquoi ce titre ? Pourquoi cette intrusion de la littérature dans une question de psychologie où elle semble n’avoir que faire ? On peut répondre que l’étude du rêve est toute d’observation et que les romanciers, j’entends les meilleurs d’entre eux, sont des observateurs de pensées. Tel le botaniste au milieu de ses plantes, le romancier observe, trie, assemble, collige des pensées humaines, analyse et synthétise, recherche et décrit les variétés rares, belles ou horribles, et cherche les moyens de frapper l’imagination sans s’écarter de la vérité ; et de cette étude peuvent se dégager quelquefois des idées générales qu’ont vainement cherchées les philosophes de métier avec leurs méthodes plus rigides. La chose n’est pas sans exemple. C’est ainsi que l’on trouve dans la littérature plus de renseignements utiles sur les rêves de double que dans les ouvrages spéciaux. Cependant ce n’est là qu’un fait rare, exceptionnel.
Mais le titre de ce chapitre se justifie d’un autre point de vue.
Si les romanciers peuvent rendre quelques services à la science du rêve, bien plus grands sont les services que le rêve peut rendre à leur art. Je ne crains pas de dire que le rêve est un des plus puissants moyens que les romanciers puissent mettre en action. L’usage qu’ils en font est restreint, presque infime, et c’est un juste sujet d’étonnement pour celui qui se rend compte que le rêve emplit une fraction importante de notre vie psychique, qu’il exerce une influence considérable sur notre vie éveillée et pourrait en manifester une bien plus grande encore si l’on savait en tirer parti. [p. 210]
Non seulement les romanciers ont peu usé du rêve, mais l’usage qu’ils en ont fait est loin d’être bon. Quelques-uns, et parmi les plus justement réputés, Balzac entre autres, ont accueilli sans discernement les préjugés les plus absurdes, les idées toutes faites reposant sur la superstition la plus grossière. On y trouve le rêve divinatoire sous sa forme la moins raffinée, tel qu’il pourrait trouver place dans les narrations essoufflées de Madame Pipelet.
Mais les défauts les plus répandus sont ceux qui consistent, soit à donner aux rêves les caractères d’un drame savamment agencé, impeccable dans la composition des tableaux et l’arrangement des scènes, soit au contraire de ne leur laisser rien qui ne soit saugrenu et incohérent. Sous le prétexte que le rêve est l’expression de la fantaisie la plus déréglée, on croit bien faire en supprimant toute règle, sans s’apercevoir que cette suppression même introduit une règle en devenant systématique .
Ces critiques demanderaient à être développées ; elles le seront plus à propos en présence des exemples qui les justifient, à l’occasion des rêves que nous allons rappeler en parcourant les œuvres des auteurs.
Nous allons donc feuilleter à nouveau les volumes de notre bibliothèque pour y retrouver les rêves qui ont pu passer inaperçus quand nous les avons lus jadis sans attacher notre attention à ce qui nous occupe aujourd’hui. Nous avons relu la plume à la main les principaux romans modernes en notant au passage les rêves épars çà et là. C’est le résultat de cette recherche qu’on trouvera ci- dessous. Est-il utile de dire que nous n’avons pas prétendu faire une étude complète d’une question aussi vaste. Cela nous eût entraîné beaucoup trop loin et nous eût conduit à des redites.
Nous avons laissé de côté toute la littérature des siècles passés, ainsi que les récits d’histoire. Ce n’est pas que le rêve y fasse défaut, mais parce qu’il y manque de toute valeur objective. Les rêves historiques seraient du plus haut intérêt si l’on pouvait leur accorder confiance, mais ils ont toute chance d’avoir été défigurés par les narrations successives, si tant est qu’il y ait rien de positif à leur base. Tous ces rêves, aussi bien ceux que nous rapporte l’Histoire que ceux de la littérature ancienne, ont le caractère prophétique, prémonitoire, divinatoire ou, si l’on pouvait dire ainsi, [p. 211] révélatoireet impératoire :c’est toujours une suggestion divine ou démoniaque se manifestant par l’intermédiaire du rêve et destinée à influencer nos actions ou l’ordre de nos pensées pendant la vie réelle.
Ce même caractère se retrouve dans la plupart des rêves de la littérature des siècles passés ; le XVIIe siècle en a fait un grand usage, au point que le songe est presque une partie nécessaire dans les grandes tragédies. Une préoccupation littéraire d’ordre purement esthétique, jointe à la crédulité la plus naïve et à une habitude invétérée de considérer le rêve sous ce seul aspect, sont les éléments principaux de cette conception. La psychologie n’a rien d’intéressant à glaner de ce côté ; aussi avons-nous négligé de propos délibéré les auteurs remontant à plus d’un siècle, ne retenant, et simplement à titre d’exemple, que Shakespeare.
Nous aurions aimé, pour mettre quelque méthode dans cet exposé, classer les auteurs par catégories, mettant ensemble ceux, bien rares, qui se sont conformés aux lois du rêve, ensemble ceux qui les ont méconnues de telle ou telle façon. Cela nous a été impossible parce qu’il n’y a aucune homogénéité sous ce rapport entre les diverses œuvres d’un même auteur. Ici, un éclair d’intuition, une observation bien faite ou le simple hasard lui a fait rencontrer la vérité ; mais dans le prochain rêve toutes les règles sont foulées aux pieds.
A défaut des auteurs dans l’ensemble de leurs œuvres, j’aurais désiré répartir par catégories les rêves considérés isolément. Cela même eût été difficile, parce que dans un même rêve on rencontre souvent diverses fautes à côté de parties irréprochables ; mais surtout l’exposé y aurait pris un caractère de monotonie fastidieuse et d’impersonnalité qui lui eût ôté toute saveur. J’ai trouvé plus intéressant de faire le procès des hommes, ou plutôt de leur manière, que celui des choses. En outre, le rapprochement et la comparaison des cas où l’auteur a touché juste avec ceux où il a versé dans telle ou telle erreur, rendra plus claire notre critique et la compréhension de ce que nous considérons comme la forme vraie du rêve.
Pour toutes ces raisons, sans nous illusionner sur les inconvénients de cette manière de faire, mais la considérant comme la moins mauvaise, nous nous sommes déterminés à présenter les [p. 212] auteurs les uns après les autres en ne tenant compte que vaguement de l’ordre chronologique et commençant par les plus anciens et les plus simples pour finir par les plus modernes et les plus compliqués.
SHAKESPEARE.
Shakespeare n’appartient pas à la période moderne à laquelle nous avons réduit le rapide examen du rêve dans la littérature. Cependant, il nous a paru curieux de faire une exception pour lui en raison de l’ampleur et de l’originalité de son génie et du caractère même de ce génie où, à, chaque page, le réalisme le plus terre à terre coudoie l’imagination la plus libre. Nous espérions des découvertes intéressantes ; grande a été notre désillusion. Il y a bon nombre de rêves dans Shakespeare, beaucoup d’entre eux tiennent en dux lignes et ne présentent pas d’autre intérêt que celui d’un trait dans la conversation. Quelques-uns occupent une place plus importante et nous permettent de juger du rôle que l’auteur croit pouvoir donner au rêve dans la tragédie. Tous sont des rêves prophétiques, symboliques, où des visions très outrées et totalement fantaisistes sont amenées pour produire un effet déterminé ou accentuer un effet déjà produit. Leur nature, leur forme ont toute leur raison d’être dans le but à atteindre et nullement dans la réalité des choses ou dans la vraisemblance, si ce n’est dans cette fausse vraisemblance qu’une conception artistique particulière permettait alors d’attribuer au rêve.
Voici quelques exemples des rêves sur lesquels s’appuie ce jugement,
Dans Jules César, pour justifier ses appréhensions, le dictateur rapporte un rêve de Calphurnia : « Mon épouse a rêvé cette nuit qu’elle voyait ma statue qui, pareille à une fontaine à cent conduits, laissait couler un sang pur et que de vigoureux Romains en grand nombre venaient en souriant et baignaient leurs mains dans ce sang ; elle regarde ces images comme des avertissements, des présages et des menaces de malheurs et elle m’a supplié à genoux de rester au logis aujourd’hui. »
A quoi Décius répond que ce songe a été mal interprété, que c’est au contraire une heureuse vision signifiant que : « par César, Rome aspirera un sang revivifiant ». [p. 213]
Dans le cinquième acte, Brutus voit en songe le spectre de César, lui ordonnant de le rejoindre dans les plaines de Philippes.
Dans Richard III, Clarence, avant d’être noyé dans son tonneau de Malvoisie, raconte qu’il a rêvé s’être évadé de la Tour, s’être embarqué pour passer en Bourgogne et qu’en chemin il est tombé à l’eau et s’est noyé : « Oh, Dieu ! quelle souffrance ! » Au fond de la mer, il a une vision de cadavres hideux. Puis son rêve se prolonge par delà la mort ; il voit ses parents qui l’attendent dans les Enfers.
DansRoméo et Juliette, Roméo déclare à Mercutio qu’il a eu un rêve ; et Mercutio dit que c’est la reine Mab qui procure les rêves. « Elle galope dans les cervelles des amants qui rêvent d’amour, sur les genoux des courtisans qui rêvent de révérences, sur les doigts des hommes de loi qui rêvent d’honoraires, sur les lèvres des dames qui rêvent de baisers… sur le nez du courtisan… qui flaire une promotion… »
Plus loin, Roméo rêve encore : « Mes rêves me présagent quelque joyeux événement… J’ai rêvé que ma dame venait et me trouvait mort (étrange rêve que celui qui permet à un mort de savoir qu’im l’est) et qu’elle a insufflé par ses baisers une telle vie à travers mes lèvres que je revivais et que j’étais empereur. »
Dans Antoine et Cléopâtre, celle-ci raconte qu’elle a vu Antoine empereur : « Sa face était comme les cieux .. Ses jambes enfourchaient l’Océan comme une monture ; son bras levé touchait le front du monde et le coiffait du casque ; sa voix… harmonieuse comme la musique des sphères, ou terrible… comme le fracas du tonnerre. Quant à sa générosité, elle ne connaissait pas la saison d’hiver ; c’était un perpétuel automne, toujours plus fertile à mesure qu’il était plus moissonné. »
Parmi tous ces rêves fantaisistes, voilà le plus typique. Il donne une excellente idée de la façon dont les auteurs de cette époque se croyaient le droit, d’accumuler dans le rêve toutes les fictions nécessaires à leur thème. Il n’y a rien de vrai ni même de possible dans un rêve de ce genre.
Dans Othello, Iago, pour exciter la jalousie de ce dernier, lui raconte un rêve qu’il aurait fait : « J’étais couché avec Cassio. Je l’entendis qui disait en dormant : « charmante Desdémone, soyons prudents, cachons nos amours… » puis il m’a embrassé. » Mais, [p. 214] ajoute perfidement Iago, ce n’était qu’un rêve. — Oui, répond Othello, mais qui dénotait une chose précédemment accomplie ; c’est un indice singulièrement probant quoique ce ne soit qu’un rêve.»
De tous les rêves qu’on trouve dans Shakespeare, celui-là seul offre un caractère de vérité. Cassio peut avoir rêvé cela ; s’il ne l’a pas fait et si Iago l’a inventé, ce dernier a plus d’esprit dans son petit doigt que Cléopâtre dans toute sa personne.
BALZAC.
Dès longtemps je connaissais l’œuvre de Balzac ; mais, ne l’ayant jamais examinée de ce point de vue, j’ai voulu la parcourir à nouveau, pour y noter les rêves que je ne manquerais pas d’y rencontrer. A ma grande surprise, je n’ai trouvé dans son œuvre si touffue qu’un seul rêve, celui d’Ursule Mirouët.Balzac a ignoré les immenses ressources littéraires que fournit le rêve, parce que malheureusement pour lui il n’est pas un rêveur. On ne saurait l’en rendre responsable, mais on peut reprocher à l’observateur subtil, au penseur profond, de ne pas s’être donné la peine de l’étudier chez les autres. Cela lui eût évité de le faire intervenir dans son œuvre d’une façon si terriblement médiocre.
Je puis supposer que tout le monde se rappelle Ursule Mirouët.Donc, Ursule à été dépouillée par Minoret de l’héritage de son oncle et elle ne sait absolument rien de ce qui s’est passé, ni surtout de lafaçon dont cela s’est passé. Or, son oncle lui apparaît en songe, lui fait lire son testament et la conduit par la main dans la petite chambre où il lui montre le voleur en train de le brûler au moyen d’allumettes dont deux, n’ayant pas pris feu, restent non consumées au fond du foyer. Ursule voit tout cela et, en racontant son rêve au réveil, décrit dans ses moindres détails cette chambre où elle n’est jamais allée et mentionne la présence des deux allumettes non consumées qui serviront plus tard de Deus ex machinapour confondre le traître.
Ainsi Balzac fait apparaître dans le rêve des personnes qui apprennent au dormeur des choses qu’il n’a jamais sues et qui n’étaient pas même à l’état latent dans sa conscience. Pour expliquer un si singulier phénomène, il fait dire au curé Chaperon [p. 215] que les pensées peuvent errer dans l’air et à certaines occasions s’incorporer aux fantômes d’une vision de rêve pour reprendre vie un instant par sa bouche ; c’est aussi absurde et à peine plus raffiné que les plus grossières superstitions des gens sans culture.
ZOLA.
Plus d’une fois le rapprochement a été fait entre Balzac et Zola ; et c’est un peu pour cela que nous parlons de celui-ci à la suite de celui-là. Le point de vue où nous nous plaçons dans ce livre fait apparaître une nouvelle ressemblance que sans doute l’on n’avait point remarquée. Pas plus que Balzac, Zola n’est un rêveur, et dans son œuvre qui ne le cède guère en étendue à celle de son ainé, on ne trouve de même qu’un seul rêve : c’est dans Thérèse Raquin. Ici le rêve est mis en œuvre pour concourir à accentuer une impression qui est celle du remords. Tout bref qu’il est, il nous est précieux, parce qu’il vient à l’appui de notre théorie de la résurgence des idées refoulées. Cela n’est pas sans intérêt, venant d’un observateur aussi exact et fidèle que Zola.
L’amant assassin voit sans cesse se représenter à lui le cadavre du mari noyé et repousse cette horrible vision. Un soir il s’endort après avoir poursuivi dans une longue rêverie l’image de sa maîtresse lui ouvrant sa porte en costume de nuit et le recevant dans ses bras. Or, ce qui revient dans son rêve, ce n’est pas cette image caressée : il se voit courant chez sa maîtresse, abordant sa maison, montant l’escalier, frappant à sa porte. La porte s’ouvre et derrière elle, que voit-il ? Encore et toujours le cadavre affreux du mari noyé.
Cela est frappant de vérité ; peut-être cependant n’y-a-t-il là qu’une coïncidence et Zola n’a-t-il cherché qu’un effet sans se préoccuper de vraisemblance et de conformité avec quelque loi du rêve qu’il aurait entrevue.
VICTOR HUGO.
Nous avons rapidement esquissé, sans aucunement entrer dans le détail, le rôle que jouent les songes dans la tragédie classique. Quel va être celui du rêve dans le drame romantique ? [p. 216]
Pas plus dans le vénérable V. Hugo que dans le moderne Rostand, il n’y a trace de rêve ; il n’y a pas modification, évolution, mais disparition .
Dans toute l’œuvre poétique d’Hugo, on ne trouve point de vrais rêves, car il ne faut pas compter comme tels certaines visions de l’esprit auxquelles la forme du rêve n’est donnée que pour la commodité littéraire et qui n’ont nullement la prétention d’être des choses vraiment rêvées. Dans les morceaux de cette catégorie, nous ferons pourtant une exception en raison de son importance pour le Pape où un rêve à lui seul forme tout un volume.
En deux mots, voici le thème : le Souverain Pontife se voit en songe rejetant avec mépris sa tiare et ses oripeaux somptueux ; il part vêtu de bure, un bâton à la main et parcourt le monde prêchant partout le mépris des richesses et de la fausse grandeur des princes de l’Église et des rois, condamnant la violence et l’abus de la force, enseignant partout le pardon, la pitié, l’amour des faibles et des humbles. Puis il se réveille et s’écrie : « Quel rêve affreux je viens de faire ! » •
Il est de toute évidence qu’il ne faut pas chercher dans celle composition magistrale une application précise d’une théorie de l’auteur sur le rêve. Cependant on y trouve une idée tout intuitive et qui ne manque pas de justesse ; elle est exprimée dans ces deux vers :
La vie est une page obscurément pliée
Que l’homme en mourant lit et déchiffre en dormant.
C’est l’idée exprimée aussi par Nodier que l’âme est pendant le sommeil plus clairvoyante que pendant la veille parce qu’elle est délivrée des liens que lui imposent les préoccupations de la vie réelle. Nous avons vu, et verrons, dans quelle mesure et par quelles raisons se justifie cette notion des rêves à demi prophétiques.
Dans l’œuvre en prose, au contraire, on trouve quelques vrais rêves tout à fait significatifs.
Les Misérables. — Nous avons la bonne fortune que Hugo ait lui-même exprimé son opinion sur le sujet qui nous occupe : ‘Ce rêve, comme la plupart des rêves, ne se rapportait à la situation que par je ne sais quoi de funeste et de poignant. » Ce qui veut dire que l’émotion de la condition actuelle se transporte dans le [p ; 217] rêve, mais non le sujet qui la provoque ; et cela est parfaitement observé.
M. Madeleine touche au but : il a presque effacé Jean Valjean, quand un jour Javert vient lui apprendre que ses soupçons sur l’identité de Jean Valjean et de M. Madeleine n’étaient pas justifiés, car le vrai Jean Valjean vient d’être retrouvé, convaincu, et sous peu sans doute sera renvoyé au bagne, sinon guillotiné. M. Madeleine laissera-t-il accomplir cette injustice ou va-t-il se livrer et renoncer à tout ce qu’il avait conquis de fortune, de bonheur et de considération ? C’est la fameuse tempête sous un crâne. Obsédé par ces idées poignantes, il s’endort et fait un rêve qui n’a en effet aucun rapport matériel avec les idées qui l’obsèdent et ne leur emprunte que leur couleur sombre. Il erre dans la campagne ; tout, autour de lui, est gris, couleur de terre. Il entre dans une ville ; la ville est déserte ; les seuls êtres humains qu’il rencontre sont debout, immobiles et ne répondent pas à ses questions. Mais quand il quille la ville, tous sortent sur ses pas, l’entourent et lui apprennent qu’il est chez les morts. A noter, dans cette sorte de drame muet, une de ces absurdités qui se rencontrent dans tous les rêves et sont une de leurs marques les plus caractéristiques : dans une, rue de cette ville il a froid et voyant qu’une fenêtre d’une maison voisine est ouverte, il se dit : « C’est par cette fenêtre ouverte que me vient le froid. » L’origine de cette impression est dans une sensation réelle, car en se réveillant, il est glacé. Tout cela est marqué au coin de l’observation la plus réaliste, ce qui est bien remarquable dans une œuvre où le souci de la vérité du détail a tout droit de s’effacer derrière la préoccupation des idées générales que l’auteur veut mettre en relief.
Ces idées sur la nature du rêve avaient dû germer depuis longtemps dans l’esprit de Hugo ; on en trouve en effet dans ses œuvres antérieures des traces plus ou moins marquées ; mais il ne les avait pas encore formulées ; aussi les trouve-t-on hésitantes et contradictoires dans leur explication. Cela apparaît nettement dans le seul de ses romans dont il nous reste à parler.
Le Dernier Jour d’un condamné. — Dans cette œuvre de jeunesse du grand écrivain, deux rêves s’inspirent de conceptions contradictoires. Le condamné n’a d’autre idée que celle de son supplice ; son âme est « aussi emprisonnée dans cette idée que son corps [p. 218] dans sa geôle ». Il la rappelle, la retient, la retourne sous toutes ses faces, vit avec elle d’une façon incessante. C’est donc la condition même qui doit l’écarter de ses rêves. S’il vient à rêver, ce doit être de tout autre chose. C’est ce qui arrive en effet dans le deuxième et le plus important des rêves qu’il fait, rêve qui ne précède que de quelques heures le moment fatal. Ce rêve est assez insignifiant, un peu effrayant, mais emprunte le sentiment émotif à des visions absolument étrangères à celles qui le préoccupent à l’état de veille. Des bruits lui font croire que des brigands cherchent à forcer des portes ; il s’arme et fait une ronde et découvre seulement une vieille femme inerte à la manière d’une momie.
On le voit, ce rêve relève du même principe que celui des Misérables.
Au contraire, dans le premier rêve, évoqué par la nature des noms inscrits sur les murs de son cabanon par les condamnés à mort qui l’ont occupé avant lui, il voit des suppliciés portant leur tête dans leurs mains. C’est donc le sujet même de la préoccupation qui vient former la trame du rêve ; c’est une forme moins typique, plus exceptionnelle, mais nullement inadmissible ainsi que nous l’avons expliqué en exposant notre théorie.
FLAUBERT.
Nous ne parlerons pas de la Tentation de saint Antoine. Parmi les œuvres appartenant à cette catégorie, nous avons, fait une exception pour Le Pape de V. Hugo ; il n’y a pas lieu de la renouveler. La forme donnée à cette conception n’est qu’un prétexte pour présenter des scènes, ici historiques, en leur donnant le relief de tableaux actuels se déroulant sous les yeux du spectateur. D’ailleurs les visions de l’anachorète tiennent moins du rêve que de l’hallucination.
L’Éducation sentimentale. — Il n’en n’est pas de même pour le très court rêve raconté dans l’Éducation sentimentale, le seul d’ailleurs qui se rencontre dans toute l’œuvre de l’auteur, car nous ne croyons pas devoir retenir le rêve très court et sans prétention qu’il prête au mari de l’héroïne dans Madame Bovary.
Celui-là est si vrai, si strictement conforme à la vraisemblance qu’on pourrait le prendre pour exemple d’une catégorie classée, celle du type dit de « Maury guillotiné ». [p. 219]
« Elle avait rêvé, la nuit précédente, qu’elle était sur le trottoir de la rue Tronchet depuis longtemps. Elle y attendait quelque chose d’indéterminé, de considérable néanmoins, et, sans savoir pourquoi, elle avait peur d’être aperçue. Mais un maudit petit chien acharné contre elle, mordillait le bas de sa robe. Il revenait obstinément et aboyait toujours plus fort. Madame Arnoux se réveilla. L’aboiement du chien continuait. Elle tendit l’oreille. Cela partait de la chambre de son fils. Elle s’y précipita pieds nus. C’était l’enfant lui-même qui toussait. Il avait les mains brûlantes, la face rouge et la voix singulièrement rauque. L’embarras de sa respiration augmentait de minute en minute. Elle resta jusqu’au jour, penchée sur sa couverture, à l’observer. »
Tout s’explique dans ce rêve et de la meilleure façon. La rue Tronchet : c’est là que son amant lui avait donné rendez-vous, idée qu’elle acceptait et repoussait à la fois ; c’est là qu’il devait l’attendre et elle transportait cette attente de lui à elle. Le petit chien aboyant, c’était l’interprétation donnée par sa conscience assoupie à la toux de son enfant, vaguement entendue et interprétée en accord avec la situation créée par son rêve. Mais, si l’interprétation était faussée, le sentiment d’angoisse vaguement perçue que cette toux faisait naître dans son esprit et qui se confondait avec l’angoisse résultant de son attente dans la rue, tout ce cachet émotif se transportait dans son rêve avec son caractère vrai.
Ceux qui admettent que dans le rêve de Maury guillotiné, c’est la chute du ciel de lit sur le cou du dormeur qui a provoqué les tableaux de son rêve précédant l’exécution, croiront que c’est la toux de l’enfant qui a provoqué non seulement l’image auditive des aboiements du chien, mais aussi son acharnement après ses jupes et sa présence même au coin de la rue Tronchet, dans une condition où l’attaque du petit chien pût se réaliser et déterminer son angoisse. Combien l’explication que nous avons présentée ci-dessus est plus naturelle. Si ce rêve était vrai, j’aimerais à le citer comme argument contre la théorie de Maury.
GUY DE MAUPASSANT.
Les rêves se rencontrent fréquemment dans l’œuvre de Maupassant. Tous portent la marque de ce talent d’observation fine et [p. 220] pénétrante qui caractérise l’auteur. Mais certains n’ont que peu d’intérêt pour nous parce qu’ils ne présentent aucun trait remarquable et que l’auteur n’y pose pas la question des causes évocatrices. Tels sont les vulgaires cauchemars du fou dans La Horla,tel est aussi celui décrit dans La Nuit, A signaler cependant dans ce dernier l’absence un peu exagérée de toute trace de la soudure entre la veille et le rêve.
A noter aussi dans Sur les Chats, l’évocation d’un rêve érotique par le contact de la fourrure d’un chat que le rêveur transforme en la caresse d’une femme nue.
Dans Magnétisme au contraire, est décrit un rêve des plus intéressants pour nous, précisément parce qu’il offre tout ce qui manque aux précédents : l’étrangeté et l’essai d’explication.
Le sceptique qui conte le rêve a d’abord à sa table de travail une hallucination (Ne serait-ce pas une vision hypnagogique méconnue ?) Une femme lui apparaît entièrement nue. Cette vision le surprend d’autant plus que cette femme, il la connaît bien et la considère comme indigne de tout intérêt. Vingt fois, il l’a vue sans songer à arrêter sur elle son regard. Il se couche et, en rêve, dans trois songes différents séparés par de courts réveils, il la revoit, mais cette fois dans ses bras et il la possède tout entière. Le lendemain, encore sous l’émotion de ce rêve si intense il va chez cette femme, la trouve seule ; elle tombe dans ses bras et devient sa maîtresse.
Quelle explication donner de ce rêve prophétique : magnétisme, dit l’auteur, influence secrète de quelque force surnaturelle. Et c’est bien, au fond, l’idée de Maupassant, car la croyance au magnétisme et aux forces secrètes circule dans toute son œuvre. Mais il soupçonne une interprétation physiologique et la met dans la bouche de son rêveur sceptique : « C’est peut-être un regard d’elle que je n’avais point remarqué et qui m’est revenu ce soir-là par un de ces mystérieux et inconscients rappels de la mémoire qui nous représentent souvent des choses négligées par notre conscience, passées inaperçues devant notre intelligence. »
Eh bien, oui, c’est cela, et Maupassant eût calqué sa conception sur la théorie que j’ai publiée en 1889 qu’il n’aurait pas dit autrement. Cette théorie nous permet de préciser son explication.
Assurément, cette femme a lancé à cet homme un de ces coups [p. 221] d’œil éloquents où une femme se donne. Peine perdue, l’homme l’a à peine remarqué et a relégué cela au rang des choses indignes de retenir l’attention parce que cette femme ne lui inspire aucun intérêt. Mais l’impression se réveille pendant le sommeil et devient le primum movens de la scène rêvée. Et ce qui est à remarquer, et c’est pour cela que nous avons insisté davantage sur ce cas, c’est que le rêve est devenu la cause déterminante d’actes de la vie réelle de haute importance ; car c’est bien la scène du rêve et non l’impression première initiatrice de cette scène qui a poussé le rêveur à se rendre chez cette femme et à en faire sa maîtresse. C’est là un bel exemple de ce phénomène sur lequel nous avons attiré l’attention dans un autre chapitre : de l’influence des rêves sur nos actes de la vie réelle.
De tous les rêves dont nous parlons dans ce chapitre, il n’en est peut-être pas un qui soit plus conforme aux règles vraies du rêve et en montre une meilleure application.
DansRéveil, Maupassant donne un autre exemple d’un rêve de la même catégorie.
Ch. NODIER.
La neuvaine de la Chandeleur. — Dans ce petit conte, Nodier fait appel à une singulière source de rêve : les pensées qui sont envoyées au rêveur par l’intervention de la divinité ou de ses comparses, la Vierge et les Saints. Il eût mieux fait de s’en tenir aux libres données de la seule imagination !
Maxime est un adolescent très pur, idéaliste et sentimental, très dévot en outre comme tous les personnages de ce conte.
On sait qu’à la Chandeleur (du moins en était-il ainsi au dire des bonnes gens vers le commencement du siècle dernier dans la vieille province de Franche-Comté) si l’on a su par sa dévotion et l’ardeur de ses prières attirer sur soi la grâce de la Vierge Marie, on a chance de se trouver en tête à tête avec la personne que l’on aimera et de qui l’on sera aimé, dans un repas mystique de fiançailles dont un morceau de pain bénit et un rameau de myrte font tous les frais. C’est ce qui arrive à Maxime qui s’installe à la table préparée selon le rite et s’endort ; et bientôt, en un rêve lui apparaît la fiancée dont les traits se gravent dans son cœur d’une façon ineffaçable. Un an après, il rencontre celle qui occupait toutes ses pensées. Il l’aurait épousée si la rupture d’un anévrisme ne venait clore son idylle le soir même de la première entrevue.
Voilà le rêve prémonitoire dans toute sa naïveté. L’auteur s’applique à écarter toute possibilité d’explication naturelle : le jeune homme n’a jamais pu voir la jeune fille, qui a vécu à l’étranger et n’est revenue au pays natal que plusieurs mois après cette Chandeleur. Pas de coïncidence admissible en raison de la précision et de la multiplicité des détails et surtout du fait que la jeune fille a, elle aussi, vu en rêve les traits de son fiancé. Ce n’est pas même un rêve naturel avec ses mystères possibles, c’est le miracle religieux dans toute sa niaiserie. Et dire qu’il eût suffi d’en faire un conte de fées, c’est-à-dire une œuvre de libre imagination, pour lui ôter cette prétention à la réalité et en faire, grâce à la perfection inimitable du style et à la douceur des pensées, une œuvre charmante échappant à toute critique.
Tel qu’il est, hélas ! il prend place à côté du rêve d’Eugénie Grandet, de Balzac.
Mais nulle part ailleurs dans son œuvre, Nodier ne mérite ce reproche ; partout l’imagination et la libre fantaisie sont les seules sources auxquelles il emprunte les données de ses contes.
Le Pays des rêves. — Pour Nodier, le rêve n’est pas un pâle reflet, trouble et incohérent, des pensées de l’état de veille, il représente une vie plus indépendante, plus intense que l’autre. Pendant la veille, la pensée a les ailes ligotées par les innombrables liens des préoccupations matérielles, tandis que dans le sommeil, le corps se laisse oublier et rend à l’essor de l’imagination toute son ampleur. A la froide clarté de la raison il oppose les fulgurants feux de Bengale de l’imagination créatrice.
Quant à l’origine du rêve, il n’en dit rien, mais il nous fournit un argument admirable en faveur de notre théorie en affirmant l’absolue authenticité d’un cas qu’il rapporte dans cet ouvrage et qui prend ainsi une valeur documentaire.
Un jeune Italien, obligé de fuir avec sa fiancée, erre dans une forêt loin de tout secours, et bientôt la faim se fait sentir, de jour en jour plus pressante. Au moment où leurs forces les trahissent et où ils sont près de périr, sa fiancée meurt et lui dit de se repaître de sa chair pour ne pas perdre la vie. Il se sent prêt à succomber [p. 223] l’horrible tentation, mais arrive à la repousser. De ce jour, et durant des années, un rêve, toujours le même, vient hanter ses nuits ; il se voit transformé en vampire et, si forte est la vision hallucinatoire, qu’il craint de la réaliser dans ses actes et refuse à un compagnon d’aventure de passer la nuit dans la même chambre que lui, à moins qu’on ne l’attache sur son lit.
Smarra.— Ce rêve du vampire a donc une valeur documentaire puisqu’il est vrai. Il n’en est pas de même de celui de Smarra, car ce dernier est, de toute évidence, et l’auteur ne s’en défend pas, une œuvre de pure imagination. Dans ces conditions, Smarra ne saurait avoir d’autre intérêt que d’illustrer la conception que son auteur se fait des lois du rêve. Cette conception est d’une belle simplicité : le rêve étant le produit de l’imagination libérée de toute entrave ne saurait avoir de règles, car ces règles seraient des liens. Aussi peut-on, selon lui, en inventant un rêve, donner libre cours à sa fantaisie, sans s’embarrasser d’aucun souci de vraisemblance ; c’est ce qu’il a fait. Deux préoccupations seulement se sentent dans cette œuvre extraordinaire, et qui, à plusieurs titres, doit exciter la plus vive admiration. La première était de reproduire dans son style les formes littéraires de ses modèles, les Latins et les Grecs ; il y a réussi de façon si merveilleuse qu’il a mis en défaut les critiques les plus compétents, réussissant à leur laisser croire que ses traductions intégrales étaient des additions personnelles, et inversement. La seconde a été de reculer les limites de l’épouvante, et là il ne nous semble pas qu’il ait atteint son but. Il entasse dans ses descriptions tant d’horreurs extravagantes, qu’il déconcerte l’esprit plutôt qu’il ne le louche ; on admire la richesse incomparable de son style et de son imagination, mais on ne frissonne plus, parce que cela est trop en dehors des choses que nous sommes habitués à ressentir. Pour mon compte, j’ai mieux partagé le sentiment qu’il essayait d’inspirer à ses lecteurs, quand je m’identifiais à Lucius inquiété par des ombres lorsqu’il traversait sur son cheval Phlégon la forêt de Thessalie, que lorsque j’ai été entraîné par Meroe dans ces mondes invraisemblables où le disque sombre des soleils éteints éclaire des furies, des cadavres et des mers de sang. Mais nous nous laissons entraîner là à des discussions littéraires étrangères à notre programme.
Au milieu de ses envolées d’imagination, Nodier reprend terre [p. 224] quelquefois pour nous faire toucher du doigt de menus faits qui ont leur place dans l’explication des rêves. Il a nettement entrevu l’influence des sensations actuelles du dormeur sur ses visions hallucinatoires. Polémon est couché auprès de sa maîtresse, dont le corps pèse de tout son poids sur son bras, comprimant ainsi les nerfs et arrêtant la circulation dans les veines ; c’est plus que de la gêne, c’est de la souffrance. Il s’endort cependant, mais sa douleur se traduit par le cauchemar où Meroe le livre sans défense à l’affreux Smarra, l’exécuteur de ses maléfices.
La Fée aux Miettes. — Dans ce délicieux conte fantastique, se trouvent de-ci, de-là, des petits bouts de rêves qu’il serait bien difficile de juger du point de vue où nous nous sommes placés, car comment comparer les fantaisies du rêve aux réalités de la vie éveillée quand ces dernières ne sont pas moins fantastiques, dans le cerveau de ce fou sympathique qu’est Michel. Mais on ne saurait passer sous silence le rêve· qui constitue, en même temps que le dernier épisode du conte, en quelque sorte sa conclusion morale. Michel aime la Fée aux Miettes : il l’a aimée toute sa vie, mais l’âge et l’aspect physique de la bonne vieille ne lui permettent pas de confondre ce sentiment avec l’amour. Il faut qu’elle prenne les traits de Belkiss pour que cet amour éclate et alors le voilà tiraillé entre deux sentiments contraires : l’attraction vers Belkiss et la fidélité à la Fée aux Miettes qu’il vient d’épouser. Ce dernier sentiment est le plus fort et il repousse avec une vertueuse énergie le souvenir de Belkiss dont il a même éloigné le portrait de ses yeux, sinon de sa pensée ; aussi il la revoit en rêve chaque nuit, et Belkiss devient la seconde épouse, celle qui est pour les sens, tandis que la Fée aux Miettes reste l’amie maternelle et chaste qu’elle a toujours été pour lui. Et plus cette opposition s’accentue dans son esprit, plus deviennent vifs ses remords de. trahir la Fée aux-Miettes ; plus il chasse la vision voluptueuse, plus elle revient.
Ce conte admirable est donc en accord sous ce point de vue avec les idées soutenues dans ce livre touchant la théorie du rêve, mais il peut servir en outre à illustrer ce qui a été exposé dans le précédent chapitre (2) sur l’utilisation des rêves pour la conquête d’un bonheur imaginaire qui serve-à compenser les tristesses de la vie [p. 225] réelle. Imiter Michel, dans bien des cas, pour bien des pauvres déshérités, ne serait pas de la folie mais de la sagesse.
HOFFMANN.
J’avais gardé de mes lectures d’Hoffmann l’impression qu’il devait se trouver dans son œuvre beaucoup de rêves sans doute fort intéressants si l’auteur y avait mis, comme il était probable, ce réalisme profond et cette finesse d’observation qui coudoie à chaque instant dans ses contes le fantastique le plus échevelé.
Je n’ai donc pas été peu surpris de constater que dans l’œuvre d’Hoffmann : 1° Il n’y a que peu de rêves ; 2°Les rêves sont fort insignifiants ; 3° Ce qui paraît avoir inspiré ses visions fantastiques, c’est bien plus, disons le mot, le délire alcoolique, que la fantasmagorie onirique.
Chez lui, le fantastique revêt trois formes, ou plutôt découle de trois sources, et à chacune d’elles il emprunte un caractère particulier : 1° La puissance et l’originalité de l’imagination dans la condition d’équilibre cérébral parfait ; 2° L’ivresse, depuis les visions simplement bizarres des premières fumées du vin jusqu’aux plus extraordinaires que puisse enfanter le délire alcoolique ; 3° Bien petit, à côté de ces deux chefs principaux, le rêve.
Le Choix d’une fiancée. — Cette nouvelle va nous fournir des exemples à la fois de cette puissance d’imagination et de cette influence du délire alcoolique sur lesquelles nous n’avons pas le droit de nous arrêter.
C’est l’imagination la plus saine, la plus sagement maîtrisée par la raison qui la maintient entre de justes bornes sans lui rien enlever de son piquant et de son imprévu, qui inspire à Hoffmann l’épisode des trois cassettes. Dans la première cassette, le conseiller privé Tusmann, vieux rat de bibliothèque qui n’a de vraie passion que pour les bouquins, trouve ce merveilleux petit livre aux pages toutes blanches qui se transforme selon son désir pour devenir à chaque moment le livre qu’il veut lire. Dans la seconde, le baron Benjamin, digne neveu du vieux Juif Manassé, trouve la précieuse petite lime qui lui permettra de rogner les ducats indéfiniment en les laissant aussi neufs que s’ils sortaient de dessous le balancier. La troisième est celle où le jeune amoureux trouve avec le portrait d’Albertine le droit de devenir son époux. [p. 226]
C’est au contraire aux fumées du vin que se rapporte de la façon la plus nette toute la scène de la terrible nuit où pout la première fois le conseiller Tusmann rencontre ses persécuteurs. Cette narration a presque la valeur d’une observation médicale et il n’est pas un médecin qui à l’entendre ne fasse un diagnostic exact. Hoffmann a puisé tout cela dans ses propres souvenirs et s’il a fait une faute, c’est seulement d’avoir attribué au sobre conseiller Tusmann, dès sa première incartade, des visions qui ne sont à leur place que dans le cerveau d’un alcoolique invétéré : les premières fois, on est ignoblement malade, et c’est tout.
Donc, durant qu’il cause avec Léonard et Manassé, Tusmann voit la face de Léonard se transformer en museau de renard. Quand, une heure plus tard, dans la rue, ses jambes se dérobent et le laissent choir dans le ruisseau, il croit qu’un mauvais plaisant les lui a emportées, et il ne peut se relever que quand celui-ci les lui jette à la figure. Il se dresse alors, parcourt la ville, et finit par monter sur le cheval de bronze de la statue du grand Électeur où il se réveille le lendemain tout surpris de se trouver là. De tous ces épisodes, seule, la valse, avec, en guise de danseuse, un balai qui lui écorche la figure, au milieu d’un cercle d’innombrables petits Tusmann valsant tous comme lui avec de petits balais, peut être attribuée à un rêve que le malheureux aura fait pendant qu’il cuvait son vin sur son cheval. Heureusement que nous sommes en plein fantastique et que nous pouvons soulever la boîte crânienne du digne conseiller pour lire ses pensées, car, à coup sûr, il ne s’est souvenu de rien de tout cela au réveil.
Arrivons aux vrais rêves.
Dans Le Majorat, le vieux justicier, venant passer la nuit dans le château de Her…burg, voit en rêve une apparition qui répète devant lui les principaux épisodes d’un sombre drame qui s’est passé dans le château quelque trente ans auparavant, V… a été à cette époque presque le témoin de ce drame et il n’y a rien d’étonnant à ce que le retour au château en fasse renaître les scènes dans son rêve dès la première nuit. Si tout se bornait là, il n’y aurait rien à redire. Mais le malheur est qu’au même moment, la même apparition se montre aux yeux du neveu et secrétaire du justicier, qui écrit, parfaitement éveillé, dans la pièce voisine. Or, le neveu n’a aucun droit à cette apparition, car il ne sait rien de toute [p. 227] l’histoire, en sorte que cette apparition ne peut provenir de l’intérieur de son cerveau, d’où il faut conclure qu’elle est réelle, qu’elle a pour substance un vrai revenant qui fait coup double en inspirant le rêve de V… en même temps qu’il se révèle aux yeux de son neveu. Du point de vue de la littérature fantastique, c’est fort intéressant ; mais pour la psychologie du rêve, il n’y a rien à y prendre.
Le Violon de Crémone. — Ici, deux rêves assez insignifiants. Dans le premier, le jeune étudiant amoureux d’Antonia rêve que la jeune fille l’appelle à lui et le supplie de la sauver en lui chantant un adagio qui — c’est là peut-être la seule particularité remarquable de ce rêve — a été composé par lui-même, en sorte qu’elle lui apprend quelque chose qu’il ne sait pas en lui disant des paroles qu’il a lui-même composées. Ce trait est bien observé.
Dans le second, rien à noter, sinon la vision intense, par le conseiller Crespel, d’une scène d’amour entre sa fille Antonia et son fiancé, au moment même où celle-ci passe de vie à trépas ! Certainement, dans l’idée de l’auteur, c’est la mort de la jeune fille qui détermine ce rêve, chose admissible après tout, à la condition que le conseiller en ait eu le pressentiment, peut-être inconscient.
Les Maîtres chanteurs. — L’auteur se présente comme s’étant endormi durant qu’il lisait le livre de Jean-Christophe Wagenseil, où il est parlé des Maîtres Chanteurs. Il voit en rêve les personnages de sa lecture, les Maîtres Chanteurs eux-mêmes qui, dans une clairière, après une chasse, viennent se disputer le prix du chant devant le landgrave Hermann de Thuringe et la comtesse Mathilde. Ce rêve est fort bien amené par les circonstances, mais il n’a nullement les caractères d’un rêve et n’est de façon trop évidente qu’une manière de présenter au lecteur d’une façon plus propre à frapper son imagination les personnages dont on va lui conter l’histoire.
Il est très légitime dans les romans de tirer parti des rêves pour peindre l’état émotif des personnages, faire apparaître sous une forme plus vivante leurs pensées secrètes et leurs pressentiments et pour les déterminer même dans tel ou tel sens vers l’action après le réveil. Mais il est tout à fait illégitime de les faire, comme dans ce conte, contribuer au développement de l’action en les enchaînant à celle-ci par des liens logiques et réguliers. [p. 228]
Maître Martin et ses ouvriers. — Dans ce conte, un rêve court et bien banal : Frédéric qui aime Rosa, la fille du tonnelier, et regrette son art qu’il a abandonné pour la conquérir, la revoit dans ses rêves mêlée aux objets dont ce regret fait naître l’image en son esprit.
La Fascination. — Ici, Hoffmann raconte quelques rêves brefs et peu significatifs qui ne méritent guère de retenir l’attention, mais il met dans la bouche de certains de ses personnages quelques idées théoriques qui paraissent être les siennes et qui doivent être rapportées :
« Au surplus, mes amis, ces songes terrifiants qui nous tourmentent parfois, tels que se figurer qu’on tombe d’une tour, qu’on est décapité, et mille autres plus ou moins désagréables, sont le résultat de quelque douleur physique qui réagit sur nos facultés morales. Tenez, je me rappelle un songe où j’assistais à une orgie. Un officier et un étudiant se prennent de querelle, et se lancent leurs verres à la tête ; je veux les séparer, mais dans cette lutte je me sens si grièvement blessé à la main que la souffrance m’éveille. Ma main saignait réellement, car je venais de l’écorcher à une grosse épingle piquée dans ma couverture ».
Tout cela est entièrement conforme aux idées modernes. Par contre, il dit ailleurs :
« Comme je sais- par expérience que les rêves de la nuit sont le fruit des sensations éprouvées pendant le jour, j’ai toujours soin, avant de m’endormir, de chasser toute préoccupation pénible et d’amuser mon esprit par quelque joyeux souvenir du temps passé. C’est une recette excellente contre le cauchemar. »
Cette expérience, l’auteur ne l’a pas faite ; et s’il l’avait faite, il aurait constaté au contraire que les idées qui lui reviennent en rêve sont celles repoussées et non celles qu’il a caressées avant de s’endormir.
EDGAR POE.
Souvenirs de M. Auguste Bedloe.— Ce conte est le récit d’un des épisodes les plus impressionnants de ces mouvements insurrectionnels qui, à maintes reprises, soulevèrent les Indous contre les Anglais conquérants de leur pays : la révolte de Cheyte-Sing [p. 229] en 1780. Une poignée d’Anglais fut écrasée à Bénarès par la population révoltée, tandis que Cheyte-Sing, assiégé dans son palais, s’échappait par le Gange, en descendant par une fenêtre au moyen d’une corde faite de turbans noués bout à bout. Dans cette échauffourée, un certain Oldeb fut tué, frappé à la tempe par une flèche empoisonnée, contournée en forme de serpent. Mais l’histoire est racontée quelque quarante ans plus tard, en 1827, comme revécue par un certain Bedloe, névropathe, rêveur, morphinomane et victime volontaire des pratiques de l’hypnotisme. Aussi une question se pose : cette histoire revécue d’une façon si intense et si imprévue est-elle un simple rêve d’homme endormi, une vision de morphinomane, ou, comme l’auteur l’insinue, l’effet d’une suggestion à distance ? car, au moment même où Bedloe revit cet épisode, son médecin, le Docteur Templeton, le magnétiseur habituel de M. Bedloe, qui a assisté à la scène côte à côte avec la victime M. Oldeb, est à quelques lieues de là, en train de la transcrire sur ses tablettes. Puisque l’auteur laisse la question en suspens, nous la résoudrons pour lui : ce n’est pas de la suggestion à distance, parce que cette suggestion n’existe pas ; ce n’est ni un rêve ni une hallucination d’opiomane, parce que ni celle-ci ni celle-là ne sauraient créer la reproduction exacte d’événements réels que le rêveur ne connaissait pas. Qu’est-ce donc alors ?
Edgar Poë nous insinue que tout cela se pourrait expliquer d’une manière inattendue, M. Bedloe n’étant qu’une réincarnation du défunt M. Oldeb. Tout l’indique en effet : et les noms qui sont l’anagramme l’un de l’autre, et l’aspect vieillot, falot, presque fantomatique de M. Bedloe, et sa ressemblance extraordinaire avec M. Oldeb, démontrée par un portrait qui est entre les mains du Docteur Templeton, tout enfin, jusqu’à son genre de mort par une sangsue venimeuse à ondulations serpentiformes, qui le pique à la tempe, juste à la place où 1M. Oldeb a été blessé par la flèche serpentiforrne lancée dans la bagarre,
Est-il utile de dire que nous n’acceptons pas davantage cette fantaisiste explication ?
Qu’est donc cette histoire ?
Eh bien, c’est simplement une originale fantaisie d’Edgar Poë. Mais alors, pourquoi en parler ici ? D’abord parce que l’auteur pose lui-même la question du rêve. Puis, pour avoir une occasion [p. 230] de plus de dire comment ces choses se doivent juger en saine philosophie ; mais surtout parce que, à cette occasion, l’auteur énonce un principe intéressant qu’il reconnaît avoir emprunté à Novalis : c’est que, lorsque dans un rêve on se demande si l’on rêve, on est vite renseigné, car le fait de se poser cette question avec quelque insistance provoque le réveil. Cela cependant n’est pas toujours vrai ; je sais d’expérience personnelle et l’ai montré au cours de cet ouvrage par divers exemples, que le rêve peut continuer à évoluer, au moins pendant quelques épisodes, après que l’on s’est posé cette question. (Voir mon rêve des quatre réveils imaginaires.) Et d’autre part, tous les moyens que l’on emploie pour se convaincre, se pincer, se baigner la figure, interroger les personnes présentes, tout cela n’aboutit jamais qu’à vous convaincre que vous ne dormez pas, pour la bonne raison que toutes ces expériences vérificatoires, vous rêvez que vous les faites, mais vous ne les faites pas. Aussi Bedloe n’a-t-il pas raison quand il se persuade n’avoir pas rêvé pour s’être, dans son rêve, plongé la tête dans une source fraîche sans provoquer le réveil.
Ligeia.— Inutile d’insister sur ce conte, au sujet duquel se posent les mêmes questions que pour le précédent, mais limitées ici au rêve d’un cerveau malade et surexcité ou aux visions d’un morphinomane. Ce serait plutôt de ces dernières qu’il s’agit ici. D’ailleurs que ce soient les unes ou les autres, rien qui ne soit parfaitement admissible, car tout se borne à l’apparente résurrection d’une morte dans les yeux de laquelle le visionnaire croit retrouver l’expression indescriptible et vainement cherchée ailleurs du regard d’une maîtresse morte depuis plusieurs mois,
L’Ange du bizarre. — C’est le récit des visions d’un homme abominablement gris, qui s’endort dans son fauteuil après avoir vidé une bouteille de kirsch et se réveille ayant roulé sous la table. C’est une suite de scènes dont chacune est possible, mais qui par leur réunion ressemble plutôt aux élucubrations d’un homme qui aurait tenté de conquérir le record de l’extravagance. Redisons que le rêve admet toutes les incohérences et toutes les invraisemblances, sauf une celle de n’être composé que d’invraisemblances et d’incohérences, sans immixtion de la moindre parcelle de choses ternes, raisonnables ou indifférentes.
Mais si ce n’est pas à proposer comme modèle de rêve possible, [p. 231] ce n’en est pas moins fort amusant et digne de tenter pour l’illustration le crayon d’un Callot.
BEAUDELAIRE.
D’avoir traduit de Quincey et Ed. Poë, un opiomane et un dipsomane, auteurs d’œuvres de tout premier ordre, semble indiquer chez Baudelaire le goût de ces productions hautement fautastiques, et il semblerait que cette admiration ne saurait aller sans le désir de les imiter. C’est ce qui nous a conduits à compter Baudelaire au nombre des auteurs chez lesquels nous avons cherché des éludes de rêves, quand nous en laissions de côté d’autres de valeur au moins égale, mais à l’imagination plus tempérée. Cependant nous n’avons trouvé rien à glaner dans l’œuvre, d’ailleurs peu étendue, de Baudelaire, car nous devons laisser de côté les visions d’opium et de haschisch décrites dans ses Paradis artificiels,puisque nous écartons de notre programme toute la catégorie des rêves éveillés.
Les Fleurs du mal. — Dans cet ouvrage, nous ne trouvons qu’un rêve, si toutefois c’en est un ; et s’il est curieux comme conception artistique, ce Rêve parisien n’offre comme rêve rien de bien extraordinaire. C’est monnaie courante en effet de trouver dans les rêves des tableaux qui diffèrent de ceux de la vie réelle par la suppression de quelque trait caractéristique, à laquelle ils doivent leur étrangeté. Mais ce qui est plus rare, c’est que cette suppression soit, comme ici, rigoureusement systématisée : l’esthétique artistique l’exigeait, la vraisemblance ne le contredit pas d’une façon absolue. En trois lignes ce tableau peut être décrit. C’est l’évocation d’un monde inconnu où manque toute végétation, tandis que partout ruissellent les marbres, les métaux polis et les pierres étincelantes, formant des palais, des colonnades et des ponts sous lesquels dort une eau limpide et lourde comme le cristal.
PAUL BONNETAIN.
L’Opium.— Bonnetain, avec la fine et pénétrante exactitude qu’apporte le médecin à une observation médicale, peint la vie du fumeur d’opium depuis la première pipe fumée par curiosité jusqu’au jour où ,il meurt victime d’une fatale anémie progressive. [p. 232] Il ne nous appartient pas de le suivre dans la description de la lutte entre les reproches de la raison et la hantise du poison qui finit toujours par l’emporter. Nous n’avons même pas à parler des rêves éveillés que procure l’opium ; mais l’opiomane a des rêves véritables, tantôt produits par l’opium, lorsque l’action simultanée de l’alcool surajoute le sommeil à la rêverie morphinique, tantôt indépendants de cette intoxication immédiate, mais entachés cependant de morphinisme par suite de l’altération chronique des humeurs el des centres nerveux. Ces derniers sont en quelque sorte les rêves normaux de l’opiomane.
Ces rêves vrais ont tous les caractères des rêveries à l’état de veille qui se produisent sous l’influence de l’opium aux phases correspondantes de l’intoxication progressive. C’est toujours un mélange de sensations voluptueuses et horribles, avec prédominance des premières au début, puis des dernières qui, finalement, restent seules. Peut-être Bonnetain n’a-t-il pas, pour le louable but de corser sa thèse, fait une part suffisante aux premières ; et si tous les fumeurs recueillaient aussi peu d’agrément que le pauvre Marcel Deschamps en échange de tant de sensations pénibles ou horribles, peut-être le nombre de ceux qui persistent dans leur vice serait-il moins grand. Deux rêves, l’un au commencement du récit, l’autre à la fin, caractérisent ces deux phases.
Dans le premier, c’est à peine si quelques embrassements voluptueux dans le hamac d’un sampang viennent jeter une note agréable dans un cauchemar où les tableaux les plus étranges et les plus angoissants se succèdent dans une incohérence absolue : c’est d’abord le charriage irrésistible et qui lui semble durer des jours, des mois, des années, dans les eaux gluantes d’un fleuve qui coule dans les ténèbres avec des bêtes plutôt devinées qu’entrevues, se fixant à son corps par d’innomables suçoirs ; puis la fuite éperdue pour échapper à une ignoble vieille qui veut s’imposer à ses caresses ; puis d’interminables travaux parmi des tombes, pour finir par une partie de cartes avec des partenaires sur un cercueil dans lequel le perdant sera cloué.
Dans le dernier rêve il n’y a même plus la maigre compensation de ces brèves effusions voluptueuses et l’horrible prend une forme encore plus extra-réelle. En vain s’efforce-t-il, dans un couloir interminable et qui va se rétrécissant toujours, de se rapprocher [p. 233] d’une femme aimée, tandis qu’il traine comme une ancre, au bout de son bras allongé en corde, un cercueil où git le cadavre de cette même femme et dont le couvercle cloué sur son poignet a emprisonné son poing.
En somme, ce sont là les caractères habituels des rêves normaux (relation lointaine avec les faits réels el incohérence déconcertante), mais où le toxique ajoute un caractère émotif intense qui exagère énormément, mais sans en modifier la nature, le sentiment et la forme de sensibilité qui dominent chez le rêveur.
Cela explique dans une certaine mesure pourquoi Marcel Deschamps ne retire que si peu d’agrément de l’exercice de son vice : c’est parce qu’il est naturellement porté à la tristesse. Un fumeur dont l’humeur habituelle aurait une tournure plus heureuse recueillerait beaucoup plus de sensations agréables. Mais dans l’un et l’autre cas, à ces visions agréables ou pénibles se surajoute un sentiment de bien-être physique qui suffit à lui seul pour expliquer la recherche du toxique.
Tout cela, nous le répétons, est dépeint avec une grande vérité jusque dans les moindres détails, et nous le constatons avec d’autant plus de plaisir que l’auteur a fort bien dégagé, évidemment sans savoir que nous l’avions fait avant lui, une des lois principales du rêve, savoir : l’absence dans les visions oniriques de l’objet de nos préoccupations immédiates les plus pressantes, tandis que reviennent les souvenirs lointains et surtout ceux que nous avons cherché à écarter.
SCHURÉ.
Le Double. — Avant de lire ces lignes et pour nous éviter des répétitions oiseuses, le lecteur fera bien de prendre connaissance de ce que nous disons du double ailleurs dans ce volume. Cela fait nous pouvons entrer tout de suite dans la discussion de la conception de Schuré. Le peintre Marrias est un être mixte, et dans son cœur, deux tendances opposées et presque également puissantes se livrent un perpétuel combat : d’une part, le Torero sanguin, passionné, violent, supportant impatiemment tout frein et toute contradiction, voulant les femmes pour en jouir d’un amour égoïste et sensuel ; d’autre part, l’homme sensible, épris d’idéal, aimant le beau et le bien pour la sensation de paix et de [p. 234] bonheur qu’ils apportent à l’esprit et pour le calme reposant qu’ils rendent aux nerfs. Il connaît fort bien en lui la coexistence de ces deux êtres et appelle les phases de sa vie où il s’est abandonné à l’une ou à l’autre de ces tendances ses « amours noires » et ses « amours blanches ». De ces deux tendances, jamais une seule ne règne en lui en maitresse absolue ; pendant que l’une domine, toujours l’autre fait entendre sa voix ; mais il la refoule avec violence sous l’influence de l’excitation de la phase où il se trouve. Dans ses méditations, ces deux êtres qu’il sent en lui déterminent des images mentales où il se voit successivement dans l’une et dans l’autre condition et chacune est à un moment refoulée pour faire place à l’autre. Quoi d’étonnant dès lors à ce qu’elles reviennent simultanément dans ses rêves ? Ainsi s’explique ce premier songe où il voit simultanément le Marrias noir et le Marrias blanc, celui-ci dans sonlit, celui-là sur une chaise à son chevet ; l’un l’excitant au mal, l’autre luttant pour ne pas succomber. Et, alternativement, son moi va de l’un à l’autre, en sorte qu’il est tantôt le Marrias blanc ayant pour double le Marrias noir et tantôt le Marrias noir ayant pour double le blanc.
Au moment où l’action commence, Marrias vient de rêver de son double et ilvoit là un funeste présage. Cela s’explique à souhait, car celui qui ouvre l’action est le Marries blanc et ce rêve indique que le Marrias noir veille et a commencé ses attaques. S’il y succombe, le rêve aura été prophétique. C’est ce qui arrive en effet, car c’est à ce moment que Marrias fait la connaissance de Ténébra, c’est-à-dire de la femme qui sera l’objet de ses amours noires tandis qu’une autre femme, Marion, symbolisera ses amours blanches auxquelles dans une scène finale la victoire restera. A cette scène correspond un rêve où pour la dernière fois il revoit son « double ». Et c’est tout. Quant à l’idée que le « double » noir lui apparaît dans ce dernier rêve suscité par Ténébra dans une scène d’envoûtement et que ce « double » est définitivement vaincu par le coup de poignard qu’il croit lui porter en rêve, ce sont là des divagations mystiques auxquelles la philosophie positive ne saurait s’arrêter. Le double peut être supprimé par le contre-coup psychique de ce coup de poignard, mais ce n’est pas de cette façon raisonnable que l’auteur parait l’avoir entendu.
Si l’on fait abstraction de ce dernier trait dont il ne faudrait pas [p. 235] exagérer l’importance, on voit que Schuré a remarquablement saisi les vrais caractères de certains rêves, et compris le rôle que peut en tirer un auteur averti.
JÉROME K. JÈROME.
Novel Notes. — On trouve ici entre autres histoires la narration de cinq rêves. L’auteur présente son livre, non comme une chose achevée, mais comme des notes éparses prises de loin en loin, en vue d’un futur roman et publiées telles quelles. Est-ce sincère ? ou faut-il voir là un artifice ingénieux permettant une narration à bâtons rompus qui n’est pas sans saveur ? En tout cas, les rêves qui y sont rapportés doivent à ce mode de narration une incohérence et un décousu qui leur donnent un tel air de sincérité, qu’on est tenté de les traiter comme des rêves vécus.
Il n’y a pas lieu de les analyser tous en détail.
Dans deux d’entre eux, on peut remarquer la relation entre le sujet du rêve et les sensations actuelles, du dormeur : il a faim et se voit rongeant le couvercle bardé de fer d’un coffre rempli d’or auprès du cadavre de son ami qu’il vient d’assassiner pour mettre le trésor à l’abri de sa convoitise ; il a froid et se voit sur la scène jouant en chemise un rôle qui comporterait un tout autre costume. Mais ce sont là choses banales. Un trait beaucoup plus singulier, s’il est réel, consiste en ce que plusieurs de ces rêves retracent une très longue période de vie. Je n’ai pas d’exemple personnel d’une chose si singulière, et, sans en vouloir nier la possibilité, je reste un peu sceptique sur ce point : voir en rêve les épisodes discontinus, mais chronologiquement ordonnés d’une action durant des dizaines d’années, cela ressemble singulièrement à une fantaisie de romancier.
En est-il de même pour l’épisode bizarre du rêve n° 3 où le dormeur voit son double, mais non pas unique comme dans tous les autres cas de ce genre ; la vision se multiplie en une multitude de petits personnages, qui sont ses doubles. Mais ceux-ci ne sont pas comme les innombrables petits Tusmann dansant avec un balai dans Le Choix d’une fiancée d’Hoffmann, la reproduction d’une même effigie : ils sont tous très différents d’aspect les uns des autres et d’âges variant de l’adolescence à l’extrême vieillesse ; ils [p. 236] représentent le rêveur aux différentes époques de sa vie passée, actuelle et future. Tous lui causent d’ailleurs une frayeur vive et irraisonnée.
Je pourrais être tenté, de discuter la possibilité d’un rêve sans exemples ou de rechercher les causes de celle vision de doubles multiples d’âges différents, s’il s’agissait d’un rêve réel. Dans le cas présent, je me contente d’en signaler le caractère hautement exceptionnel. Je ne voudrais pas renouveler une fois de plus l’histoire de la dent d’or.
Un autre trait non moins curieux et autorisant les mêmes réserves, consiste en ce que dans deux de ces rêves, le rêveur lui-même ne prend aucune part à l’action qui se déroule sous ses yeux : son moi est absent ; il ne se situe nulle part dans le rêve. Ainsi celui qui porte Je n° 5 raconte l’histoire d’un personnage à qui un génie promet la fortune et le succès dans toutes ses entreprises à condition que jamais il ne se laisse aller à aimer un être vivant. Le personnage promet, tient parole, et voit en effet la fortune lui sourire et satisfaire à tous ses désir. Un jour, une pauvre fillette abandonnée l’implore ; il lui refuse même un regard de pitié et l’enfant meurt. Après sa mort, l’homme la prend dans ses bras, la caresse comme pour la réchauffer par une tendresse désormais inutile. Le cadavre ne se décompose pas et l’homme revient tous les jours le prendre dans ses bras et le caresser, donnant ainsi le change à un besoin d’affection qui n’est pas mort en lui et ne peut s’exercer sur les vivants. Mais dans toute cette action, outre qu’elle dure des années, le rêveur est absent : il n’est ni le génie, ni le héros, ni la victime ; il sait tout cela d’une façon abstraite, ou, s’il le voit projeté sur un écran, il ne se sent pas lui-même devant cet écran. Bien entendu, je ne puis rien affirmer, mais de par mon expérience personnelle des rêves, j’ai l’impression invincible ou que c’est un roman inventé de toutes pièces, ou que c’est ce que j’ai appelé un rêve dirigé, et, peut-être, dans le cas actuel, inconsciemment dirigé. Et voici comment je comprends la chose. L’auteur a vraiment rêvé le commencement de l’action, peut-être l’apparition du génie avec les promesses qu’il fait et la condition qu’il impose, puis il est passé à l’état de demi-sommeil avec assez de lucidité pour saisir l’intérêt littéraire de cette donnée et la développer comme un thème de roman, c’est-à-dire avec le concours de [p. 237] sa volonté et de son jugement. Mais pourtant les yeux restent fermés, le cerveau est dans un certain état d’assoupissement, peut-être entrecoupé de courtes absences avant le réveil complet. Et l’auteur a confondu avec un vrai rêve ce qui n’était que le produit hybride du rêve et de la méditation. S’il en est ainsi, la difficulté disparaît, car il est fréquent que dans la méditation, notre moi soit absent des tableaux qui se déroulent dans notre pensée.
WELLS (H. G.).
Douze Histoires et un rêve. — Les douze histoires et le rêve dont il est question dans ce titre n’ont rien de commun entre eux ; ce rêve constitue une treizième histoire indépendante des autres et la constitue tout entière à lui seul. Il est dans les habitudes de Wells de faire de l’extraordinaire ; il faut donc accepter le rêve comme il nous le présente, c’est-à-dire comme un rêve hautement exceptionnel et ne pas exiger de lui une vraisemblance quelconque. Qu’il soit possible, c’est tout ce qu’on est en droit de lui demander et les lois des rêves possibles sont bien autrement élastiques que celles des rêves probables ou habituels.
Nous plaçant à ce point de vue, nous ne demanderons pas à Cooper, « l’homme au teint blême », petit procureur à Liverpool, s’il y a dans sa vie antérieure des impressions inhibées qui l’aient poussé à faire ce rêve d’une seconde existence où il porte le nom de Hedon, joue le rôle d’un personnage politique de très grande envergure et laisse les peuples s’entre-dévorer dans une guerre criminelle pour se consacrer à l’amour d’une femme.
Wells n’a aucune préoccupation de vraisemblance ; la chose à laquelle il s’applique, c’est de faire rendre au rêve le maximum de ce qu’il est capable de fournir, et là nous avons le droit de lui demander s’il a ou non dépassé les bornes de la possibilité.
Les visions des rêves de Cooper sont si intenses et si continues, si bien ordonnées qu’elles aboutissent à un dédoublement de la personnalité : cela n’a rien que de très admissible et nous verrons un médecin, très préoccupé des questions de vraisemblance, le Dr T. Henvic, dans L’Antithèse, faire, lui aussi, aboutir son héros, par le rêve, au dédoublement de la personnalité. Mais Wells va plus loin. Les visions de la vie seconde sont si fortement gravées, [p. 238] s’imprègnent si profondément dans son cerveau, qu’auprès d’elles celles de la vie ré elle sont ternes et floues, en sorte que sa vie seconde devient sa vraie vie, et quand il doute de la réalité de l’une des deux, c’est plutôt de celle de la vie réelle. Nous ne nous croyons pas le droit de nous inscrire en faux contre une pareille éventualité, tout exceptionnelle qu’elle soit.
Une autre particularité bien curieuse est celle-ci : d’ordinaire, dans les cas de ce genre, les deux vies, seconde et première, sont contemporaines et, à quelques heures près, coïncident dans le temps si elles alternent dans l’espace ; on peut admettre aussi que la vie seconde reporte le dédoublé au temps passé : c’est ce qu’a fait Henvic pour son Sylvestre. Ici la vie seconde prend place dans un siècle futur. Cela est sans exemple, croyons-nous ; mais il ne semble pas cependant que l’on ait le droit de déclarer la chose impossible. On voit combien nous sommes larges dans nos concessions ; cependant nous ne pouvons aller plus loin et nous sommes obligés de contester à Wells le droit de faire intervenir dans le rêve certaines circonstances dont il nous reste à parler.
Ces nombreux rêves successifs se font suite d’une impeccable façon et déroulent l’évolution d’une seconde vie dans laquelle il n’y a ni une lacune ni un retour en arrière. Bien plus, les intervalles qui séparent deux rêves successifs sont, dans la vie seconde, exactement mesurés sur le temps qui les sépare effectivement dans la vie réelle. Eh bien, cela est à notre avis entièrement inadmissible. Il faudrait pour qu’il en fût ainsi, que l’on pût retrouver dans une longue série de visions successives s’évoquant les unes les autres par la fantasque association des idées cette implacable logique évolutiye qui, dans la vie réelle, met chaque chose rigoureusement à la place qu’elle a le droit d’occuper dans l’espace et dans le temps.
Une autre circonstance nous paraît mériter le même jugement sévère : Hedon, le héros de la vie seconde qui se passe toujours durant que Cooper, le personnage de la vie réelle, est paisiblement allongé entre ses draps, ce Hedon, dis-je, connaît Capri et Poestum, Naples et le Vésuve où Cooper n’est jamais allé, et les connaît, non pas vaguement, mais dans tous les menus détails de leur topographie. Cela serait admissible si Wells nous présentait ce phénomène comme le résultat d’anciens souvenirs à demi effacés, que ces souvenirs aient eu leur origine dans un voyage fait durant la première [p. 239] enfance, ou dans la contemplation même inconsciente des images d’un livre ou des photographies d’un album. Il se garde bien de rapetisser ainsi son rêve à des proportions humaines, il est muet à cet égard ; mais on peut aisément deviner qu’il tient à laisser à cette reconnaissance de choses jamais vues la signification d’une divination fantastique. Eh bien, là encore, il dépasse les limites de la possibilité.
Un mot pour finir : Cooper en racontant ces rêves dont il est la victime et qu’il présente comme les réalités d’une seconde vie, explique qu’à un moment il a été tué par un coup d’épée en plein cœur qui a mis fin à cette seconde vie et aux rêves durant lesquels elle s’accomplit. (Voir ici les remarques que nous avons présentées sur un cas analogue dans Le Double de Schuré.)
En plaçant la vie seconde de son héros non dans le présent mais dans l’avenir, Wells peut avoir été guidé par deux idées. L’une serait une simple habileté pour éviter une objection qui se présenterait naturellement à l’esprit : puisque Hedon se rappelle pendant sa vie première les faits de sa vie seconde, si cette vie seconde était contemporaine de la première, il aurait un moyen sûr de vérifier si elle est réelle ou rêvée, et il reconnaîtrait bien vite que cette seconde alternative est seule possible ; il lui suffirait pour cela d’ouvrir les journaux et de voir que nulle part il n’est question ni de ce Cooper, ni de cet Evesham qui emplissent le monde des éclats de leur politique. L’autre idée de Wells pourrait être d’affirmer la possibilité d’une prescience de l’avenir dans le rêve. Si cette prescience existait, Wells ne serait pas sans doute un des heureux mortels qui la possèdent, car sa prévision des engins de guerre de l’avenir est plutôt banale.
Dr T. HENVIC.
Hallucinés.— Trois nouvelles dans cet ouvrage qui, par ordre d’importance sous le rapport du rêve, se classent en sens inverse de leur succession dans l’ouvrage. La troisième, Incertitude, présente le cas, simplement amusant, d’une visite faite de nuit dans une petite ville, dans des circonstances telles que le promeneur n’arrive pas à savoir s’il a vraiment fait cette promenade ou s’il l’a rêvée. A un moindre degré, de pareilles incertitudes se rencontrent [p. 240] quelquefois dans la vie de chacun et l’intérêt de cette nouvelle est de montrer jusqu’où cela peut aller quand se trouvent par hasard réunies les conditions les plus favorables.
La deuxième, L’Antithèse, nous montre un pauvre diable, humble et inoffensif, aux prises d’une part avec sa femme, mégère impitoyable, de l’autre avec les indifférents qui le coudoient et le rudoient, abusant de sa timidité et de sa bonhomie, en sorte que pour lui la vie n’est qu’une longue tristesse. A toutes ses misères, une seule compensation, mais admirable et sublime : ce sont ses rêves, constituant pour lui une seconde vie qui rachète par sa diversité, sa douceur et presque ses voluptés la monotonie écœurante et les rudesses de la vie réelle. On peut reprocher à ces rêves d’être trop longs d’un seul tenant dans une même nuit, et de rappeler trop invariablement d’une nuit à l’autre toujours la même image consolatrice, celle de la déesse Istar, personnage qu’il a déniché dans ses études, retrouvé, dans les galeries des antiquités orientales au Louvre, et dont il est amoureux. Mais il ne faut pas trop juger ces songes à la mesure des rêves du commun des mortels, car Sylvestre, sans être aucunement un dément, n’est pas tout à fait normal sous le rapport psychique. Aussi se laisse-t-il glisser à prendre ses rêves pour les réalités d’une seconde vie, et, comme le Cooper de Wells, il verse dans le dédoublement de la personnalité. Mais ici la difficulté qui avait poussé Wells à placer la vie seconde dans l’avenir n’existe plus, parce que sa vie seconde est si dématérialisée, si différente sous tous les rapports de ce qui se passe chaque jour sous ses yeux, qu’il la place dans un autre monde sans relation avec celui où il s’agite dans le jour.
L’antithèse, c’est l’opposition violente entre ses deux vies, l’une de misères, l’autre de douceur, et cette antithèse arrive, au dernier chapitre, à son expression la plus intense : Sylvestre se voit, dans un rêve, emporté au delà de la terre dans les bras d’Istar où il goûte enfin les dernières voluptés qui lui avaient été jusque-là refusées, tandis qu’en bas, entre le chef de service et l’interne, devant, les étudiants groupés autour du lit, le vrai Sylvestre rend le dernier soupir sur un grabat d’hôpital.
La première nouvelle, Le Dilemme, est de beaucoup la plus importante sous le point de vue qui nous occupe ; non que le rêve y prenne une place plus grande que dans la précédente, mais parce [p. 241] que l’auteur y saisit l’occasion d’exposer sa théorie du rêve et, non sans une certaine impudence, car cette théorie n’est autre que celle soutenue par l’auteur du présent ouvrage. C’est au point que l’on pourrait croire que c’est nous qui l’avons copié, s’il ne se trouvait que la théorie exposée ici a déjà été présentée par nous tout au long il y a quelque vingt-cinq ans, bien avant le roman en question, dans un journal des plus répandus (Revue Scientifique).
Ces réserves faites, nous devons reconnaître que l’auteur a tiré de cette conception un parti original et assez amusant.
Comme il ne s’agit pas ici d’un roman très connu, il ne nous est guère possible d’en parler sans le résumer brièvement.
L’action se passe dans un petit couvent de religieuses, perdu au fond de la Bretagne. Le hasard a mis sous les yeux des nonnes, toutes aussi ingénues qu’elles sont chastes, deux amants que leur arrivée sépare après une idylle qui n’avait rien de platonique, et l’homme avant de s’enfuir leur a laissé voir… comment dire ? un trait anatomique compliqué d’un état physiologique dont un je ne sais quoi leur a fait deviner l’extrême indécence sans qu’elles y aient cependant rien compris. D’où dans leur âme une préoccupation, une inquiétude vague que la supérieure surprend et dont elle finit par savoir l’objet. Elle confesse ses nonnes et leur représente, bien entendu sans leur rien expliquer, cette chose odieuse et abominable comme une apparition démoniaque qu’elles doivent, avec le secours de la prière et toutes les forces de leur volonté, chasser de leur esprit chaque fois qu’elle s’y présente. A la suite de quoi, la chose apparaît en rêve à une des nonnes, d’abord de temps en temps, puis chaque nuit ; puis ce même rêve s’étend à une autre, fait tache d’huile et bientôt le couvent tout entier devient la victime du terrible fléau.
Après avoir épuisé des moyens qui ne font qu’exaspérer le mal, la supérieure a recours à l’évêque qui envoie, pour enquêter, son secrétaire, esprit pénétrant et peu asservi aux superstitions, qui reconnaît aisément la nature nullement surnaturelle et toute pathologique du fléau. Par lui, le problème est soumis au jugement d’un médecin de campagne qui voit clair dans toute l’histoire et en fournit le remède. C’est là que l’auteur expose comme sienne notre théorie et lui demande le moyen de triompher du mal. Ce moyen nous l’avons décrit tout au long dans cet ouvrage sous le titre : [p. 242] Prophylaxie du cauchemar. On le connaît : il consiste à se répéter à satiété à l’état de veille, à se représenter, rappeler, retenir dans la pensée l’objet de l’obsession onirique. Mais il faut avouer que dans le cas présent, la chose n’est pas sans quelques difficultés et c’est en cela que consiste le dilemme, qui fait le titre de la nouvelle : en parler sans cesse pour n’en plus rêver. C’est à quoi sur l’ordre du prêtre doivent se résigner la supérieure et les nonnes : « Ce fut pendant quelques semaines un couvent peu banal que celui de Kerbiban : ces nonnes à l’attitude décente s’abordant d’un air contrit, pour s’entretenir des choses dont on parle dans les mauvais lieux. »
L’auteur signe docteur Henvic. A la façon dont les sujets sont traités, on voit que certainement ce titre n’est pas usurpé. Les descriptions y sont des tableaux fidèles des symptômes et il y a place même pour des visions hypnagogiques fournissant l’image de l’objet de l’obsession.
Ce roman peut être cité comme un bon exemple des ressources que le rêve peut fournir à la littérature sans sortir des bornes de la plus scrupuleuse observation.
P. LOTI.
Le rêve ne joue pas dans l’œuvre de Loti, du moins en général, le même, rôle que dans celle des autres romanciers. Nulle part les rêves n’y font partie intégrante d’un enchaînement constituant la trame du livre ; ils sont indépendants du reste de l’œuvre et comme surajoutés : si on les retranchait, on perdrait le charme de leur description, mais à part cela, on ne , s’apercevrait pas de leur absence. Ils sont là pour ajouter une note de plus, généralement touchante et mélancolique, parfois pénible et inquiétante, pour dessiner ou accentuer par un trait de plus quelqu’un des états d’âme que l’auteur aime à peindre et qui sont presque la seule raison d’être du livre.
Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce qu’ils soient des rêves vrais, puisqu’ils ne sont astreints à aucune nécessité résultant de relations avec ce qui précède ou ce qui suit.
J’ai l’impression que ce sont des rêves vrais ; ils en ont tous les caractères et si quelque chose a été ajouté ou retranché pour les besoins de l’esthétique littéraire, cela n’apparaît pas. Tous ces [p. 243] rêves d’ailleurs sont très courts et cela ajoute encore à leur vraisemblance.
DansUn Pèlerin d’Angkor, Loti rencontre sur une plage inconnue des figures qu’il ne connaît pas, et cependant, à les voir, il se sent saisi d’une. émotion pénétrante qui lui fait se demander au réveil s’il n’a pas des souvenirs perdus d’existences antérieures que le rêve pourrait raviver.
DansFantômes d’Orient, avant de repartir pour Stamboul, à la recherche d’Aziyadé, il refait un rêve qui lui revient sans cesse, toujours le même dans ses traits essentiels, ne différant d’une nuit à l’autre que par des variantes sur des points secondaires. Son navire arrive dans la Corne d’or pour une escale qui ne doit durer que quelques heures, il s’élance à la recherche d’Aziyadé et chaque fois des impédiments souvent d’une trivialité absurde se mettent à la traverse, le retardent, et l’heure arrive de regagner son bord en toute hâte sans qu’il ait pu une seule fois joindre la femme aimée ou même entrevoir sa figure. Cela semble pris sur le vif.
DansLe Mariage de Loti, il revoit en rêve Rarahu après avoir entendu un de ses camarades revenant d’Océanie lui raconter sa triste fin. Il la revoit morte, tantôt lui souriant dans son linceul au milieu des femmes qui l’ont ensevelie, tantôt roulée comme une épave par les flots d’une mer sinistre dans une nuit de tempête.
Si ce rêve reste vraisemblable malgré une certaine logique dans les relations entre les sentiments et les images, celui de Propos d’exil l’est non moins par son incohérence, et il n’est personne qui ne puisse retrouver dans ses propres souvenirs des rêves qui rappellent celui-là en dépit de son étrangeté. Ces lunes montant dans le ciel où elles s’évanouissent, présage sinistre pour lui, phénomène naturel pour les autres personnages du rêve ; ces vieilles parentes rajeunies et rapprochées par l’évanouissement des siècles qui les séparaient ; ce bizarre épisode des mèches de cheveux s’entortillant aux ronces et renaissant sous le ciseau qui les coupe pour s’élancer plus haut ; et cette robe d’enfant qui fait naître une incompréhensible émotion de tombe oubliée ou de berceau à venir, tout cela est irréprochable du point de vue de la psychologie de l’idéation dans le rêve. Et c’est de ce que ces choses ne se devinent guère si on ne les a pas spécialement étudiées que résulte l’impression de rêves vécus et peu ou point arrangés. [p. 244]
On en pourrait presque dire autant dans Le Roman d’un Spahi du rêve du soldat qui, chassé par sa maîtresse et hanté par, des idées de suicide, revoit dans un sommeil de fièvre les sites paisibles des Cévennes et les douces silhouettes de ses parents de là-bas.
Par contre, des quatre rêves de Fleurs d’ennui, trois au moins me laissent un peu perplexe. Je ne fais point d’objection à celui où Loti se voit dédoublé auprès de sa tombe, son corps dans le trou et son âme veillant inquiète, assise sur la dalle ; mais que dire des trois autres ? Dans le premier, il sent le Kreisker de St-Pol-de-Léon s’écrouler lentement sous ses pieds et passer en quelques instants à l’état de ruines sur lesquelles les siècles ont roulé, et il se voit lui-même avec son frère Yves à une époque lointaine dans l’histoire de la terre où les œuvres actuelles des hommes seront détruites et oubliées et où tout sera replongé avant la destruction finale dans la condition barbare des temps préhistoriques.
Dans le second, on trépane le crâne de son ami Plumkett avec lequel il est en continuelles discussions, et il en sort nombre de cafards et même trois araignées qui étaient les auteurs responsables de toutes les divagations de ce pauvre ami. Mais ce n’était qu’un rêve, hélas ! car au réveil les divagations reparaissent de plus belle.
Dans le dernier enfin, il se voit dédoublé et son double le représente sous les traits d’un vieillard désabusé tel qu’il se sent devenir lorsqu’il médite à l’état de veille sur la fin de son existence.
Eh bien, tous ces rêves ont ou trop d’esprit comme le second, ou, comme les deux autres, une allure philosophique sérieuse qui a les caractères de la méditation bien plus que ceux du rêve, et peut-être est-il permis de croire qu’il y a ici quelque mélange de ces deux formes de la pensée.
Le Livre de la pitié et de la mort. — Rêve assez banal en lui-même, mais qui puise un grand charme dans l’art infini avec lequel l’auteur sait dépeindre le trouble, l’émotion douce et pénétrante qui l’accompagne. Le rêveur fait rencontre de deux femmes qu’il ne connaît pas, mais il se sent uni à elles par un lien indéfinissable, très fort quoique très ténu. C’est certainement un rêve vécu : on le reconnaît tout de suite aux couleurs dont il est peint et à l’absence complète de tout ornement artificiellement surajouté. [p. 245]
Pour simple qu’il soit, il est remarquable sous certains rapports et provoque trois petites remarques que voici.
La première est relative à cette émotion intense, hors de proportion avec ses causes apparentes et qui a tout entière sa raison d’être dans l’état d’esprit du dormeur. C’est un trait fréquent, réel et fort bien observé.
La seconde vise une petite inadvertance de l’auteur qui déclare que son rêve a été suivi d’une ou deux heures de sommeil sans images. Comment le sait-il ? C’est une chose à jamais impossible à savoir en dehors de repères qui se rencontrent rarement et qui souvent réclament l’intervention d’un tiers.
La troisième, c’est que l’auteur semble voir dans ce rêve la preuve de l’existence d’une sorte de lien mystique entre notre vie présente et des événements qui se sont passés longtemps avant notre naissance, mais qui ont peut -être cependant exercé quelque influence sur notre esprit par l’intermédiaire de nos ascendants, influence trop discrète pour être aperçue de nous dans l’état de veille et qui se révèle un jour par hasard dans cette condition mystérieuse que crée le rêve. Il y a là une idée touchante, inquiétante, dont la littérature peut tirer parti, qu’une certaine philosophie peut envisager, mais que la science positive ignore et qu’elle doit rejeter jusqu’à plus ample informé.
Pays sans nom. — La même idée mystique se retrouve ici dans un rêve où un paysage extraordinaire habité par des formes extravagantes est qualifié de « pays de je ne sais quelle planète, de je ne sais où, entrevu au fond des insondables infinis du temps ou de l’espace, pendant les clairvoyances inexpliquées du rêve ».
Le rêve a des clairvoyances en effet, mais pas de cette nature ; nous les avons définies au chapitre XV (3), celles-ci sont de simples illusions.
DansLe Passé mort, est un autre rêve du même genre, mais qui me plaît moins. L’auteur voit en rêve sa petite ville natale, telle qu’elle était il y a trois quarts de siècle, peuplée par les habitants d’alors dans leur costume du temps et il reconnaît même sous les traits de deux jeunes amoureux un couple de deux vieillards décrépits qu’il a vus dans son extrême jeunesse sous un tout autre [p. 246] aspect. Dans quel cliché-souvenir trouver de pareilles images ? Pas dans ceux obtenus dans la vie réelle à coup sûr ; mais nous avons vu que la rêverie est capable d’en fournir de semblables et il n’y a là qu’un exemple parfaitement possible d’un fait un peu exceptionnel. Une note ajoute à sa vraisemblance, c’est que le rêve est provoqué par un parfum de jasmin, parfum que le rêveur, pendant l’état de veille, avait intimement associé à ses souvenirs du passé. Mais une chose m’inquiète dans ce rêve, c’est l’absence de tout anachronisme, de toute dissonance dans cette évocation du passé. Cela encore est possible à l’extrême rigueur, mais combien rare, et par suite invraisemblable ! Loti n’a-t-il pas ici fait aux exigences artistiques un petit sacrifice dont lui sauront gré ses lecteurs, mais pas les psychologues ?
Il y a dans ce livre encore deux autres rêves au sujet desquels nous ne saurions répéter que des observations analogues et sur lesquels il est inutile d’insister.
Par l’usage qu’il a fait du rêve moins parcimonieusement distribué dans son œuvre que dans celle des autres auteurs, par la finesse de l’observation, par le rendu admirable de ce quelque chose à la fois intense et imprécis qui caractérise le rêve, Loti peut être cité comme un modèle : aucun autre ne saurait lui être comparé. Mais il n’a bien conçu, utilisé et fait comprendre qu’une sorte de rêve, celle qui reflète comme dans un miroir grossissant le ton émotif de notre mentalité du moment, suscite des images en harmonie avec lui et les revêt de ses nuances. Mais on ne trouve pas trace dans son œuvre de cette sorte de rêve non moins intéressante qui met en scène les événements de la vie récente et nous les montre sous un jour particulier, parce qu’il écarte les rideaux et les écrans qu’intercalent entre nous et nos pensées secrètes les scrupules de toute sorte, les préjugés, le sentiment des convenances, le respect de tout ce que nous croyons juste et licite. Il n’y a pas à s’étonner que cette forme réaliste soit restée étrangère (peut-être volontairement) à un idéaliste comme l’auteur de Fleursd’ennui.
HENRI DE RÉGNIER.
Le Passé vivant. — Comme Loti, H. de Régnier est pénétré de l’idée que les générations passées ne sont pas tout à fait défuntes [p. 247] qu’elles se survivent autrement que par les ressemblances, les tendances, les caractères légués par elles à leurs descendants. Mais la conception est différente dans le détail.
Pour lui, Jean de Franois et Antoinette de Saffry sont en quelque sorte des réincarnations de leurs grands-parents du siècle précédent ; ils recommencent et continuent la vie de ces derniers qu’ils pousseront jusqu’à un dénouement que ceux-ci ont évité. Jean de Franois finit par comprendre tout cela, mais cette conviction ne se fait jour en lui que peu à peu. A l’époque où commence le récit, ces idées fermentent en lui sous une forme imprécise dans le subconscient et elles déterminent un rêve qui se reproduit fréquemment toujours le même. Voici en quoi-il consistait ou du moins ce dont Jean de Franois se souvenait au réveil :
« Il était étendu sur le dos. Au-dessus de lui, un ciel très bleu. Comment se trouvait-il là ? Il n’en ‘savait rien. Que faisait-il ? Il l’ignorait. Il aurait voulu se lever mais il ne le pouvait pas. Cependant il lui fallait accomplir à tout prix quelque chose de très important, mais son corps lui refusait tout mouvement, et il se rendait compte que ce corps n’était pas à lui. Il demeurait ainsi longtemps, les yeux ouverts sur ce ciel d’un bleu pur ; peu à peu, insensiblement, la couleur de l’azur se mettait à changer. Elle perdait de son intensité, elle se voilait lentement. Elle passait au gris, puis blanchissait, se solidifiait, et finissait par devenir le plafond d’une chambre… Jean de Franois se sentait encore étendu comme auparavant, mais maintenant c’était bien son corps à lui qui s’étendait sur le lit. Au besoin, il pourrait se remuer, quitter ce lit où il était couché. Cette chose très importante à accomplir et dont tout à l’heure il éprouvait le regret d’être incapable, à présent ne lui serait pas impossible. Oui, mais en quoi consistait-elle ? Il lui semblait qu’il l’apprendrait un jour, mais quand, où et par qui ? Et, anxieusement, il interrogeait le silence. Les bruits de la rue et de la maison s’y mêlaient. Il eût voulu les faire taire, et tout à coup il s’éveillait complètement, le cœur battant, les membres brisés, la tête endolorie, et sans pouvoir rendormir sa lassitude… »
Ce rêve est remarquablement compris ; il contient tout ce qu’il faut et rien de trop. Il est juste par ses allures générales, par la déformation qu’il fait subir aux sentiments qu’il exprime, juste aussi par la forme sous laquelle il présente les pressentiments d’où il dérive. [p. 248]
Est-ce, chez l’auteur, conception raisonnée, observation juste, hasard ou intuition, il faudrait plus d’un exemple pour en décider.
PAUL ADAM.
Paul Adam n’est pas un rêveur. Dans son œuvre touffue et variée, l’imagination occupe une place importante, mais elle ne quitte pas la terre ; elle s’applique aux faits matériels et précis et déploie sa richesse à diversifier leurs aspects et à les peindre sous des couleurs vives. Dans toute son œuvre, je ne trouve que deux rêves, tous les deux dans L’Enfant d’Austerlitz. Le héros du livre, le petit Omer, à l’âge de six ans, entend raconter les horreurs de la déroute qui suivit la campagne de Russie ; entre autres choses effroyables, il retient cet épisode qui revient souvent dans la narration, de chevaux tombant de fatigue, sur lesquels les soldats affamés se ruent et qu’ils dépècent avec leurs dents, arrachant des lambeaux de chair crue qu’ils dévorent. Il rêve. Il est lui-même la chair d’un de ces chevaux, ou plutôt, tantôt il est la chair sanglante du cheval, tantôt il est lui-même, tantôt les deux ne font qu’un, et c’est lui que l’on mange en même temps que la chair du cheval. C’est son oncle Edme, un des héros de l’histoire, autrefois si bon pour lui, qui veut le dévorer, et cette idée suscite par association des souvenirs du conte de l’Ogre ; en sorte que c’est tantôt l’Ogre, tantôt l’oncle Edme qui s’apprête à le déchirer de ses dents, ou plutôt c’est le même personnage revêtant tantôt la figure du premier, tantôt celle du second. Par un trait dont il faut admirer la justesse, l’enfant transporte dans les visions de son rêve les sentiments que lui inspiraient les deux personnages : l’Ogre est méchant et cruel, tandis que l’oncle Edme, tout en s’apprêtant à le manger, le plaint et l’encourage en l’assurant qu’il ne lui fera pas de mal. Tout cela est pris sur le vif et on pourrait croire que le romancier a entrevu les règles vraies de la pensée onirique.
Mais le second rêve nous désillusionne et nous montre que celui-ci n’est qu’une rencontre d’intuition heureuse, de hasard ou peut-être d’observation occasionnelle. Ce sont encore les horreurs de ces mêmes déroutes qui fournissent la matière du rêve. Mais cette fois, le rêveur est la mère du jeune homme, femme très pieuse dont les sentiments se partagent entre une grande dévotion de forme assez étroite et une aversion profonde pour Napoléon 1er, auteur de tant [p. 249] de misères dont les siens aussi ont souffert. Elle se voit en enfer, mais cet enfer n’est pas seulement celui du catéchisme avec ses démons et ses flammes ; il s’y mêle une vision des horreurs de la guerre, et même ce sont elles qui fournissent la majeure partie du décor. C’est une immense cascade tombant de « hauteurs oubliées vers des profondeurs ignorées » et faite de corps déchirés, broyés, lamentables, réunissant les plus invraisemblables blessures, faisant chanter toute la gamme des souffrances possibles; el ces êtres sans cesse meurent de l’excès de leurs souffrances et revivent pour les subir à nouveau. Au milieu de ces tortures anonymes, apparaît l’auteur responsable de toutes ces misères, Napoléon ; et son mari apparaît aussi, cadavre décomposé qui reprend vie juste le temps nécessaire pour lâcher sur l’empereur une bordée de mitraille et retourner aussitôt à l’état de squelette vêtu de son casque et de son uniforme, tandis que l’empereur reprend vie lui aussi, mais pour être fusillé par les soldats du duc d’Enghien. Ce n’est pas dans un pâle résumé de ce genre que l’on peut mettre en lumière l’admirable ordonnancement de ce rêve où les visions des horreurs de la guerre se mêlent à des pages d’histoire dans des tableaux où l’artiste a su réaliser par la vérité de la peinture le sentiment d’horreur qu’il voulait faire naître. C’est précisément cette perfection des détails, cette composition studieusement élaborée constituant le mérite de ces tableaux sous le rapport littéraire, qui devient une faute grave si l’on se place au point de vue psychologique. Ce rêve est très beau, chacune de ses parties pourrait prendre place dans un rêve vrai, mais leur agencement savant est à tel point invraisemblable qu’il ne saurait se rencontrer dans le rêve, où cependant la fantaisie a tant de liberté pour se mouvoir.
JEAN LORRAIN.
Proie de ténèbres. — C’est l’histoire d’un sommeil cataleptique engendré et guéri par le magnétisme, dans lequel le patient est livré dans son rêve à l’assaut des esprits d’Assur et ces esprits ne se contentent pas de lui inspirer des visions grotesques ou terrifiantes, ils exhalent un terrible fumet de ménagerie mal tenue qui se répand dans l’air à travers les pores du dormeur. Leur relent n’est pas une fausse sensation de rêve ; il est réel et incommode si fort [p. 250] les assistants pleinement réveillés qu’il faut pour le combattre l’ouverture des fenêtres et le parfum de trois cassolettes. Faisons la grâce à l’auteur des rêves de M. de Phocas de ne pas insister sur ces puérilités.
Histoire de Masques. — Avec grande raison, on conseille d’écrire les rêves dès le réveil afin d’éviter les déformations que leur font subir le temps et les narrations successives. Celui-ci pourrait servir d’exemple pour illustrer cette proposition.
C’est un rêve d’enfant qui, ayant trop mangé, est tourmenté pendant son sommeil par des visions de casseroles, de rôtissoires, de lèchefrites, de jambons et de volailles rôties ayant pris vie et se mouvant sur deux jambes, tandis qu’ils agitent leurs bras menaçants. Et tout cela sert d’escorte à un certain revenant appelé « la reine Maritorne », qui est aux enfants gourmands ce qu’est Croquemitaine à ceux qui ont désobéi. Tout cela est fort bien, mais je défie bien un enfant de dix ans, fût-il Jean Lorrain lui-même, de mettre dans l’arrangement, les gestes et les mouvements de toutes ces figures la savante et piquante ordonnance qu’a su y mettre trente ans plus tard l’auteur de M. de Bougrelon.
M. M. de Phocas. — Prenez un homme assez riche pour n’avoir besoin de rien faire et assez sot pour ne s’être pas créé une occupation. Faites-le descendant d’une noblesse à trente-six quartiers et dégénéré, payant par l’avilissement de sa volonté et une complète débilité morale l’injure qu’ont faite à la nature ses longues séries d’ascendants en s’éloignant de la glèbe et des occupations manuelles, et vous aurez M. de Phocas. Sa tare morbide a pris la forme d’une manie singulière : il cherche des yeux d’un certain vert glauque jetant un certain éclat, derrière lesquels on lit une certaine perversité, qui le remuent, l’attirent et le repoussent à la fois et il ne trouve nulle part ce qu’il cherche pour la bonne raison qu’il ne sait pas très bien ce qu’il cherche. Ce sont encore les émaux et les gemmes qui s’en sont le mieux rapprochés. Et il va, courant le monde, traînant avec lui, comme un boulet, son infirmité. A cette manie personnelle s’en ajoute une autre, née par contagion, celle-là : les figures humaines lui apparaissent comme des masques infiniment divers, cachant tous une uniforme et monotone pourriture.
Voilà certes plus qu’il n’en faut pour faire de Phocas un rêveur ; [p. 251]
le rêve devrait constituer la moitié de sa vie et, s’il est un reproche à faire à l’auteur, c’est d’avoir trop peu usé du rêve dans cette œuvre. Mais, quand il l’a fait, c’est d’une manière tout à fait excellente.
Un premier rêve se rencontre qui, bien qu’extraordinaire en lui-même, est fort banal par rapport à de Phocas, parce qu’il n’est que la reproduction pure et simple de son obsession. Dans une ville déserte, il ne rencontre que des prostituées qui s’offrent à lui, et toutes ont un masque cachant un visage de cadavre décomposé par la putréfaction, dans lequel seules sont vivantes les prunelles glauques. Ce rêve est d’autant plus justifié, je dirais presque inévitable, que cette vision des masques est pénible à de Phocas et qu’il la repousse quand elle se présente ; et Jean Lorrain a été bien près de mettre le doigt tout juste sur ce facteur capital du rêve. Il fait dire en effet à de Phocas par Ethal : « La seule chance de guérison que vous ayez de cette obsession des masques, c’est de vous familiariser avec eux et d’en voir quotidiennement. Contemplez-les longuement, maniez-les même…. » Malheureusement, il parle de l’état de veille et non du rêve.
Bien plus remarquable est le second rêve fait sous l’influence du haschisch. Au moment où il allume la cigarette toxique, de Phocas est dans l’atelier de son ami Ethal, moelleusement couché sur des coussins ; autour de lui, vautrés, des viveurs et des femmes dans une fin d’orgie. Par le haut du châssis vitré qui lui fait face, il aperçoit dans la nuit glacée du dehors les silhouettes des maisons et des cheminées voisines, et il s’endort sous l’impression contradictoire de la tiédeur des coussins dans la maison bien close et du double frisson de terreur et de froid qu’inspirent les rues désertes d’un faubourg mal famé au milieu d’une nuit d’hiver. Peu à peu les silhouettes de la rue grandissent, envahissent tout le décor et il se trouve, toujours couché sur ses coussins, sur le trottoir de la rue sinistre et déserte. Bientôt arrivent deux ignobles apaches traînant par les cheveux une femme en tenue de soirée. (Il en a eu assez autour de lui tout à l’heure pour avoir droit à cette vision), ceux-ci terrassent la femme et, dans le ruisseau, lui scient le cou avec de mauvais couteaux, tandis que lui ne peut ni crier, ni soulever ses jambes pour se porter à son secours (l’alourdissement musculaire dû au toxique). Après un court réveil, il se sent [p. 252] emporté dans les airs, par la main puissante d’Ethal (il objective ainsi l’impression subconsciente qu’il a dans la vie réelle d’être le jouet de celui-ci), et sous ses regards défilent des paysages et des scènes d’Afrique et d’Asie (clichés-souvenirs de ses nombreux voyages). Mais la main qui le soutenait le lâche et il tombe au fond d’une crypte noire, au milieu d’un fouillis de monstres bizarres, invraisemblables, qui le frôlent, lui infligent mille attouchements horribles et finalement soumettent tout son corps à des succions énervantes qui sont autant de baisers de vampires ; et en un certain point, cette succion provoque une volupté aiguë et en même temps si douloureuse qu’elle détermine le réveil.
Tout cela est parfait, admirablement calqué sur la réalité aussi bien en ce qui concerne les lois du rêve normal que pour ce qui est relatif au rêve morbide des toxicophages. On sait en effet que le premier usage du poison détermine d’abord des cauchemars pénibles avec visions d’animaux fantastiques auxquelles se mêlent peu à peu des sensations érotiques qui finalement prennent le dessus.
Tout cela est condensé dans ce rêve unique avec tant d’art qu’on peut se demander s’il n’a pas été vécu, soit par l’auteur lui-même, soit par un de ses amis.
Dans un rêve fort court qui clôt le roman, de Phocas se trouve transporté à Bénarès où il éprouve de façon intense l’impression de calme et de recueillement si opposé à l’agitation fiévreuse des grandes villes d’Occident, qui se dégage de la ville sainte des bords du Gange. Au réveil, son parti est pris, il quittera Paris, foyer morbide et pestilentiel, et ira rejoindre son ami Welcome, qui lui a promis qu’il retrouverait dans ce nouveau milieu la santé morale avec la guérison de sa folie.
Deux points sont à remarquer, en accord l’un et l’autre avec une des plus intéressantes lois du rêve. Le premier c’est qu’il voit en songe Bénarès où, il n’est jamais allé, mais dont il vient de lire une description pleine de sentiment dans la lettre de son ami, et cela est justice, par le fait que les images mentales visuelles évoquées par des lectures peuvent prendre place à côté de celles provoquées par des sensations visuelles véritables dans le magasin de nos clichés-souvenirs ; et l’émotion que lui a inspirée dans son rêve, sa visite de Bénarès est justement calquée sur celle qu’a suscitée la lecture d’où il tire son origine. Le second est un frappant exemple [p. 253] de la vertu des rêves en tant que facteurs déterminants dans la vie réelle des actes dont ils ont fourni le tableau.
Nuit de janvier. — Une incertitude plane sur l’interprétation de ce rêve et, selon que celle-ci sera orientée dans un sens ou dans l’autre le jugement à porter au point de vue psychologique sera un acquittement ou une condamnation. A vrai dire, il n’y a pas grande incertitude, mais je veux supposer qu’elle existe, car ce sera une occasion de montrer de quelles conditions dépend qu’un rêve soit vraisemblable ou même possible, conforme ou non aux lois de la pensée onirique.
Guilloury a passé la veille avec d’anciens camarades en épanchements et en beuveries. Rentrant chez lui au milieu de la nuit, il s’endort dans son fiacre et rêve que le cocher le dépose à mi-route sur un quai désert de la Seine en face de la passerelle de Passy. Fort ennuyé et un peu inquiet, il avise un petit hôtel qu’il ne connaissait pas et remarque les détails de son architecture et de son ornementation. Il s’approche d’une fenêtre éclairée et voit, ô horreur, une femme entièrement nue, ligotée bras et jambes en croix sur une table. Un marquis en perruque qui lui tourne le dos et ne laisse pas voir ses traits, prend plaisir à la torturer en la tailladant avec un scalpel, tandis qu’un bâillon étouffe ses cris. Le lendemain, réveillé, il revient arpenter ce même quai et constate qu’il n’y a là rien qui ressemble au petit hôtel de son rêve. Mais quelques jours plus tard, feuilletant un plan illustré du vieux Paris, il y retrouve, à la même place, reconnaissable dans ses moindres détails, le petit hôtel de son rêve qui est la demeure du marquis de Sade. Ainsi le tortionnaire n’était autre que l’affreux marquis.
Bien que l’auteur n’en dise rien, je me plais à croire que Guilloury avait déjà plus ou moins longtemps auparavant, peut-être de façon distraite, feuilleté ce plan ou quelque autre semblable et que l’hôtel du marquis de Sade était resté dans quelque coin oublié de son magasin aux clichés-souvenirs. Si bien oublié était ce cliché qu’il ne l’a même pas reconnu quand son rêve le lui a représenté. Cela est parfaitement conforme aux lois du rêve. Mais si, et je crois hélas que c’est l’interprétation véritable, Lorrain veut nous faire croire que le rêve peut, par quelque évocation magique, faire apparaître devant nos yeux, tel qu’il était il y a un siècle, un objet [p. 254] que nous n’avons jamais vu et dont nous n’avons jamais rien su, c ‘est là une fantaisie peut-être bonne à nous distraire un instant, mais sans valeur aucune sous le rapport de la saine psychologie. Les amateurs de spiritisme penseront peut-être autrement ; libre à eux.
Ainsi dans les rêves, comme (c’est mon humble avis) dans l’ensemble de son œuvre considérée du point de vue littéraire, Jean Lorrain se montre très inégal. A côté de pages tout à fait excellentes, il en est de bien médiocres. C’est pour nous une bonne fortune, car cela nous fournit l’occasion de montrer par des exemples, à la fois les qualités qu’il faut imiter et les défauts qu’on doit éviter.
HUYSMANS.
En rade. — Dans ce volume, sur trois cent vingt pages, plus de cinquante sont consacrées à des rêves. C’est la preuve de la haute importace que l’auteur leur a attribuée dans son ouvrage. Et cette importance est d’autant plus grande que ces rêves, au nombre de trois, jouent, ainsi que chez Loti, un rôle entièrement épisodique. Ils ne servent à rien, ni dans l’action ni même dans la définition et l’évolution des caractères ; ils sont entièrement superflus, et si l’auteur a tenu à les mettre, c’est pour eux-mêmes. N’ayant à tenir aucun compte de connexions entre le rêve et le reste du roman, puisque ces connexions n’existent pas, il a eu toute liberté pour donner libre cours à ses conceptions et à sa fantaisie.
Le rêve intéresse Huysmans pour deux raisons. Il est féru de descriptions éblouissantes, d’images extraordinaires, de comparaisons fulgurantes et, avec un art infini, il trouve moyen d’appliquer le coloris et les exagérations de son style aux objets terrestres les plus vulgaires. Mais les rêves lui fournissent une matière infiniment plus appropriée au développement de ses qualités et de ses défauts. Ce n’est plus dans la comparaison seulement qu’il peut faire intervenir les aspects les plus extraordinaires, c’est dans la substance même de ce qu’il décrit.
D’autre part, Huysmans doit rêver beaucoup car il y a dans les rêves qu’il décrit des choses qui ne sont pas de l’invention pure ; [p. 255] il est un réalisme onirique auquel ne se méprend pas un vieil habitué des rêves comme l’auteur de ce livre. Huysmans a scruté ses rêves, il s’est complu à leur contemplation et s’est posé à leur occasion toutes les questions possibles sur leur nature et leur origine. Il faut admirer sans arrière-pensée le don puissant d’imagination qui lui a fait dresser une liste presque complète de toutes les causes de rêves imaginables, possibles et impossibles. Mais il est resté le pur littérateur trop pauvrement armé de critique scientifique pour discerner d’entre toutes ces causes, lesquelles étaient le plus en accord avec les probabilités ou même les possibilités psychologiques.
Je ne résiste pas à la tentation de citer sans y rien changer les quelques pages où il énumère ces causes.
« Et il demeura pensif, car l’insondable énigme du rêve le hantait. Ces visions étaient-elles, ainsi que l’homme l’a longtemps cru, un voyage de l’âme hors du corps, un élan hors du monde, un vagabondage de l’esprit échappé de son hôtellerie charnelle et errant au hasard dans d’occultes régions, dans d’antérieures ou futures limites ?
« Dans leurs démences hermétiques les songes avaient-ils un sens ? Artémidore avait-il raison quand il soutenait que le Rêve est une fiction de l’âme, signifiant un bien ou un mal, et le vieux Porphyre voyait-il juste, quand il attribuait les éléments du songe à un génie qui nous avertissait pendant le sommeil des embûches que la vie réveillée prépare ?
« Prédisaient-ils l’avenir et sommaient-ils les événements de naître ? n’était-il donc pas absolument insane, le séculaire fatras des oniromanciens et des nécromans ?
« Ou bien encore était-ce, selon les modernes théories de la science, une simple métamorphose des impressions de la vie réelle, une simple déformation de perceptions précédemment acquises ?
« Mais alors comment expliquer par des souvenirs ces envolées dans des espaces insoupçonnés à l’état de veille ?
« Y avait-il, d’autre part, une nécessaire association des idées si ténue que son fil échappait à l’analyse, un fil souterrain fonctionnant dans l’obscurité de l’âme, portant l’étincelle, éclairant tout d’un coup ses caves oubliées, reliant ses celliers inoccupés depuis [p. 256] l’enfance ? Les phénomènes du rêve avaient-ils avec les phénomènes de l’existence vive une parenté plus fidèle qu’il n’était permis à l’homme de concevoir ? Était-ce tout bonnement une inconsciente et subite vibration des fibres de l’encéphale, un résidu d’activité spirituelle, une survie de cerveau créant des embryons de pensées, des larves d’images, passés par la trouble étamine d’une machine mal arrêtée, mâchant dans le sommeil à vide ?
« Fallait-il enfin admettre des causes surnaturelles, croire aux desseins d’une Providence incitant les incohérents tourbillons des songes et accepter du même coup les inévitables visites des incubes et des succubes, toutes les lointaines hypothèses des démonistes, ou bien convenait-il de s’arrêter aux causes matérielles, de rapporter exclusivement à des leviers externes, à des troubles de l’estomac ou à d’involontaires mouvements du corps, ces divagations éperdues de l’âme ?
« Il importait dans ce cas, de ne point douter des prétentions à tout expliquer de la science, de se convaincre, par exemple, que les cauchemars sont enfantés par les épisodes des digestions, les rêves sibériens par le refroidissement du corps débordé et resté nu, l’étouffement par le poids d’une couverture, de reconnaître encore que cette fréquente illusion du dormeur qui saute dans sa conche, s’imaginant dégringoler des marches ou tomber dans un précipice du haut d’une tour, tient uniquement, ainsi que l’affirme Wundt, à une inconsciente extension du pied.
« Mais, même en supposant l’influence des excitants extérieurs, d’un bruit faible, d’un léger attouchement, d’une odeur restée dans une chambre, même en admettant le motif des congestions et des retards et des hâtes du cœur, même en consentant à croire, comme Radestock, que les rayons de la lune déterminent chez le dormeur qu’ils atteignent des visions mystiques, tout cela n’expliquait pas ce mystère de la psyché devenue libre et partant à tire d’aile dans des paysages de féerie, sous des ciels neufs, à travers des villes ressuscitées, des palais futurs et des régions à naître, tout cela n’expliquait pas surtout cette chimérique entrée d’Esther au château de Lourps ! »
On voit qu’il a été bien près de toucher à notre théorie du rêve et il l’aurait découverte s’il s’était plus longuement arrêté sur cette idée des « résidus d’activité spirituelle » et s’il l’avait soumise à un [p. 257] contrôle assez assidu par comparaison avec l’observation de ses rêves pour découvrir de quelle nature était ce résidu. Mais il n’a pas fait cela, il a été dominé par l’idée de tirer du rêve tout le parti possible, d’y trouver des occasions d’étaler les luxuriances de son style sans souci de la vérité. Il s’est laissé prendre à ce piège de croire que parce qu’il est la fantaisie même le rêve n’a point de règles et autorise les divagations les plus désordonnées.
Revenons aux trois rêves d’En rade.
Dans le premier, Jacques, le héros du livre, s’hypnotise en s’endormant à regarder les dessins d’une tapisserie ; bientôt celle-ci ondule, et la cloison tout entière se transforme en une nappe liquide qui se tient verticale sans s’écrouler. C’est bien là une vision de rêve et ce début est parfait. Mais pourquoi Huysmans se croit-il obligé, pour mettre devant les yeux du dormeur après ce rideau liquide, une arche de pont, puis un palais, de faire manœuvrer les décors comme ceux d’un théâtre pour faire apparaître ce qui doit occuper la scène ?
Les choses peuvent se passer ainsi dans le rêve, mais cela n’est ni nécessaire, ni même habituel ; quand une nouvelle vision hallucinatoire prend la place de la précédente, elle n’est l’esclave d’aucune logique mécanique : l’une disparaît, l’autre apparaît et voilà tout.
Puis son rêve fait surgir une scène représentant un eunuque qui conduit Esther au vieux roi Assuérus en quête d’un dernier rut. Dans ce tableau magistralement ordonnancé, il m’est absolument impossible de voir, comme Jacques, une composition née spontanément dans son cerveau, ayant pris ses éléments de droite et de gauche dans les souvenirs de lectures bibliques.
S’il en avait été ainsi, le tableau n’aurait pas eu cette excellente tenue, cette parfaite vérité historique qui le rend si beau en lui-même. Il aurait eu des parties ridicules, grotesques, stupides, détonnant au milieu du reste par l’extravagance de leur union aux autres parties. L’eunuque eût été n’importe quel autre personnage invraisemblable, raccolé par l’imagination au hasard de ses pérégrinations désordonnées. Assuérus aurait eu beaucoup de chance d’avoir les petits yeux rusés du père Antoine et Esther en place de ses seins naissants les mamelles ridées de la tante Norine. Si Jacques voit tout cela si cohérent, si parfait sous les rapports [p. 258] esthétiques et historiques, c’est qu’il a vu quelque part ce tableau tout fait, soit comme œuvre objective d’un peintre, soit comme image mentale réalisée dans son cerveau au cours de ses lectures de l’anecdote biblique ou au cours des rêveries auxquelles elles ont donné lieu. Le rêve est capable d’évoquer un tel souvenir en lui laissant toute sa perfection ; il est incapable de le composer d’éléments épars qu’il aurait assemblés lui-même. Jacques consulte ses souvenirs mais ne trouve rien qui lui permette de croire qu’il a vu cela quelque part. Eh bien j’affirme qu’il a mal cherché.
Dans ce même rêve, la relation symbolique que Jacques découvre entre la vigne aux grappes étincelantes et Esther dans sa nudité, contribuant par le toxique stupéfiant, celle-ci de ses charmes, celle-là de son alcool, à asservir le roi assyrien, est, à n’en point douter médité à l’état de veille, et frauduleusement introduit dans le rêve.
Le second rêve présente d’extraordinaires visions de paysages lunaires. C’est le moins bon des trois. Ces descriptions seraient à leur place dans un voyage de quelque Cyrano dans la lune, mais ne sauraient se rencontrer aussi parfaitement agencées dans un rêve. Les deux personnages, Jacques et sa femme, s’y conduisent trop exactement comme des gens éveillés ; tout est fantastique dans le paysage, tout est trop logique dans le jeu des acteurs. Ceux-ci n’ont oublié en rêve aucune de leurs notions de physique, d’astronomie, de physiologie ni de géographie lunaire. Ils savent ‘qu’il n’y a ni air, ni eau dans la lune et constatent que les quartiers de roche qu’ils font ébouler se heurtent et ricochent sans provoquer aucun bruit. Et je leur pardonne moins cela que la contradiction où ils tombent, en respirant à l’aise et « humant le manque d’air ». Ils s’étonnent de ne percevoir aucune odeur fâcheuse dans la Mer Putride, ils circulent sur la lune avec une aussi parfaite connaissance des lieux qu’entre la Madeleine et l’Opéra ; et cela sans qu’aucun des noms bizarres de la géographie lunaire échappe à leur mémoire. Et puis, pas la moindre discontinuité dans leurs pérégrinations. L’étrangeté réside uniquement dans la substance dont est fait le sol sur lequel ils marchent. Allons, M. Huysmans, avouez que tout cela est inventé, laborieusement élaboré sous la lampe, dans votre cabinet de travail. Peut-être avez-vous emprunté l’idée première de votre description à quelque songe [p. 259] fugace, mais les vrais éléments de votre rêve, vous êtes allé les chercher dans la carte du géographe de Gotha et dans les souvenirs d’une visite aux galeries minéralogiques du Muséum, où vous avez trouvé vos inspirations dans les cristaux aux teintes fluides, les géodes aux stalactites aiguës, les coulées de roches fondues et polies, dans les teintes émaillées et multicolores des agates, des opales vitreuses aux cassures conchoïdes et des gemmes multicolores brutes ou taillées.
D’ailleurs, si je vous cherche querelle au sujet de la science du rêve, je reste votre admirateur quand je me laisse impressionner par les richesses du style et l’originalité de l’imagination.
Le troisième rêve est de beaucoup le meilleur, et je puis presque affirmer que celui-là a été en majeure partie vécu par l’auteur du roman, qui d’ailleurs ne s’est pas gêné pour l’embellir en lâchant la bride à ses tendances outrancières.
Jacques monte un étroit escalier en spirale et débouche dans une salle où il se trouve face à face avec un personnage extraordinaire qui n’a qu’un défaut, c’est que tout en lui est extravagant d’une façon qui dénote un dessein bien arrêté de ne rien laisser qui ne soit effrayant ou grotesque : c’est une première faute, mais, bravo pour les têtes de veaux suspendues à la tringle souple des tubes acoustiques alternant avec des shakos sans visières et bravo pour les rangées de citrouilles se transformant en postérieurs de femmes jaunes qui étalent impudemment leur sexe. Vous avez pris les uns dans votre cabinet de travail, les autres à l’étal d’un marchand d’abats, ceux-ci à la devanture d’un fripier et ces dernières, j’ose le dire, dans votre collection d’images mentales d’érotomane ; et tout cela vous l’avez réuni dans le cabinet d’alchimiste de votre personnage. C’est naturel. Il est dommage que vous nous gâtiez cela par des propos de magister en us sur « les menstrues de la terre ». Bravo aussi pour les changements à vue, sans portants à coulisse cette fois, qui transportent Jacques dans cette tour des cloches avec ces déconcertants échafaudages de poutres entre-croisées et de plates-formes, reliées par des échelles qui ne tiennent à rien. Et vous aviez d’autant plus le droit d’évoquer cette vision dans vos rêves, qu’il est dans vos goûts de circuler dans les clochers des cathédrales. J’accepte aussi le sonneur cul-de-jatte assis dans son écuelle, et sa digne moitié les cottes retroussées, bien [p. 260]
que là encore vous ayez mis plus d’extravagance qu’il n’est naturel. Je n’ose pas vous contester avec trop d’assurance votre femme qui monte lentement vers les combles de votre théâtre, mordue à la hanche par un cric, avec ses orbites alternativement vides ou meublées de prunelles azurées. Tout cela est possible après tout, mais ici encore vous éliminez trop systématiquement tout ce qui serait naturel, tout ce qui serait terne.
Quant à cette tour, qui n’est qu’un puits sorti de terre elle a pu être évoquée par le souvenir du puits desséché d’où Jacques s’escrimait vainement à tirer un seau d’eau. Mais je crois bien que ce n’est pas en rêve, mais dans une élaboration active que vous avez trouvé ridée de comparer à la Vérité la vieille chiffonnière assise sur sa margelle, et surtout la trop spirituelle boutade sur les lamentables traces qu’ont dû laisser sur elle les innombrables viols que les hommes lui ont fait subir.
DansA Rebours, point de théories sur le rêve, mais ce qui est mieux, une intervention très nettement précisée d’un des facteurs de causalité. Ce rêve très probablement, est en partie réel et très certainement l’auteur l’a arrangé eu déployant ici ses qualités et ses défauts habituels de richesse dans l’invention et d’exagération dans le fait que tous les détails convergent de façon très savante à produire l’effet voulu. Ce rêve présente d’abord la syphilis, puis le coït infectant, matérialisés l’un sous la forme d’un fantôme effrayant, l’autre sous celle d’une femme qui se livre, mélange d’attirance et d’horreur. Sur celle-ci tous les indices de la syphilis jeune, commençante, débordant de sève empoisonnée ; dans celui-là toutes les tares, tous les désastres consécutifs à la syphilis ancienne achevant sa victime.
Ce qui est. intéressant ici, c’est la cause évocatrice de ces visions.
Des Esseintes a contemplé pendant la journée précédant ce cauchemar une variété infinie de plantes extraordinaires présentant sur leurs feuilles ,toute~ les apparences de taches ignobles, de dartres rougeâtres, de chancres avivés, d’ulcères suintants, tandis que leurs déconcertantes fleurs offrent les apparences les plus étranges, où l’imagination malade de des Esseintes trouve l’occasion de rapprochements inattendus avec des organes sexuels des deux sexes, formidables, menaçants, donnant le frisson. Et cela le fait naturellement penser à la syphilis qui par l’intermédiaire de ces organes [p. 261] est la grande pourvoyeuse d’éruptions et d’ulcères. Mais, ce qui est le plus à remarquer dans tout cela et que Huysmans ne voit pas, c’est que, lorsque des Esseintes a déniché ces plantes une à une chez les horticulteurs où il s’est complu, attardé à les regarder pour décider son choix, il n’en a pas rêvé, et le rêve s’est produit au contraire le soir du jour où les horticulteurs sont venus tous ensemble livrer chez lui les plantes qu’il avait choisies. Là, il les retrouve, et par suite de la convergence de leurs actions, elles l’impressionnent plus vivement encore. Il voudrait les scruter une à une longuement, se pénétrer de leur sens symbolique, mais il en est empêché par les marchands qui pressés d’achever leurs livraisons, lui en mettent sous les yeux une nouvelle dès qu’il a pointé sur sa liste la précédente.
C’est cela, c’est cette inhibition rapide et totale d’impressions violentes qui est le facteur essentiel du rêve et l’exemple est si excellent que je n’en voudrais point d’autres pour illustrer ma théorie. C’est ce qui me fait affirmer que ce rêve est en partie vrai, car une relation si exacte entre l’effet et la cause ne saurait être due au hasard ; et si Huysmans n’a pu l’introduire de propos délibéré puisqu’il ne la connaissait pas, c’est donc qu’il l’a subie.
Une dernière remarque d’un caractère plus général. Il n’est pas dans tous ces rêves racontés par Huysmans, une femme qui ne montre son sexe avec tous les détails de son aspect, ou élégant et délicat, ou ignoble et écœurant, ou trivial et quelconque ; et je vois là encore une chose artificiellement introduite par l’auteur dans ces rêves. De tels rêves ne sont pas vécus. Les choses ne se présentent pas en songe avec cette constance ; et surtout n’en est-il pas ainsi, car ce serait contraire aux règles de la théorie, chez un homme qui, ainsi qu’il est facile d’en juger par tous ses écrits, n’a pas l’air fort enclin à repousser énergiquement et vertueusement les visions plus ou moins obscènes qui hantent son imagination. Il est de toute évidence qu’il les accueille au contraire et les caresse, les évoque et les relient ; toute condition bien propre à les écarter de ses rêves. A moins cependant que l’obsession de ces idées soit si intense que malgré l’attention qu’il leur accorde pendant la veille, il leur reste encore assez d’énergie pour, encombrer ses rêves de la nuit.
Mais alors, ce n’est plus de la psychologie mais de la pathologie. [p. 262]
Après tout, il n’est pas impossible que chez Huysmans il en soit ainsi.
ANATOLE FRANCE
Jean J. Marteau. — Le rêve de Jean Marteau n’est pas sérieux et il faut le prendre, je pense, comme l’auteur l’a conçu : un amusant tour de force pour accumuler dans le plus étroit espace possible le maximum d’étrangetés, d’invraisemblances et d’incohérences que puissent enfanter un cerveau détraqué et un estomac vide. Le rêveur, a de très légitimes visions de ripaille, en mêle d’autres plus nombreuses.
C’est une suite de scènes, les unes plus ou moins gastronomiques que légitiment les crampes d’estomac du rêveur, les autres quelconques mais toujours burlesques où les caractères du rêve se trouvent bien exprimés par l’incohérence et l’inattendu de leur succession et par le fait que le héros de cette aventure poursuit avec ardeur et sans savoir pourquoi un but qu’il ignore. Ce sont bien là des caractères de rêve, mais on se ferait une idée très fausse si l’on jugeait d’après celui-ci qu’un rêve est d’autant plus ressemblant qu’il élimine plus exactement tout ce qui est naturel, vraisemblable et correctement jugé. C’est le contraire qui est vrai et celui-ci devient invraisemblable par l’accumulation des éléments burlesques et l’élimination systématique de tout ce qui serait sensé. Mais je le, répète, il ne faut voir là qu’un amusant tour de force.
Quant au long rêve de la Pierre Blanche, nous n’avons point à en parler ici, car ce n’est pas un rêve, mais un coup d’œil très réfléchi jeté, sous couleur de rêve, sur l’avenir de l’humanité/
Thaïs— Dans ce bijou littéraire, se rencontrent quatre rêves et un grand nombre de visions qui ne se distinguent de ces derniers que par leur expression représentative, car, pour le reste, causes et effets, elles n’en diffèrent en rien. Deux de ces rêves nous montrent le pauvre Paphnuce en proie à l’objet abhorré de ses désirs, qui s’introduit dans sa couche comme un succube ; cet objet est une fois Thaïs, l’autre fois une femme peinte à fresques dans le tombeau égyptien où il s’était retiré. Deux conditions primordiales légitiment ces rêves : l’obsession d’une idée et le fait que, cette idée étant criminelle, est repoussée avec énergie chaque fois qu’elle se présente. L’auteur a sûrement aperçu la première de ces [p. 263] conditions qui est suffisante à elle seule, On peut se demander s’il a saisi toute la valeur de la seconde, car elle est dans le cas présent nécessairement liée à la première et ne lui a pas été ajoutée de propos délibéré.
Par le fait même que ces rêves réunissent au delà de ce qui est nécessaire les conditions de leur- production, et par le fait qu’ils appartiennent à une catégorie fort banale, ils ne nous arrêteront pas plus longtemps. Il n’en est pas de même des deux autres.
Dans l’un, Paphnuce voit en songe une haute colonne et le Seigneur lui commande d’y monter. Au réveil, il se met en marche, rencontre une colonne et élit domicile pour des mois entiers sur son chapiteau. Si Paphnuce n’est pas le premier stylite, et, qu’il en ait connu d’autres, la suggestion onirique est toute simple. Il n’en est pas de même s’il est le premier inventeur de cette forme particulière de mortification ; l’auteur ne nous renseigne pas sur ee point. Dans ce dernier cas, il faut que Paphnuce ait simplement donné une interprétation particulière et très précise à une suggestion vague de son rêve, aidé en cela après le réveil par les circonstances et par ses méditations.
Le quatrième rêve est plus troublant. Paphnuce voit l’enfer sous la forme d’un fleuve de feu, et, dans cet enfer, il voit des courtisanes, des débauchés, des philosophes d’Alexandrie qui se promènent sur ses rives, causant et se livrant à leurs plaisirs habituels, sans paraître éprouver aucune souffrance, bien qu’ils soient entourés par les flammes et soumis par les diables aux traitements que l’on devine. Certes, voilà une idée que Paphnuce n’a pu repousser pour la bonne raison qu’elle n’a jamais pu lui venir. Une pareille image ne peut faire partie à aucun titre de ses clichés-souvenirs, pas même en y comprenant ceux qui ont pu se former dans son esprit pendant ses méditations. Faut-il donc condamner l’auteur comme ayant introduit un rêve inadmissible ? Il y a une échappatoire, et j’aime à croire que sans peut-être se l’être nettement formulée, l’auteur l’a intuitivement perçue. L’idée des supplices de l’enfer réservés à tous ceux qui vivent dans le péché est toujours présente dans l’esprit de Paphnuce, et, d’autre part, il a vu à Alexandrie Thaïs et ses amants, et aussi les philosophes païens et les chrétiens hérétiques, cueillir toutes les douceurs d’une vie de jouissance sans se douter qu’un jour ils auront à [p. 264] payer tout cela. Ces deux idées se rapprochent dans un rêve, et leur coexistence, impossible dans la réalité pour Paphnuce, peut se réaliser dans une vision onirique où la logique n’a que faire.
Saint Satyre. — Le rêve raconté ici revêt d’une façon si exacte les formes réclamées par la théorie que je préconise, que l’on pourrait se demander si l’auteur n’a pas eu connaissance de mon premier travail sur ce sujet. Mais je n’en crois rien et si je présente la chose sous cette forme c’est pour insister davantage sur cette conformité. A quoi donc est-elle due ? Uniquement, je suppose, à l’extrême pénétration, de cet esprit subtil et à ce qu’il a conçu son personnage d’une façon si vraie qu’il ne lui a prêté que des actes et des pensées en accord avec sa mentalité et avec les causes qui agissaient en lui. C’est par la subtilité de son art qu’il a atteint cette précision presque scientifique et ce n’est pas une chose peu digne d’intérêt de voir comment l’intuition artistique peut parfois atteindre la solution des problèmes scientifiques.
Fra Mino est un moine chaste et de mœurs sévères ; il a connu cependant les joies de l’amour ; mais depuis longtemps sa robe d’ascète le protège contre les tentations de la chair. Cependant un soir lui revient plus vif le souvenir d’une femme autrefois aimée. Il refoule avec énergie les pensées profanes, mais reste triste, ce qui prouve qu’elles ne sont pas bien loin. Il va prier dans la chapelle auprès du tombeau de Saint Satyre et s’endort. Or, Fra Mino n’est pas un moine ignorant et grossier ; il a de la littérature et fait alterner avec la lecture des livres saints celle des beaux livres profanes de l’antiquité, en sorte que les religions païennes et la mythologie se côtoient dans ses pensées. Les désirs éveillés eu lui par le souvenir de cette ancienne maîtresse et les visions qu’évoque ce tombeau de Saint Satyre, monument païen à peine christianisé par quelques croix surajoutées, s’unissent et se confondent pour susciter les visions de son rêve. Et il voit du tombeau sortir des nymphes et des femmes qui se poursuivent et se livrent sous ses yeux à une orgie amoureuse. Son désir contenu d’y prendre part attire enfin sur lui l’attention des faunesses ; mais le combat intérieur entre le désir de la jouissance et l’horreur du péché se traduit par une inversion de sa vision : les faunesses se transforment en horribles vieilles qui le fustigentetfinalement l’abandonnent après l’avoir inondé d’urine puante. Tout en ce rêve est [p. 265] délicieux et irréprochable jusque dans les moindres détails, sauf ce dernier trait emprunté avec un peu trop de sans-gêne à l’Âne d’Or d’Apulée. Cette urine est réelle, puisque le moine la trouve au réveil ; ce ne peut donc qu’être la sienne. La façon dont il est mouillé ne peut guère lui laisser de doute à cet égard ; et, d’autre part, la condition physiologique où il s’est trouvé toute la nuit n’est-elle pas incompatible avec cette incontinence.· Il y a là des objections auxquelles l’auteur eût mieux fait de ne pas donner prise.
Le Lys rouge. — Le rêve que-nous trouvons ici tient en quatre lignes et en lui-même, il est bien insignifiant ; mais ce qui est d’un plus haut intérêt, ce sont les réflexions que met l’auteur à cette occasion dans la bouche d’un tiers personnage.
La comtesse Martin est la maîtresse de Robert Le Ménil et elle l’aime sincèrement. Robert est d’ailleurs un écrivain de talent, parfait gentleman et tout à fait digne d’elle ; et cette liaison est de tout repos. Mais pour son malheur la comtesse appartient à cette classe d’oisifs qui, n’ayant rien à faire, emploient leurs trop longues journées, que ne suffisent pas à remplir les obligations mondaines, à interroger leurs sentiments, comme l’hypocondriaque scrute le jeu de ses organes.
L’oisiveté est mère de la littérature, disons plutôt d’une certaine littérature. Non que les auteurs de ces romans soient des oisifs, pas plus que ceux qui les lisent, mais la psychologie spéciale qui défraie leurs livres et qu’ils analysent avec tant de finesse est celle des gens qui n’ont rien à faire. Leurs héros ignoreraient ces inquiétudes morbides, ce vague à l’âme, ces désirs lancinants de donner satisfaction à des besoins artificiels, s’ils étaient obligés de travailler dur pour vivre ou si seulement ils avaient su mettre dans leur vie un intérêt ayant pour base un devoir. Je m’excuse de cette digression et je continue.
Donc, pour les raisons que je viens de dire, et à la suite d’une discussion futile, la comtesse en arrive à plaquer Robert et prête l’oreille à un autre sentiment que lui inspire M. Dechartre. Or, au moment où Robert lui semble une chose lointaine, presque oubliée, il lui apparaît en rêve dans une situation d’ailleurs assez banale, où elle fait effort pour le rejoindre, mais sans y parvenir, et l’auteur fait suivre le récit de ce rêve des réflexions suivantes. [p. 266]
« Il, (Dechartre) s’était depuis longtemps inquiété des images formées pendant le sommeil et il croyait que ces images ne se rapportent pas à l’objet qui nous occupe le plus, mais au contraire à des idées délaissées pendant le jour… » « Ce que nous voyons la nuit, ce sont les restes malheureux. de ce que nous avons négligé pendant la veille. Le rêve est souvent la revanche des choses qu’on méprise ou le reproche des êtres abandonnés, De là son imprévu et parfois sa tristesse. »
Anatole France a touché là le vif de l’explication vraie ; il se rencontre avec ceux qui ont soutenu, non sans raison, que les impressions qui alimentent nos rêves sont celles que nous avons perçues pendant que notre esprit distrait était occupé ailleurs. Mais le fond de la vérité est au delà ; les idées qui nous reviennent en rêve sont moins celles qui ont été délaissées et méprisées, c’est-à-dire en somme les indifférentes, que celles qui ont été refoulées, soit par le hasard des circonstances, soit par nous-mêmes de façon délibérée ou inconsciente.
On n’a pas le droit de lui dire que ses personnages ont eu des pensées autres que celles qu’il raconte puisqu’ils sont fictifs et qu’il est maître de leur faire penser ce qu’il veut. Mais il eût introduit dans son analyse un trait psychologique plus finement, plus profondément fouillé, et il eût approché de plus près la véritable théorie du rêve s’il eût écrit en meilleurs termes quelque chose comme ceci.
La comtesse ignorait que les idées qui surgissent pendant le sommeil sont souvent celles que nous n’osons pas nous avouer à nous-mêmes. Mieux instruite, elle se fût demandé si ce retour de Robert dans son rêve, ces efforts pour le joindre sans y réussir, n’avaient pas une signification inquiétante, et s’il n’était pas imprudent de s’abandonner à un nouvel amour sans plus se soucier de son premier amant que s’il n’existait pas. Elle aurait compris que sous son calme apparent se cachait une inquiétude qui eût dû être pour elle un avertissement.
L’Humaine tragédie. — Dans ce même livre du Puits de Sainte Claire, où se trouve Saint Satyre,sont racontés deux autres rêves : l’un, celui des Pains noirs, ne vaut pas qu’on s’y arrête. L’autre au contraire mérite toute notre attention : c’est celui de Fra Giovanni dans L’Humaine tragédie.[p. 267]
Jeté dans un cachot et à la veille d’être pendu pour avoir proclamé des vérités qui ne sont pas celles reconnues par les puissants de son siècle, Fra Giovanni voit apparaître en songe une roue gigantesque formée comme un bouquet par des banderolles sur lesquelles sont inscrites des devises relatives à la morale et à l’origine ou à la fin des choses ; et toutes ces devises se terminent par ces mots : ‘Ceci est la vérité ». Les banderolles sont colorées, toutes de nuances différentes ; il n’en est pas deux qui soient identiques et toutes les couleurs imaginables sont représentées sans ordre aucun, dans un indescriptible chaos. Et tandis que le moine regarde cette roue sans y rien comprendre, la roue se met à tourner ; d’abord lentement, puis plus vite et quand la vitesse est assez grande pour que ses diverses parties deviennent indistinctes, elle apparaît d’un blanc éclatant, comparable au disque argenté de la lune. Ainsi le moine reconnaît la vérité de cette parole du Dr Subtil, que si la vérité est blanche, cependant elle n’est pas pure.
Voilà certes un rêve ingénieux et intéressant et, du point de vue de la critique ordinaire, lui demander davantage serait ergoter. J’y consens, mais n’oublions pas que nous sommes là pour ergoter, pour traiter les plus charmantes fantaisies de l’imagination à la manière d’un juge méticuleux ct rébarbatif soumettant une thèse à son argumentation. Cela bien établi, commençons. Et d’abord, à qui s’adresse ce rêve ? Qui doit-il convaincre ? Si c’est le moine, il dépasse le but ; si c’est le lecteur, il ne l’atteint pas.
Fra Giovanni est ignorant et simple. Pour être convaincu que la vérité pour être blanche n’est pas pure, disons plutôt simple, il n’a pas besoin que l’on refasse devant lui une expérience de physique. Et celle-ci n’ajoute rien à la valeur démonstrative de l’argumentation, pour la bonne raison qu’il ignore ce qu’il y a de vrai dans cette expérience. Si les bandelettes n’avaient pas été colorées et que la roue en tournant fût devenue tout aussi blanche, il n’eût pas été moins convaincu. Or rien n’empêchait qu’il en fût ainsi, puisque nous sommes dans le rêve et non dans la réalité.
Si le rêve s’adresse au lecteur, plusieurs objections se dressent.
Ces couleurs dont sont teintes toutes les bandelettes sont ce qui rend la roue blanche. Or, elles sont indépendantes de la nature des devises morales auxquelles elles sont ajoutées et ce n’est pas parce [p. 268] que les couleurs des bandelettes se fusionnent en une teinte blanche que les devises inscrites sur les bandelettes se fusionneront pour constituer la vérité. Il y a là deux faits indépendants réunis tout au plus par une relation symbolique qui n’a pas plus de valeur démonstrative qu’une lointaine comparaison.
D’autre part, Anatole France n’ignore pas que la roue ne revêtira la couleur blanche ,que si les couleurs des banderolles sont rigoureusement dosées comme nuances et comme intensité de coloration : un fouillis de couleurs prises au hasard ne donnerait pas du blanc, pas plus que la vérité n’est la moyenne entre des erreurs quelconques. Dès lors, où est la vertu démonstrative de l’expérience ? Demandons-nous maintenant si Fra Giovanni pouvait avoir le rêve que l’auteur lui prête. Ce rêve est formé d’éléments précis et singuliers agencés d’une façon très élaborée, nécessaire pour que le but soit atteint. Or, ni ces éléments, principes de physique et propositions scolastiques, ni leur laborieux agencement ne sont dans les facultés du moine. Je sais bien que l’auteur s’est réservé une échappatoire dans les toupies colorées que font tourner les polissons de Viterbe et dans les enseignements du Dr Subtil. On pourrait admettre à la rigueur que le moine ait admiré dans ses courses-à travers les faubourgs de la ville les toupies qui en tournant devenaient blanches tandis qu’au repos elles montraient les bandes colorées distinctes. Et l’image mentale de cette vision aurait pu se superposer dans son rêve à celle de la roue et lui donner ses couleurs et son mouvement ; de même les arguments spécieux du Dr Subtil auraient pu laisser dans son esprit une trace qui se serait objectivée en rêve sous la forme des inscriptions des bandelettes. Mais avouons que ces échappatoires sont étroites, tortueuses et encombrées d’obstacles, et reconnaissons que le rêve de la roue eût été à sa place dans l’esprit d’un docteur rompu aux querelles scolastiques et doublé d’un physicien averti ; ce qui démontre par là même qu’il n’est pas à sa place dans l’esprit simple d’un moine sans culture.
Mais dira-t-on, de quel droit reprocher son caractère merveilleux à un rêve introduit dans un conte fantastique où l’on voit des anges et des diables parlant et agissant ?
Il y a deux sortes de fantastique : un, simple et naïf, relativement [p. 269] facile à manier puisqu’il n’est astreint à d’autres règles qu’à celles de l’esthétique littéraire, où l’on fait apparaître à son gré des génies, des fées et des diables qui ne s’embarrassent pas des lois de la nature (c’est celui des Mille et une Nuits et des Contes de Fées) ; l’autre, plus moderne, plus affiné et d’un maniement moins simple, dans lequel le trouble n’est pas dans les lois de la nature, mais seulement dans le cerveau isolé de l’ambiance par le rêve ou hanté par des hallucinations pathologiques. Quand on use de ce dernier, on est astreint à tenir compte des lois de la physiologie et de la psychologie.
Auquel de ces deux fantastiques ce conte se réfère-t-il ?
S’il appartient à la première sorte, je n’ai rien à objecter et me contente d’exprimer le regret que l’auteur ait eu recours à cette forme de fantastique relativement grossière. S’il appartient à la seconde, la critique reprend ses droits. Je ne tirerai pas argument, pour en décider, du pain qu’un ange apporte au moine au bord de la fontaine, car l’ange n’existait que dans son cerveau et le pain avait été sans doute oublié là par une ménagère imprudente qui a été bien marrie de ne pas l’y retrouver. Il en est de même pour le don d’éloquence mis sur les lèvres du frère par l’attouchement d’un charbon ardent. L’ardeur des convictions et la fougue du prosélytisme font de ces miracles. Mais je n’en saurai dire autant, ni de la forme pénétrante et élaborée que prennent les doutes du pauvre frère lorsqu’ils sont présentés par le Dr Subtil, ni du rêve de la roue qui n’est qu’une forme particulière et bien trop savante pour lui des inquiétudes qui se font jour dans son esprit.
Que conclure de tout cela ?
L’auteur ne nous dit pas à quelle forme de fantastique il s’est adressé, et laisse au lecteur le soin de le deviner. Plutôt que de croire qu’il n’a fait appel qu’à la première, ou qu’il a fait des fautes en appliquant la seconde, je préfère admettre que, de propos délibéré ou inconsciemment, il a fait intervenir à doses inégales les deux formes : au point de vue littéraire, c’était son droit ; au point de vue philosophique, c’est peut-être à regretter.
*
* *
De cette rapide étude, il résulte que les auteurs des siècles passés et en particulier ceux du XVIIe, ont, dans leurs œuvres, donné aux songes une place importante, mais lui ont assigné une fonction [p. 270] tout à fait en opposition avec les règles d’une saine psychologie ; tandis que les modernes, tout en se rapprochant davantage de la vérité, ont réduit le rêve à un rôle épisodique, cherchant en lui un prétexte à des descriptions, à des conceptions plus libres où l’imagination s’abandonne à la fantaisie, dégagée du souci de se plier aux règles de la vraisemblance physique ou morale. Ce rôle a été le plus souvent mal compris ainsi qu’on vient de le voir par les exemples qui ont été donnés en parcourant sous ce point de vue le roman moderne. Mais ces critiques éparses ne laisseraient dans l’esprit du lecteur qu’une impression confuse et des données incertaines. Il faut maintenant reprendre la question d’une façon dogmatique et résumer les conclusions qui se dégagent de notre travail. Nous allons indiquer ce qui est défendu, ce qui est permis, ce qu’on doit demander au rêve.
I. — CE QUI EST DÉFENDU.
Il y a deux écueils principaux à éviter : la divination et la systématisation.
a) Divination. — Ce procédé consiste à faire survenir dans le rêve des choses vraies qui se révèlent ainsi au rêveur, tandis qu’il est dans l’impossibilité de les connaître, à faire surgir dans son esprit des notions qui lui sont totalement étrangères, à lui révéler des choses qu’il ne peut pas savoir. Un excellent exemple de ce genre de rêve est celui d’Ursule Mirouet dans Balzac et aussi celui de M. Bedloe dans Edgar Poe. Il serait tout aussi abusif de faire prononcer au réveil par le rêveur des phrases d’une langue étrangère dont il n’aurait aucune notion et que son rêve lui aurait apprises.
Par contre, il est parfaitement légitime de faire intervenir, avec la discrétion appropriée, des phénomènes exceptionnels d’hypermnésie, de prémonition, tant qu’on ne leur demande pas de créer, mais seulement de retrouver ce qui est caché dans les replis de la conscience, si caché que l’examen le plus attentif à l’état de veille n’aurait peut-être pas réussi à le découvrir. Le point délicat est donc de distinguer ce qui ne peut pas se trouver dans l’esprit du rêveur de ce qui peut s’y trouver, dans un recoin aussi caché et sous un déguisement aussi trompeur que l’on voudra, comme le [p. 271] lieu où était caché le testament dans le rêve du document retrouvé, de Macario.
b) La systématisation peut prendre deux formes aussi fautives l’une que l’autre. L’une est la systématisation de l’ordre, l’autre celle de l’incohérence.
La première est un défaut très commun dans ce que j’ai appelé le rêve littéraire, c’est-à-dire dans celui qui, négligeant tout souci de vraisemblance, n’a d’autre préoccupation que l’effet littéraire, la beauté artistique. L’auteur le compose comme un tableau qu’il soigne et retouche jusqu’à ce qu’il n’y ail plus un trait, plus un détail qui ne concoure à l’effet cherché. Tel est le rêve montrant Esther présentée à Assuérus dans En rade de Huysmans ; tel aussi celui du Pape de V. Hugo ; celui de l’enfer dans l’Enfant d’Austerlitz de Paul Adam ; et tant d’autres, car l’espèce en est fort commune.
La seconde forme de systématisation fautive est moins fréquente ; elle n’est pas moins éloignée de la vérité. Elle consiste à écarter du rêve tout ce qui est ordinaire, raisonnable ou simplement terne ou banal, pour n’y laisser que ce qui est incohérent et saugrenu. On croit que, ces caractères étant fréquents dans le rêve, plus on en mettra, plus on approchera de la vérité. Faire ainsi. c’est attribuer au rêve une aptitude au discernement qui ne lui appartient pas, car il en faut autant pour exclure rigoureusement toute cohérence que pour écarter toute incohérence. C’est à peu près comme si l’on disait qu’invité à choisir dans un sac plein de boules rouges gagnantes et de noires perdantes, si un voyant choisit les rouges sans erreur, un aveugle ne prendra que les noires. Un bon type de ce genre de rêve est fourni par le rêve de Jean Marteau d’Anatole France. A un degré moins excessif, on le retrouve dans l’Ange du bizarre d’Hoffmann et dans le troisième rêve d’En rade de Huysmans.
De même lorsqu’on fait raisonner le rêveur, il ne faut le faire ni esclave de la logique de l’homme éveillé, ni entièrement étranger à elle. Mon rêve des deux horloges (voir chapitre X) fournit un bon exemple du caractère mixte que présente d’ordinaire le rêve sous ce rapport.
Par contre, le ton émotif peut être systématisé dans une direction unique. Cela tient à ce qu’il est surajouté aux tableaux de son [p. 272] rêve par le dormeur qui le reçoit d’une autre source, soit psychique, soit corporelle (cœnesthésie).
Faisons remarquer que les rêves se développant très longuement sur un même thème sont exceptionnels. On ajouterait à la vérité dans les cas où cette longueur serait nécessaire en coupant le rêve de courts réveils et en ne raccordant pas avec trop de précision les fragments dont il serait composé,
II — CE QUI EST PERMIS.
La tolérance du rêve est presque infinie ; une interdiction absolue, deux ou trois défenses relatives, et c’est tout. A cela se réduisent en somme les interdictions du paragraphe précédent. Tout le reste est permis. En fait de tableaux isolés, il n’en est guère qui ne puissent prendre place dans un rêve, puisqu’il suffit que ces éléments ne soient pas totalement étrangers au rêveur. Tous les processus psychiques, l’attention, l’imagination, la mémoire, le raisonnement, l’idéalisation, la matérialisation, la symbolisation, les cérébrations inconsciente, automatique et même créatrice, toutes les émotions, tous les sentiments y peuvent trouver place et dans les conditions les plus variées, conformes ou opposées à celles de l’état de veille. On y peut délester ses amis et ses proches, sympathiser avec ses adversaires et perpétrer les actes les plus odieux ; rappellerai-je ici ce vieux Garibaldien qui avait Napoléon III en horreur et se réveilla un jour écœuré de s’être livré en rêve sur sa personne à des pratiques de sodomie. On y peut retrouver des souvenirs perdus et créer même des compositions artistiques ou scientifiques qui ne sont pas sans valeur : cependant, il ne faudrait pas abuser de cette dernière permission, car ce sont là des faits exceptionnels.
La difficulté est moins d’écarter ce qui est inadmissible que de faire bon usage de ce qui est licite pour donner au rêve ce je ne sais quoi qui distingue le vrai du faux, le vécu de l’imaginé, le réel de l’artificiel. Mais pour cela il n’y a point de recettes précises à fournir ; c’est en s’observant et en lisant, en méditant les observations bien faites que l’on s’y fera la main. Tout réside dans un dosage convenable du banal et de l’imprévu, du correct et du saugrenu, du coordonné et de l’incohérent, du logique et de l’absurde, [p. 273] du terne et du brillant, du vu et du pensé, de l’exprimé et du sous-entendu, etc., dosage qui, tout en étant extrêmement élastique, demande un certain doigté.
Ill. — CE QU’ON DOIT DEMANDER AU RÊVE.
Le rêve joue dans le roman un rôle très médiocre ; c’est une mine peu exploitée et je dirai que c’est grand dommage, car elle contient de merveilleuses richesses. Les romanciers se sont contentés jusqu’ici de demander au rêve des sujets de descriptions brillantes où ils puissent lâcher la bride à leur imagination ; tout au plus l’ont-ils utilisé en outre pour exprimer le ton émotif qui émane des personnes et des choses. Ils ont plus et mieux à faire ; ils peuvent s’en servir pour jeter des clartés sur le caractère des personnages en dévoilant leurs sentiments secrets, pour faire pressentir, deviner les événements, les dénouements, d’une façon plus élégante et moins laborieuse que par les procédés habituels. Rappelons leur que le rêve, tel un subtil Asmodée, soulève les couvercles des crânes, fouille dans le creux des circonvolutions cérébrales, pour y trouver des pensées si secrètes que la méditation la plus approfondie ne les aurait pas découvertes. Ces pensées pourront rester cachées au rêveur sous leur déguisement de visions d’un intérêt tout platonique et sans conséquences; mais l’auteur pourra montrer leur signification intime.
Qu’on lise ici les histoires de Durand et de Dupont au chapitre XV de cet ouvrage (4), elles illustreront ma pensée mieux que de longs développements.
Tout en tirant ainsi parti du rêve pour son œuvre, en vue d’effets habilement combinés, le romancier devra répandre dans le grand public cet enseignement que le rêve peut nous apporter deux biens aussi utiles que les richesses matérielles : des conseils et des consolations. Il fera connaître le rêve prophétique, non le prophétique enfantin des anciennes tragédies, mais ce prophétique scientifique ayant ses racines dans la psychologie biologique et dont j’ai rapporté ou présenté maints exemples au cours de cet ouvrage.
Il devra montrer aussi que le rêve peut être une source de consolations pour les déshérités de la vie. Combien d’infortunés, [p. 274] rudoyés dans la lutte implacable pour l’existence, ne connaissant des réalités objectives qu’amertumes et déboires ou tout au moins coulant une vie monotone et sans joies, pourraient trouver dans les rêves des compensations à toutes ces misères s’ils savaient les leur demander. Que l’on se reporte à la pauvre paysanne russe dont il est parlé ailleurs ou, pour ne pas quitter le roman, que l’on aille demander son avis sur ce point au pauvre Sylvestre dans « l’Antithèse » de T. Henvic.
Nous avons développé ce thème dans d’autres parties de ce livre ; mais ce n’est pas dans les ouvrages philosophiques du genre de celui-ci que le grand public ira chercher ces utiles enseignements : c’est au romancier à les lui montrer, à les lui faire toucher du doigt ; et par là, il ouvrira un nouveau chapitre dans l’histoire de sa mission éducatrice.
YVES DELAGE
Notes
(1) Cet article est un chapitre détaché d’un livre sur le Rêve, qui doit paraître prochainement : cette indication est nécessaire pour rendre intelligibles certains renvois et allusions à d’autres parties de l’ouvrage. Deux autres chapitres ont paru dans les mêmes conditions dans la Revue philosophique (voir les numéros d’octobre 1915 et de janvier 1916).
(2) Voir Revue philosophique, janvier 1916.
(3) C’est ce chapitre qui a été publié dans le numéro de janvier de ce périodique.
(4) Voir Revue philosophique, janvier 1916.

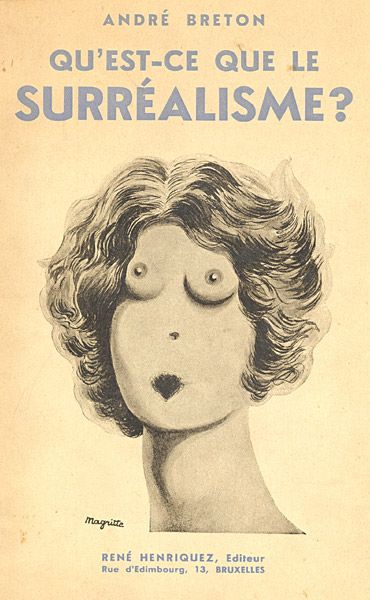
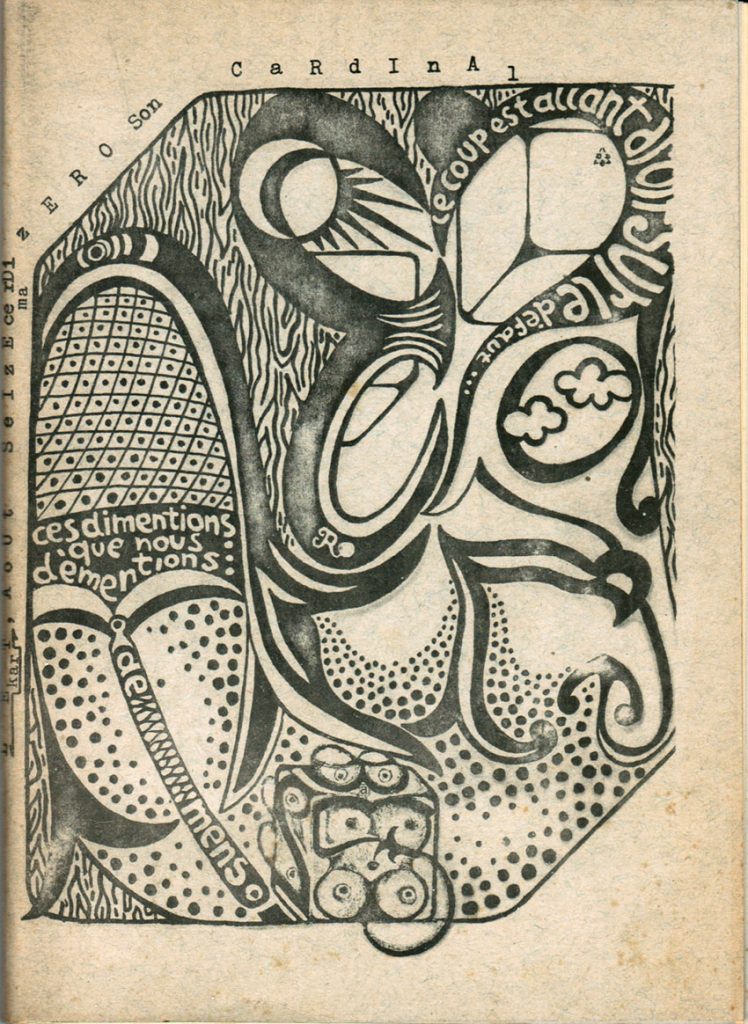
LAISSER UN COMMENTAIRE