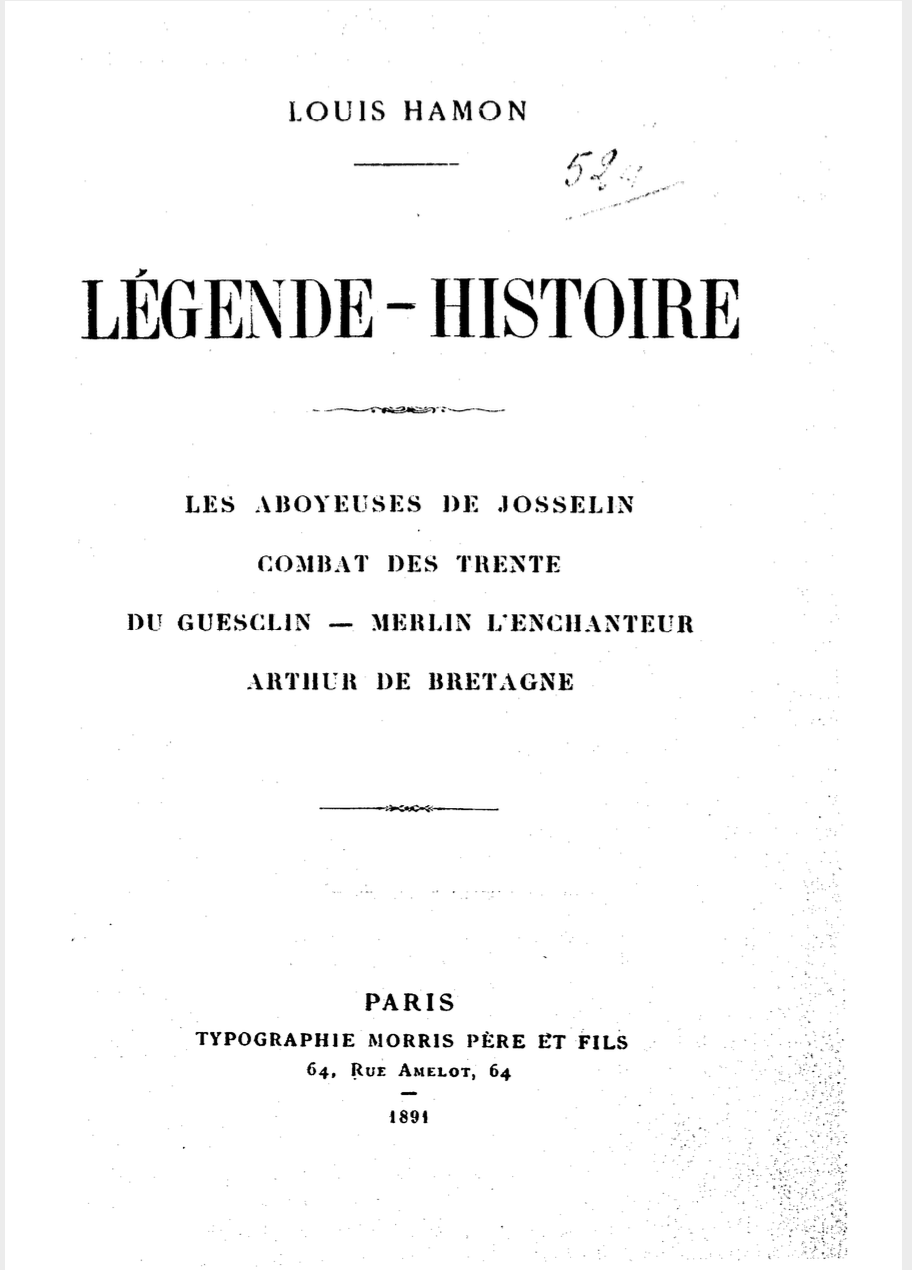 Louis Hamon. Les Aboyeuses de Josselin. Extrait de « Légende-Histoire. Les aboyeuses de Josselin — Combat des Trente. —Du Guesclin — Merlin l’Enchanteur — Arthur de Bretagne« , (Paris), 1891, pp. 1-33.
Louis Hamon. Les Aboyeuses de Josselin. Extrait de « Légende-Histoire. Les aboyeuses de Josselin — Combat des Trente. —Du Guesclin — Merlin l’Enchanteur — Arthur de Bretagne« , (Paris), 1891, pp. 1-33.
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr
[p. 1]
LES
ABOYEUSES DE JOSSELIN
Josselin est un chef-lieu de canton du Morbihan, à douze kilomètres de Ploëmiel célèbre par le Pardon de Meyerbeer. Celui de la localité est un mythe. Il n’y en a pas, du moins dans l’acception bretonne du mot, qui signifie assemblée, fête régionale et correspond à ceux de kermesse, ducasse usités dans le Nord.
La ville de Josselin a été célèbre au Moyen âge à l’époque de la longue rivalité de Charles de Blois et de Jean de Montfort et elle a défendu glorieusement l’honneur national dans cent combats livrés aux soldats d’Angleterre qui l’assiégeaient. [p. 2]
C’est de là que partirent les chevaliers bretons, allant se mesurer avec leurs adversaires du camp anglais dans ce duel à mort connu sous le nom de Combat des Trente. La lande où eut lieu la sanglante mêlée est à mi-chemin de cette ville et de Ploërmel, occupée alors par les Anglais, d’où le nom de Mi-Voie donné à cet endroit. J’en parlerai plus longuement tout à l’heure ainsi que de quelques autres sites pittoresques de ce charmant pays.
On désigne par le nom d’aboyeuses des femmes, des malheureuses qui, sous l’empire d’une certaine agitation nerveuse, jettent de petits cris rauques assez semblables aux grognements du chien. Peu à peu la voix s’éclaircit et s’épand en appels sonores, précipités, aigus comme les notes du clairon ; cela devient un véritable aboiement dont le timbre s’élève par degrés avec la progression de la crise.
Après la période de paroxysme l’intonation baisse et s’exhale en une sorte de hurlement plaintif qui rappelle celui du chien en détresse ; ainsi la créature humaine a, comme la bête, dans le gosier, la gamme complète : elle grogne, aboie, hurle. Malgré la ressemblance on pense bien qu’il [p. 3] n’y a pas similitude ; son aboiement diffère essentiellement de l’autre par l’accent, moins pur, j’allais dire moins vrai, et qui reste quand même un cri humain. Tel qu’il est, néanmoins, il suffit pour justifier le nom qu’on donne à ces misérables femmes.
Toutes celles que j’ai vues étaient d’un âge mûr. Les aboyeuses ne se montrent qu’à Josselin et aux fêtes de la Pentecôte. On ne voit pas d’hommes t>feints de leur mal.
J’expliquerai cette singularité.
Ce jour-là, il se passe la chose du monde la plus extraordinaire qu’on puisse imaginer. C’est un spectacle unique qui impressionne vivement. On amène les aboyeuses à l’église et, de gré ou de force, on leur fait baiser un reliquaire placé dans l’un des bas-côtés, près du maître-autel. C’est une croyance ancienne dans le pays que, par le secours de cette pratique, elles sont guéries du mal terrible qui les possède.
Leurs conducteurs, des gars, jeunes, vigoureux, ont peine à accomplir cette tâche. La patiente résiste, se fait traîner. Rendue furieuse par la contrainte, elle cherche à frapper, à mordre. C’est une lutte acharnée où elle succombe inévitablement. [p. 4] bien qu’ils n’aient jamais recours aux voies de lait. C’est même un étonnant spectacle que ce contraste offert par l’exaspération de l’une et le calme imperturbable des autres. [p. 5]
LE DRAME
Je devrais dire le martyre. C’est la Pentecôte ; la nature est en fête ; elle a changé sa sombre et triste parure de l’hiver pour ses gracieux atours du printemps. Les champs verdoient ; dans les frais sentiers s’épand le parfum des violettes et de l’aubépine en fleurs. Les arbres agitent gaiement leur feuillage naissant. Les cloches de la vieille église, oubliant leur âge, tintent joyeuses. Il est six heures du matin. Les fidèles accourent en foule à la première messe. Tout à coup l’air retentit de cris de détresse. C’est une aboyeuse qu’on amène. Tenue par deux gars à la longue chevelure, aux larges braies, elle lutte avec énergie sur le chemin [p. 6] poudreux. Son visage est mouillé de sueur, sa voix grogne sourdement. Le trajet pour arriver jusqu’à la relique est long. Elle en profite et redouble d’efforts. Poussée brutalement, elle tombe sur le sol ; ils la relèvent et le calvaire recommence. Exaspérée par la souffrance, elle bave et jette ces appels désespérés qualifiés d’aboiements. Ses guides restent impassibles, mais ne lâchent pas leur proie. Ils se cramponnent à la malheureuse dont les vêtements sont tout déchirés. L’église est proche. D’un élan suprême ils l’entraînent jusqu’au seuil du parvis.
Là se livre un dernier combat. Il faut gravir les hautes marches de granit. Le corps rejeté en arrière, suspendue dans le vide, elle défie encore ses bourreaux, qui ont grand’peine à la retenir et à empêcher qu’elle ne tombe, les attirant dans sa chute. La victoire leur reste. Domptée, anéantie, livide, elle s’affaisse. Sa face est souillée de poussière, de ses yeux éteints coulent de grosses larmes. Elle fait pitié. Jetée contre le reliquaire, elle l’embrasse, inconsciente, hurlant d’une manière faiblement plaintive et sa voix, brisée par la lutte, expire en un dernier hoquet. La voilà calmée.
De fait, elle cesse d’aboyer. Épuisée par la crise
[p. 7-8]
[p. 9]
elle n’a plus la force de se tenir debout. On l’assied sur une chaise. Dans cette position elle est curieuse à observer : nulle conscience de son être; allongée plutôt qu’assise, ses bras pendent inertes perpendiculairement au corps, immobile. Son visage, d’une pâleur mortelle, est inondé de sueur ; ses yeux se ferment sous l’empire d’une force irrésistible, sa bouche, demie-close, laisse échapper des hoquets intermittents. On dirait qu’elle dort, soumise à un rêve.
Saisissant est le contraste de sa figure calme et de ses vêtements en désordre. Dans sa lutte avec les paysans sa coiffe de tulle s’est défaite ; le châle de couleur crue, qui abritait sa poitrine, croisé par devant, s’est dénoué laissant voir sa chemise sous laquelle s’agite le sein avec une palpitation saccadée.
Cela se nasse pendant la messe, qui n’est nullement interrompue malgré ce désordre. Les assistants continuent de prier et elle s’achève dans un recueillement absolu. Celle-là finie, une autre recommence et ainsi de suite.
Peu importe que l’aboyeuse gêne la circulation des fidèles cherchant à gagner leurs sièges ou sortant en foule de l’église. Nul n’y fait attention. On [p. 10] s’écarte avec soin du passage qu’elle encombre, calme, indifférent et c’est là ce qui constitue la singularité de cet émouvant spectacle. Seuls les gars qui l’ont amenée l’observent. Lorsqu’ils supposent qu’elle a pris suffisamment de repos ils la conduisent hors de l’église.
Avant de la quitter disons que l’autel où est placé le reliquaire se trouve au fond du bas-côté gauche. Un autre lui fait pendant à droite ; au milieu est celui où se célèbrent les principaux offices. Richement orné, il a un air imposant. Le reliquaire a la forme d’un coffre de petite dimension ; il est carré, chacune de ses faces est close par une vitre.
A un demi-kilomètre de l’église se trouve une fontaine placée sous l’invocation de la Dame du Roncier. C’est là qu’est amenée l’aboyeuse. L’air extérieur l’a ranimée ; elle marche docilement, mais avec inertie. On lui fait boire de l’eau de source puisée dans une écuelle de bois. Alors seulement elle est libre. Elle se sauve, honteuse.
Au cours du voyage de ces femmes à l’église et ensuite à la fontaine quelle est l’attitude des gens du pays? Indifférente comme celle des fidèles pendant la messe. Ils s’écartent doucement de son [p. 11] chemin, sans manifester de surprise ni d’émotion et finissent tranquillement leur course ou leur promenade. Malheur à l’imprudent qui aurait l’idée de porter secours à l’aboyeuse : saisi par vingt mains robustes il serait vite terrassé, foulé aux pieds.
Pendant la libation à la fontaine de nouvelles aboyeuses sont menées à l’église par de nouveaux paysans et la scène que j’ai décrite se renouvelle à chaque conduite. Ce spectacle attire à Josselin beaucoup d’étrangers. J’en ai été témoin. Il impressionne vivement et d’une manière d’autant plus forte que le paysage servant de cadre à ce dramatique tableau a une poésie à la fois sauvage et tendre bien en rapport avec le sujet. En Bretagne, mais plus particulièrement à Josselin et aux environs, sentiers, arbres, plantes ont un aspect recueilli et comme mystique qu’on ne retrouve nulle pari. Les cours d’eau même, dans leur épanchement silencieux, offrent ce caractère, conforme, d’ailleurs, au naturel des habitants. Dans leur joie ceux-ci ne sont jamais absolument gais et leur tristesse a une douceur, une résignation qui donnent à son expansion une pénétration particulière.
Cela vient de ce que l’homme de race celtique [p. 12] ne s’isole jamais de l’humanité. Lettré ou non, qu’il médite, converse ou chante, il songe toujours à son prochain. Il se dit que s’il y a des gens qui jouissent, il y en a d’autres qui souffrent et cette pensée qui l’obsède constamment, qui fait le fond, l’essence même de son caractère, donne à sa causerie et à ses chants cette allure mélancolique qui a tant d’attrait.
La fontaine du Roncier mérite quelque attention. C’est une grotte étroite et haute, adossée à un petit monticule. Tout est rustique, le lieu et le sanctuaire.
Au milieu de la cavité, sur une colonne grossière, est la statuette de la sainte. Le sommet de cette grotte a la forme d’un cintre ; il est recouvert de plantes incultes, de lianes, de ronces retombant en gerbes attristées le long des parois. Au-devant est un bassin de pierre. L’eau y coule lente, claire avec une teinte blonde. Sur le rebord circulaire de la margelle sont des écuelles remplies en prévision de la visite des aboyeuses. Une vieille femme garde ce lieu désert situé au croisement de deux sentiers étroits. La colline qui surmonte la grotte est plantée de pins.
Cette solitude ne manque pas d’un certain [p. 13] charme. Son aspect fait rêver ; c’est l’effet que produit assez généralement la vue des sites de la Bretagne. Même lorsqu’ils flattent l’œil, qu’ils sont riants et gais, ils ont un cachet de mélancolie qui attendra l’âme et y répand la rêverie. Aussi la mémoire en conserve-t-elle longtemps le souvenir. C’est ce caractère, particulier aux paysages de l’Armorique, qui séduit les poètes, les artistes et fait que la plupart d’entre eux ont une préférence marquée pour cette partie de la France.
Tel n’est pas celui de la grasse et plantureuse Touraine, étalant sans pudeur, avec un orgueil d’elle-même justifié, ses luxuriantes beautés, collines ombreuses superposées, fleuves sinueux, vallons fleuris. Assurément tout cela est pittoresque, plein de poésie, mais ne vaut pas pour les âmes sentimentales les contrastes heurtés, imprévus qu’offre à chaque pas la nature à la fois tendre et sauvage des sites bretons.
Faut-il un parallèle ? La Touraine peut être comparée à une jolie femme éprise d’elle-même et fière de sa beauté. Orgueilleuse de ses somptueux atours, elle les montre complaisamment pour qu’on les admire: voluptueuse, elle se plaît à inspirer la volupté. Dans cette nature uniformément gracieuse [p. 14] nul obstacle à la vue ou aux pas du voyageur. L’harmonie, tel est son suprême cachet, harmonie d’horizons, de teintes, de niveaux, d’atmosphère et l’éclat de sa merveilleuse parure est encore rehaussé par la complicité de son ciel toujours obstinément pur.
A tant de charmes s’en ajoute un dernier : l’abondance de ses cours d’eau. La Touraine en compte quatre principaux dont un fleuve : la Loire, le Cher, la Vienne et l’Indre, qu’embellissent les admirables châteaux accumulés sur leurs rives.
Bien différente est la rude Armorique. Nature pudique avec une pointe de malicieuse coquetterie, elle dispute pied à pied ses charmes aux touristes et ne s’abandonne finalement qu’à ceux qui ont su mériter cette faveur par une longue et patiente exploration.
Comme pour exciter leur zèle, elle met en œuvre toutes les ressources que lui fournissent les inégalités de son sol et les contrastes de son originale constitution, accumulant à plaisir sur leur route les obstacles de toutes sortes : côtes à pic démesurément longues, champs palissades de terre et d’arbres, véritables camps retranchés qu’il faut emporter d’assaut, sentiers tortueux obstrués de [p. 15] branches entrelacées, ravins pierreux, montagnes abruptes, en un mot mille empêchements qui font qu’on arrive rarement sans peine au site cherché.
Mais aussi combien est grand le dédommagement offert au visiteur qui a eu la patiente ténacité de les surmonter. A l’extrémité d’une lande inculte ou d’une falaise escarpée apparaît tout à coup à ses regards, sans transition, comme dans un changement de décors, une autre nature, riante et poétique : ici, au fond d’un val abrité de saules, un lac dormant enfoui sous les hautes herbes ; là, un limpide cours d’eau offrant sur ses bords l’opposition de deux genres absolument contraires : à droite, une muraille de rochers surmontés de pins altiers ; à gauche, des prés fleuris, des collines boisées étagées en amphithéâtre et se perdant dans les nuages ; plus loin, une pittoresque éminence qui semble terminer l’horizon et tout au contraire cache un nouveau paysage assis dans un pli de terrain, en contrebas, avec un lointain fouillis de maisonnettes, de clochers ensevelis dans l’ombre ou noyés de lumière.
Voilà la Bretagne !
Revenons à nos aboyeuses :
Mais, dira-t-on, ces femmes, qui se refusent à [p. 16] suivre leurs guides, les bousculent, écument et mordent, ressemblent singulièrement à de vulgaires épileptiques. Il me parait, en effet, que telle est la nature de leur maladie, seulement la surexcitation nerveuse affecte plus spécialement les muscles du gosier. En fait, la crise montre absolument le caractère des affections épileptiformes. Faible au début, elle augmente progressivement par la contrainte exercée sur l’hystérique et décroît insensiblement avec ses forces.
Chose curieuse, pendant les deux jours que j’ai passés à Josselin, en pleines fêtes de la Pentecôte, assidu aux abords de la vieille église, de façon à ne pas perdre un détail du spectacle offert par la conduite des aboyeuses, je n’en ai pas vu une seule qui parût jeune et jolie. Toutes annonçaient un âge au niveau de la quarantaine. Vêtues en paysannes elles avaient l’allure pesante, les traits abattus, presque flétris. Quelques-unes avaient des rides.
Il ne serait pas impossible que la maladie nerveuse dont elles souffraient eût produit dans leur attitude et sur leur visage cette vieillesse anticipée. Cette transformation n’avait pas dû se faire tout d’un coup, mais progressivement, s’accentuant avec le mal. [p. 17]
On sait quels ravages opère l’épilepsie sur l’organisme. Elle creuse les yeux, plisse le front, déprime la bouche, sèche la peau, blanchit, raidit les cheveux, et ce travail de destruction est lent comme l’eau à user le granit.
J’ai entendu des étrangers, spectateurs de la venue d’aboyeuses à l’église, émettre l’idée qu’il pouvait bien y avoir tant chez ces femmes que chez leurs conducteurs une certaine dose de supercherie ; que les unes et les autres s’entendaient pour tromper le public. C’est qu’ils n’avaient pas suivi, comme il l’aurait fallu et comme je l’ai fait avec mes compagnons de route, le calvaire des énervées dans toutes ses phases, depuis le départ du foyer domestique jusqu’au voyage à la fontaine du Roncier ; autrement ils n’auraient pas eu cette pensée. Je suis d’une opinion toute contraire.
Non, il n’y a pas de supercherie dans cette scène longuement tragique que j’ai narrée. La lassitude des aboyeuses, leurs membres raidis, leurs visages crispés, leur rébellion et la prostration qui la suit ne sont pas de vains simulacres. C’est une poignante réalité.
La sincérité des gars qui accompagnent ces malheureuses dans leur douloureux chemin de [p. 18] croix me paraît aussi évidente. Encore une fois il suffit de les voir. Ils ont bien la patiente attitude et le visage sévère d’hommes accomplissant sans passion, sans colère ce qu’ils considèrent comme un devoir. Là réside précisément l’intérêt de cet étonnant spectacle.
J’ai dit qu’une vieille croyance attribue au baiser de l’aboyeuse sur le reliquaire le don de la guérir. Le lecteur soupçonne, j’en suis sûr, qu’il y a une légende. Eh ! oui, point de vraie Bretagne sans cela. La voici. Elle servira à éclairer certains points du récit, obscurs pour qui ne la connaît pas. [p. 19]
LA LÉGENDE
Un jour, quand les chênes qui ont servi à construire les plus grands vaisseaux de Lorient n’étaient pas encore des glands, des femmes, des environs de Josselin, lavaient à un douez (sorte de mare) au bord d’un chemin. .Une mendiante, courbée par l’âge, leur demanda l’aumône. Loin de l’accueillir elles la chassèrent en l’outrageant. La pauvresse insista. Furieuses, elles lancèrent un énorme chien qui les gardait. Tout à coup l’étrangère se transfigura ;ses haillons se changèrent en vêtements étincelants de pierreries ; les rides de son visage s’effacèrent et, leur montrant une figure resplendissante de gloire et de beauté, elle dit : [p. 20]
« Femmes inhumaines, je suis la Vierge Marie. Vous êtes sans pitié pour l’infortune. Je vous condamne vous et votre postérité à aboyer comme ce chien que vous avez lancé contre moi. » Et elle disparut dans un nuage. Une autre légende rapporte que, prenant en pitié leur désespoir, elle permit qu’à la Pentecôte ces malheureuses pourraient obtenir la rémission de la peine, à condition d’aller en pèlerinage à l’église de Josselin. Cette faveur devait s’étendre à leur descendance féminine, mais après une année d’expiation.
Ainsi, d’après la tradition, les aboyeuses seraient les rejetons de cette race maudite.
Le temps des légendes est loin. Notre siècle réaliste goûte peu les fictions. Je suis d’avis de ne pas en médire. Quand elles ne serviraient qu’à charmer nos loisirs, calmer nos ennuis, elles auraient du bon. N’oublions pas qu’elles ont bercé notre enfance. Et puis ces contes, souvent, sont de l’histoire, embellie voilà tout ; tels ceux du paladin Roland, mort à Roncevaux, du roi Arthur ou Artus et de son fidèle conseiller l’enchanteur Merlin. D’autres, sous la forme de spirituelles allégories, d’ingénieuses paraboles, contiennent de hauts enseignements, d’admirables moralités, par exemple [p. 21] les légendes des Lavandières de nuit, de Gralon, roi d’Is et de son horrible fille. Celle des Aboyeuses enseigne le culte de la vieillesse, le respect du malheur.
Elle s’est conservée comme un tendre souvenir chez les campagnards des environs de Josselin. L’homme a l’amour inné du merveilleux, du surnaturel, et ce penchant grandit dans la solitude. Or, tel est le genre d’existence des paysans du Morbihan, que leur humeur mélancolique, taciturne, éloigne instinctivement du commerce des autres hommes.
La légende facilitera au lecteur la compréhension du drame des Aboyeuses. D’abord, elle explique l’impassibilité des gars en présence de leurs révoltes et aussi l’indifférence du public.
Les uns ont la conviction d’accomplir une œuvre pieuse, car à leurs yeux ce sont des possédées. Il s’agit de chasser de leur corps le démon qui l’agite, aussi quel calme ils montrent ! Elles ont beau se débattre, se tordre, ils ne bronchent pas. Leur visage ne trahit aucune émotion ni colère ; ils sont inflexibles comme le devoir : tel le chirurgien au chevet du patient qu’il opère.
Quant au public, outre le respect de la tradition, [p. 22] il y a chez lui l’habitude : familiarisé avec ce spectacle, il ne s’en émeut pas et finit par n’y prêter aucune attention.
L’indifférence des fidèles à l’église s’explique par les mêmes raisons. Cette scène de l’épileptique qui crie, bouscule les assistants, renverse les chaises, ils l’ont vue vingt fois et n’en sont pas étonnés. N’importe ! pour l’étranger elle est saisissante. Il sort, se demandant s’il n’a pas rêvé.
L’absence de ce spectacle, les autres jours que celui de la Pentecôte, provient aussi des causes sus-indiquées. Ce n’est pas l’époque fixée pour la guérison. Inopportune, l’épreuve à laquelle on soumettrait ces femmes n’aurait pas d’efficacité. Il est présumable qu’en temps ordinaire elles vivent confondues dans la foule, vaquant en paix aux travaux des champs ou aux soins du ménage. Vienne la crise, elles s’enferment et l’endurent en silence, convaincues qu’on ne viendra exercer sur leur personne aucune contrainte.
J’ai dit qu’elles sont de la campagne. Où va-t-on les chercher ? Dans leur domicile, sans doute, connu ainsi que leur infirmité ; dans nos campagnes il y a entre les habitants une communauté intime d’habitudes, de sentiments, d’intérêts. Chacun d’eux [p. 23] connaît les affaires de son voisin, et puis il y a la légende, qui fait d’elles des créatures marquées du sceau de la fatalité dont il faut que l’inexorable loi s’accomplisse.
Encore une fois, c’est une croyance générale que la guérison de ces femmes n’est possible qu’à la Pentecôte. Pour cette raison elles sont l’objet continuel de l’attention publique ; il est même probable qu’elles sont surveillées étroitement par les paysans, qui croiraient manquer au plus impérieux des devoirs en ne les soumettant pas, en temps propice, à la fatale épreuve et qu’aux approches de l’époque indiquée ils redoublent de vigilance, de façon à être prêts quand l’heure du sacrifice aura sonné.
Terrible doit être pour l’aboyeuse l’instant où ils lui apparaissent, calmes dans leur mâle beauté, inflexibles dans leur brutale résolution. Hauts de taille, robustes, silencieux, ils sont bien les dignes instruments du Destin. Leur costume imposant, leur longue chevelure tombant majestueusement sur l’épaule augmentent encore l’impression de la victime. Il y a là un émouvant sujet de composition picturale.
J’incline à croire que la malheureuse n’est pas [p. 24] surprise par la venue de ses bourreaux, qu’elle l’attend même anxieuse : consciente de son mal, elle connaît la légende… et la coutume. Comme les gars, elle a compté les jours ; elle sait que celui de l’expiation est venu, elle est prête, mais quel trouble dans son être ! On peut facilement s’en faire une idée d’après le genre de sa maladie.
C’est d’abord une préoccupation désagréable qui agite son système nerveux. L’appréhension d’être violentée vient ensuite et aggrave l’état fébrile, de sorte qu’à l’arrivée des paysans la crise hystérique éclate. Malmenée, l’aboyeuse résiste ; c’est ce qu’ils appellent sa rébellion. A partir de ce moment le drame commence et il s’accomplit, on l’a vu, avec une logique implacable.
A propos de cette pratique révoltante qui permet à des hommes sans mandat de pénétrer par force dans un domicile privé, de violer le sanctuaire de la famille et d’en arracher de pauvres créatures innocentes, on se demande tout naturellement quelle est l’attitude des parents de la malade, de l’époux, du frère, et l’on suppose que ni les uns ni les autres n’acceptent cette intrusion sans mot dire, qu’ils protestent, cherchent à l’empêcher, enfin qu’ils défendent par tous les moyens celle qui leur [p. 25] est chère. Eh bien ! non. Cette révolte n’a pas lieu ; ils la laissent emmener sans récrimination.
Pour vous en convaincre, voyez-la : sur la route poudreuse elle est seule se débattant contre ses bourreaux, qui la traînent au supplice en dépit de ses révoltes et de ses larmes. A mesure qu’elle s’en approche, elle voit s’éloigner la ferme d’où ils l’ont arrachée et personne n’accourt pour la protéger.
Pendant cette lamentable conduite que fait la famille de l’épileptique ? Elle vaque paisiblement, sans doute, à ses occupations quotidiennes, connue si rien d’inaccoutumé ne s’était passé à son foyer, sans se préoccuper de l’absence de celle qui en était l’âme. L’expiation finie, va-t-elle l’attendre à la sortie de l’église pour la consoler ? La voit-on, plus tard, à la fontaine du Roncier s’empresser autour d’elle ? Nullement.
Cette abstention des parents de l’aboyeuse provient de leur soumission à l’évangile de la légende. Bourreaux, complices et victimes, il les tient tous courbés sous l’autorité de son dogme qui ne rencontre pas d’athée.
N’est-ce pas que tout, dans ce draine, est bien extraordinaire et que les touristes vont souvent chercher bien loin des curiosités qu’ils trouveraient [p. 26] sans sortir de France ? Nous venons d’en voir une. Il y en a beaucoup d’autres, même en Bretagne, ce pays si divers de mœurs, de langage, de types, de caractères.
La légende explique aussi pourquoi l’on ne rencontre pas en public d’hommes qui aboient ; c’est que, s’il en existe, ils peuvent rester dans leurs maisons sans craindre qu’on vienne les en arracher pour les torturer. Étranger à la faute, leur sexe échappe à l’expiation.
Les aboyeuses sont-elles originaires du pays de Josselin ? Viennent-elles d’autre part ? Leur nombre est-il grand ? Les moments de crise sont-ils fréquents ? il m’est impossible de répondre à ces intéressantes questions. Il m’aurait fallu séjourner dans la contrée, visiter ces femmes, me livrer à une enquête, ce que je n’ai pas fait. Je ne serais pas étonné qu’il y en eût une quantité notable. On sait que leur mal est contagieux. Cela est bien connu dans les hôpitaux. On a vu des malades atteints d’affections tout autres que l’épilepsie et pris par les convulsions au seul aspect d’épileptiques en proie à l’attaque. Quant à des renseignements de la part des habitants, il ne faut pas compter en obtenir. Ils observent, au sujet des aboyeuses, une [p. 27] réserve ou plutôt un mutisme systématique et absolu.
Il reste un point important ; sont-elles guéries définitivement, radicalement par le baiser à la relique ? Il ne me parait pas impossible qu’il y ait quelques cas de guérison, non pas que ce contact matériel puisse modifier instantanément leur état physique, mais elle peut résulter de l’impression ressentie et d’autant plus forte qu’elle a duré longtemps. Effectivement, née au seuil de leur domicile, cette impression se continue et s’accroît pendant le trajet à l’église pour ne finir qu’à l’épuisement complet de leurs forces. Il y a là un ébranlement de l’organisme suffisant pour provoquer une révolution salutaire.
La cessation des convulsions dès que l’aboyeuse a eu touché le reliquaire s’explique par la raison qui précède ; à ce moment le mal a atteint son maximum d’intensité, la période du paroxysme a cessé ; à la fièvre succède la prostration, comme cela arrive dans toute maladie des nerfs.
On connaît l’épilepsie. Issue d’un trouble du système nerveux, le même phénomène peut la faire cesser. A l’appui de cette vérité voici un fait curieux : dans un hôpital de Paris deux femmes, malades [p. 28] de la fièvre, furent prises de convulsions nerveuses. Le médecin de la salle craignait la contagion. Il commanda de mettre un fer au feu et de le chauffer à blanc. Quand on le lui eût apporté il s’avança lentement, au milieu de l’anxiété générale, vers le lit de la première des malades et prit ses dispositions comme s’il allait lui imprimer sur la chair la tige brûlante. Immédiatement la crise cessa chez toutes deux. Il est évident que cela fut le résultat de l’impression de terreur éprouvée subitement, inopinément par elles.
En terminant, il convient que je réponde à une objection qui, sûrement, préoccupe le lecteur. La voici : parmi ces femmes, que les campagnards du pays de Josselin vont, chaque année, chercher à domicile pour les mener à l’église, il faut qu’il s’en trouve qui aient déjà accompli ce voyage, car l’effet salutaire qu’on lui attribue étant d’en diminuer le nombre, avec le temps il ne devrait plus y avoir d’aboyeuses. Les récidivistes ne sont donc pas guéries ? Alors, que penser de la conduite de ces gars renouvelant sans cesse une expérience inutile ? Ne seraient-ils pas de bonne foi ?
Il est vraisemblable qu’en effet quelques-unes des aboyeuses ont gravi plusieurs fois le douloureux [p. 29] calvaire, ce qui indiquerait que la cure n’a pas eu lieu, mais cela ne prouve nullement Ia mauvaise foi de leurs conducteurs. Il suffit de voir ceux-ci dans l’accomplissement de leur bénévole mandat. Ils ont bien l’attitude de gens qui remplissent un devoir.
Comment concilier cette conviction et l’inefficacité des pratiques exercées par eux ? L’explication est dans leur croyance même, et il est très probable qu’en cas d’insuccès ils interprètent de la manière suivante la stérilité de leurs efforts : « Si le baiser à la relique vient à manquer son effet, c’est que l’état de malédiction où se trouve l’aboyeuse a une gravité inusitée, exceptionnelle ; que l’esprit du mal qui les possède est supérieur au principe du bien contenu dans l’ossuaire et qu’une nouvelle épreuve est indispensable. » Cette épreuve ils la renouvelleront imperturbablement autant qu’il faudra et c’est ce qui explique leur air convaincu, leur calme stoïque.
Il faut déplorer cette superstition, fille de l’ignorance et le pire des maux, car il a pour principe une docilité ou plutôt une faiblesse d’esprit, qui rend esclave de la volonté d’autrui celui qui en est atteint. C’est un navire sans gouvernail livré au caprice des flots. [p. 30]
Si le vent se trouve être favorable, la mer clémente, il pourra se faire que l’esquif aborde à quelque plage hospitalière. Si le contraire arrive malheur à lui et à ses marins ; c’est le naufrage et ses horreurs.
De même pour l’homme possédé de l’esprit de superstition. Crédule, il s’abandonnera au premier venu et exécutera aveuglément sa volonté. S’il a en face de lui quelqu’un d’honnête, il pourra faire du bien, être utile, ou tout au moins ne causer de mal à autrui ni à lui-même, mais s’il subit le caprice d’un pervers, il n’est pas de mauvaise action dont il soit incapable, sans compter le préjudice personnel qui peut en résulter pour lui.
La superstition mène au fanatisme, qui n’est souvent qu’une de ses formes. Celui-ci compte ses jours par les malheurs qu’il a causés. Il a ensanglanté l’histoire de l’humanité. L’Inquisition, la Saint Barthélémy, les Dragonnades furent son œuvre et Jeanne d’Arc, la sublime patriote de Domrémy, sa plus glorieuse victime, car ce n’est pas seulement pour avoir vaincu les Anglais, ennemis de son pays, qu’elle fut brûlée vive ; la haine de la France n’aurait pas suffi pour pousser Cauchon et ses assesseurs à commettre cette infamie. Leur fanatisme [p. 31] vit en elle nue visionnaire, une possédée du Diable et au nom de la religion ils l’immolèrent. Ce furent de superstitieux gredins.
C’est la même erreur qui pousse nos paysans du Morbihan, le jour de la Pentecôte, à torturer froidement les pauvres aboyeuses. Ils sont inconscients. J’ai dit qu’actuellement le nombre des victimes est beaucoup moindre, ce qui oblige les bourreaux à être plus rares ; mais n’y en aurait-il qu’une chaque année ce serait encore trop.
Le remède à la superstition, à l’ignorance, c’est l’instruction. Grâce au triomphe définitif de la démocratie en France, l’instruction est devenue obligatoire et gratuite. A Paris et dans les grands centres cette mesure ne pouvait manquer de produire de prompts et exceller résultats, mais il en est autrement dans nos campagnes où l’esprit de localité, de personnalité régi encore, faisant tortueusement échec à la loi. C’est là que réside le mal. Il faut que l’autorité fasse sans ménagement, sans faiblesse, courber le front à nos obereaux de campagne devant les décisions de la souveraineté nationale; que personne ne puisse s’y soustraire ni par son argent, ni par son influence, ni par sa situation industrielle, commerciale ou de famille. [p.32]
Je ne veux pas laisser nos paysans de Basse-Bretagne sous le coup du blâme que je viens de leur infliger. Ils ne sont pas méchants en somme.
Beaucoup sont ignorants, je parle des anciens, mais au demeurant ils sont très intelligents, très fins et ont des vertus qui en font positivement des types pleins d’originalité.
Ils ont le culte du foyer, le respect des ancêtres, la haine de l’arbitraire et par-dessus tout l’amour du sol natal. Ce sont des patriotes dans la plus haute acception du mot et leur patriotisme est exempt de fanfaronnade. Chez eux ni pose, ni verbiage mais un sentiment inné, profond du devoir, une volonté recueillie, froide, de l’accomplir à l’heure qu’il faudra et une passion ardente mais contenue, un feu intérieur enfin qui les rend capables des plus grands sacrifices, des plus sublimes dévouements.
Tels ils se sont montrés en 1870. Modestes, timides même, respectueux de leurs chefs, ils sont allés au feu avec l’entrain de vieilles troupes et l’ont affronté bravement, sans broncher. Moutons inoffensifs au village, ils sont devenus des lions sur le champ de bataille. Et pourtant ils n’avaient pour la plupart aucune instruction militaire. Et quels [p. 33] vêtement ! quelles chaussures !Les premiers laissaient l’eau filtrer au travers à la moindre pluie ; les secondes se déchiraient au choc du plus petit caillou.
J’ai vu arriver à Paris une partie des mobilisés du Finistère et des Côtes-du-Nord. C’était en octobre. Il pleuvait à verse. Ils étaient vêtus de pauvres blouses de coutil détrempées par l’eau. Ils avaient l’air malheureux. Au fond, ils regrettaient le pays natal, leurs landes, leurs bruyères. En vain les Parisiens, attablés aux terrasses des restaurants, les forçaient à s’arrêter et leur faisaient prendre des consommations ; ils conservaient quand même leur mine attristée.
Le bruit, le mouvement tumultueux de la rue les effarouchait. On disait : « Ça, des soldats ! quelle pitié ! à la première affaire ils s’enfuiront comme des lapins. »
On a vu par la suite combien on s’était trompé. Ils ont absolument montré au feu le sang-froid, l’aplomb, la bravoure de vieux soldats.
Ce qui les a distingués particulièrement des autres contingents, c’a été leur bonne tenue et leur discipline.


LAISSER UN COMMENTAIRE