 André Joussain. L’idée de l’inconscient et l’intuition de la vie. Article paru dans la « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), trente-sixième année, LXXI, janvier à juin 1911, pp. 467-493.
André Joussain. L’idée de l’inconscient et l’intuition de la vie. Article paru dans la « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), trente-sixième année, LXXI, janvier à juin 1911, pp. 467-493.
André Joussain [pseudonyme de Jean-Baptiste-Henri Joussain] (1880-1969). Agrégé de philosophie. Poète et Professeur au Lycée de Périgueux. Quelques travaux retenus :
— Exposé critique de la philosophie de Berkeley. Paris, Boivin, 1920. 1 vol.
— Les passions humaines. Paris, Ernest Flammarion, 1928. 1 vol. Dans la « Bibliothèque de Philosophie scientifique ».
— Les sentiments et l’intelligence. Paris Ernest Flammarion, 1930. 1 vol.
— Psychologie des masses. Paris, Ernest Flammarion, 1937. 1 vol.
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Par commodité nous avons renvoyé les notes originales de bas de page en fin d’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr
[p. 467]
L‘IDÉE DE L’INCONSCIENT
ET L’INTUITION DE LA VIE
Le sentiment que j’ai de mon être ne fait qu’un avec mon être même. En disant que j’existe, je ne conçois rien par là sinon le fait même de voir des couleurs, d’entendre des sons, d’éprouver des sensations tactiles, d’imaginer, de vouloir, de jouir ou de souffrir, de percevoir mon propre corps et le monde extérieur. Mon existence n’enveloppe rien qui ne soit conscient. J’ai beau me perdre par la pensée dans les espaces infinis du ciel et laisser mon imagination s’égarer au delà des dernières étoiles visibles ; j’ai beau m’absorber dans la contemplation du monde extérieur au point d’oublier les événements de ma vie passée et les conditions de ma vie présente ; ce sont toujours mes états de conscience que je perçois et il m’est, en définitive, impossible de jamais connaître autre chose. Aucun effort de pensée ne pourra me faire concevoir comme ayant une réalité différente de mon existence consciente : l’hypothèse même en est contradictoire, car tout ce que je conçois est par là même conscient, et la réalité que je m’attribuerais ainsi, indépendamment de ma conscience, rentrerait dès lors dans la conscience d’où je prétendrais la bannir. De ce que je ne puis pas concevoir autrement que comme conscient, il ne s’ensuit pas, dira-t-on, que je ne puisse être autre chose. Mais une telle objection, purement verbale, demeure entièrement inintelligible. Pour affirmer, en effet, que je puis être autre chose que conscience, il faut que je me conçoive moi-même comme existant sous une autre forme que la conscience, et me concevoir, c’est avoir conscience de moi-même. Je suis donc un être conscient par essence. Tant que j’aurai conscience, j’existerai ; quand je cesserai d’avoir conscience, je cesserai [p. 468] d’être ; et je ne puis exister sans avoir conscience, ni avoir conscience sans exister.
Cette vérité que la réflexion philosophique me découvre avec une entière clarté, le sens commun, spontanément, l’affirme ; l’instinct animal lui-même en rend témoignage, car la crainte de la mort est l’appréhension de l’anéantissement de la conscience, et quand la pensée de la mort se présente à nous, c’est comme la menace d’une entière destruction de notre être. Non sans doute que nous ayons la possibilité de nous supposer nous-même anéanti, ce que nous venons de montrer impossible, mais parce que le sentiment de notre être est indissolublement lié au contenu actuel de notre conscience, en sorte que tout ce qui altère notre conscience dans son ensemble semble menacer notre être même.
Existe-t-il autre chose que moi ? Oui, sans doute, car s’il n’en était pas ainsi, comment aurais-je l’idée d’autre chose ? Comment même pourrais-je prendre une conscience expresse de ma propre réalité ? Pour me concevoir comme un être distinct de tous les autres, il faut que je possède une connaissance profonde de l’être d’autrui. Et pourtant je ne puis prétendre ici à la même certitude : un doute théorique m’est toujours possible concernant les autres êtres, un doute qui n’enferme en lui aucune contradiction. Rien ne m’est donc immédiatement donné que moi-même. S’il existe une réalité différente de moi, c’est seulement par l’intermédiaire de mes propres états que je la connaîtrai. Je puis donc à la rigueur concevoir l’existence des autres êtres comme une illusion, puisque je suis à jamais enfermé en moi, mon existence fût-elle éternelle. Mais ma propre réalité ne peut faire l’objet d’aucun doute. Je ne saurais sérieusement me feindre irréel, une telle supposition impliquant une contradiction manifeste car me penser actuellement inexistant, c’est encore me penser, et par conséquent avoir conscience de mon être. Je puis douter de tout, excepté de ce fait même que je doute. Or douter, c’est avoir conscience ; avoir conscience, c’est exister.
Ainsi, à supposer qu’il existe des êtres semblables à moi, le contenu de leur conscience m’échappe, comme leur échappe le contenu de la mienne. Lorsque deux hommes regardent au même instant la même étoile, la vision du premier n’est pas la vision du second ; l’objet de la contemplation de l’un n’est pas l’objet de la [p. 469] contemplation de l’autre. Tous deux prétendent voir les mêmes couleurs, entendre les mêmes sons, éprouver les mêmes sensations de toucher et de température, sentir les mêmes parfums, goûter les mêmes saveurs. Mais il se peut que chaque conscience possède des nuances de perception qui lui soient propres et demeurent incommunicables. Car dans la même conscience, des sensations peuvent être directement comparées ; entre deux consciences différentes, toute comparaison directe est impossible ; ce que chacun perçoit, il est seul à le percevoir ; les autres ne peuvent que l’imaginer d’après leur propre expérience. De ce point de vue, on pourrait dire que les hommes s’imaginent faussement percevoir le même univers et qu’il existe autant d’univers perçus que de sujets qui les perçoivent.
Vainement essayerait-on de pénétrer à fond une âme. Celui qui parviendrait à savoir tout ce qui se passe en elle, au point d’être à même de l’analyser tout entière, ne s’identifierait pas avec elle ; il la verrait du dehors tandis qu’il se voit du dedans ; il n’en connaîtrait jamais les états que par induction, les siens par intuition; et la connaissance qu’il aurait d’elle serait seulement probable, tandis que celle qu’il a de lui-même est certaine. Chaque être conscient est irréductible à tout autre. Lorsque je conçois l’existence des autres êtres, je ne sors pas de ma propre conscience et lorsqu’ils me conçoivent comme distincts d’eux-mêmes, ils ne sortent pas de la leur. D’un être conscient à l’autre existe un abîme, et cet abîme est infranchissable. Chaque individualité est inaliénable et incorruptible. Tout être conscient est un être conscient déterminé, et s’il cesse d’être ce même être conscient déterminé, il cesse d’être absolument. En tant qu’être distinct de tous les autres, chacun d’eux est un absolu.
La notion d’individualité n’a pas suffisamment retenu l’attention des philosophes. Le seul Leibnitz s’est attaché à l’approfondir. Kant la présuppose sans en rien dire, et c’est là le vice capital de son système. Ce vice est rendu manifeste par le développement que sa doctrine reçoit chez ses successeurs : tous nient la pluralité des êtres et tombent dans la thèse de l’unité de substance. Or jamais Kant n’eût souscrit à une pareille conséquence, et cependant elle dérive logiquement de son système. Kant fondait en effet la liberté sur le devoir. Mais ce que le devoir me prescrit, c’est à [p. 470] moi et à nul autre qu’il incombe de l’accomplir. La liberté est donc celle d’un individu, ou n’a aucune raison d’être. C’est ce que Kant reconnaissait en admettant que l’ensemble de la vie résulte pour chaque homme d’un acte libre qui détermine la totalité de ses actions ; mais il ajoutait que tous les événements d’une vie sont rigoureusement déterminés, et que la liberté est nouménale, c’est-à-dire qu’elle existe en dehors des phénomènes qui se succèdent dans le temps et dont la totalité constitue le monde. Par malheur, comme tous les individus sont solidaires les uns des autres et que la vie de chacun d’eux est conditionnée par celle des individus qui existaient avant lui ou existent en même temps, le déterminisme de l’ensemble des phénomènes que nous appelons le monde devrait se trouver rompu autant de fois qu’il existe d’actes librement accomplis en dehors du temps. Il faut donc renoncer au déterminisme ou réunir toutes les libertés nouménales en une seule comme l’a fait Fichte. Schopenhauer ne procéda pas d’une autre manière. II ne voulut voir dans l’individu qu’une pure illusion. Il est assez significatif à cet égard, qu’il avoue n’avoir jamais pénétré le sens profond de la Monadologie. Et cependant il avait à un trop haut degré le sens du réel pour ne pas faire d’importantes concessions à la thèse de la pluralité des êtres. De là les contradictions perpétuelles de sa doctrine. Il admet avec Kant une pluralité de libertés nouménales pour fonder la diversité des caractères empiriques, tout en niant comme lui que la catégorie de nombre puisse s’appliquer en dehors du monde phénoménal, et il affirme par surcroît que les individus ne constituent qu’une seule et même volonté. Il lui arrive d’affirmer que l’individualité est indestructible et qu’elle existe de toute éternité dans le monde des choses en soi, tout en maintenant quelques pages plus loin que les individus ne peuvent exister que dans le temps, fantômes éphémères dépourvus de toute réalité véritable.
Le germe de toutes ces erreurs est dans la Critique de la raison pure. Kant, en soutenant que l’unité du moi est celle d’une forme s’appliquant à la diversité qualitative du donné, n’a pas vu que le donné, en tant que donné, possède une unité indépendante de l’application de toute forme, puisqu’il constitue le contenu propre d’une conscience individuelle. Toute sensation est la sensation d’un être sentant déterminé voilà le fait métaphysique primordial, [p. 471] logiquement antérieur à tout usage de catégories ou de formes. Au reste, l’unité que les catégories et les formes imposent au donné n’est au fond que l’unité même de la conscience formes et catégories sont tout à fait identiques à ce que les spiritualistes appellent l’âme; elles définissent déjà l’esprit en déterminant sa spontanéité et sa puissance d’unification elles en font une véritable substance. Enfin tout le système compliqué des catégories et des formes ne peut constituer un système que dans l’unité d’une même conscience donné et formes à leur tour doivent appartenir au même être conscient pour que celles-ci s’appliquent à celui-là. L’unité de la conscience est perpétuellement supposée, étant antérieure à toute forme comme à tout donné, puisque forme et donné sont enveloppés en elle et n’existent qu’eu elle. La question que Kant et ses successeurs évitent si soigneusement de se poser est celle-ci pourquoi le contenu de ma conscience échappe-t-il nécessairement à autrui? Et pour Schopenhauer la même question se pose également sous une autre forme pourquoi existe-t-il des milliers d’êtres dont la vie intérieure m’est non seulement inconnue, mais, à le bien prendre, absolument inconnaissable, comme la mienne pour eux? Le principe d’individuation auquel Schopenhauer fait appel est ici de nulle valeur car le temps, l’espace, la causalité qui constituent ce principe sont appliqués aux choses par des esprits individuels, en qui ils existent, et cependant l’individualité de ces esprits s’explique par eux. Ainsi temps, espace, causalité ne peuvent être principe d’individuation que si l’individualité existe antérieurement, et que s’ils sont eux-mêmes mis en œuvre par une individualité réelle. Il ne servirait non plus à rien de dire que ce problème dépasse les limites de la connaissance humaine. Car ces limites, une critique de la raison pure a pour rôle de les déterminer en établissant ce que l’esprit apporte de lui-même dans sa représentation des choses. En effet, qu’est-ce que cet esprit, dont le temps, l’espace, et la causalité sont les formes? Pour Kant comme pour Schopenhauer, la difficulté est la même. Est-ce un esprit individuel? Il le faudrait pour s’en tenir à l’immédiatement donné. Mais, en ce cas, la pluralité des êtres est implicitement admise on la pose avant toute détermination de ce qu’il y a d’a priori ou d’a posteriori dans la connaissance. Et dès lors on ne peut plus soutenir que ces formes [p. 472] nous empêchent de saisir ce que l’âme est en elle-même. Il est évident en effet que l’a priori et l’a posteriori sont les deux modes de connaissance d’un seul et même esprit, envisagé tantôt comme actif en tant que sujet percevant, tantôt comme réceptif, en tant que diversement modifié. En dehors de cette supposition, les mots d’a priori et d’a posteriori n’ont aucune signification plausible. Veut-on parler au contraire de l’esprit en général ? On manque alors de ce sens critique dont on réclame si expressément le monopole. Car on part de l’idée générale d’esprit humain, sans avoir au préalable établi la valeur d’une telle idée générale. On laisse ainsi de côté les esprits particuliers, réels pourtant, et avec eux le problème qu’il importait avant tout de résoudre. Pour que la position de Kant fût solide, il faudrait qu’il n’existât qu’un seul esprit, qui fît à lui seul toute la science : l’auteur de la Critique de la raison pure.
II
Tout ce dont j’ai conscience est mon être même ou l’une de mes manières d’être;; et rien n’existe en moi qui ne soit conscient. Et tout ce qui est conscient, à son tour, est d’un individu donné, la conscience étant par essence individuelle. L’idée d’un phénomène psychologique inconscient et l’idée d’un phénomène conscient impersonnel sont donc contradictoires (1). Un phénomène psychologique ne peut se définir que par la conscience et l’individualité de la conscience, comme l’état d’un être déterminé ou comme une phase de la vie de cet être. Prétendre qu’on peut le définir autrement, c’est dire qu’on peut imaginer l’inimaginable et penser l’impensable. Si vous définissez le phénomène psychologique par la conscience, disent ordinairement les partisans de l’inconscient, il est évident qu’un phénomène psychologique inconscient est contradictoire mais rien ne nous oblige à définir le phénomène psychologique par la conscience. Mais, à ce compte, on pourrait prétendre que le cercle est carré, car la notion d’un cercle carré n’est [p. 473] contradictoire que si l’on définit la circonférence par l’équidistance de ses points au centre, et l’on pourrait tout aussi bien prétendre que rien ne nous oblige à une pareille définition. Du point de vue où nous sommes placés, la conséquence est rigoureuse. D’une manière plus générale encore, on ne peut dire qu’il existe autre chose que de la conscience. Car « autre chose que la conscience est, pour l’être qui pense, absolument inintelligible et irreprésentable on ne peut en avoir le sentiment ni l’idée, car sentiment et idée sont des formes de conscience on n’en possède ni intuition ni concept, car intuition et concept sont encore de la conscience. Et le mot « exister » lui-même ne peut signifier que deux choses « être représenté dans la conscience » s’il s’agit d’une existence phénoménale ; « avoir conscience », s’il s’agit d’une existence substantielle. D’où il suit qu’il est absurde de supposer une chose en soi dont l’univers ou l’âme seraient les manifestations temporelles, car l’idée d’une chose en soi nous étant fournie par notre propre conscience et par elle seule, affirmer que je suis le phénomène d’une chose en soi est en contradiction avec l’intuition que j’ai de mon être ; et affirmer qu’il existe une chose en soi dont l’univers est l’apparence phénoménale n’a de sens que si nous entendons par « chose en soi » une conscience ou une pluralité de consciences (2).
Kant tombe dans une grossière erreur quand il refuse à la conscience une réalité substantielle. L’âme, d’après lui, ne nous est pas connue comme substance, parce que nous ne pouvons rien penser que dans le temps, qui lui-même est relatif à notre manière de sentir. Mais cette théorie est contradictoire. En effet, si le temps est une forme a priori de notre sensibilité, il est évident que nous ne pouvons penser que dans le temps, et dès lors l’intemporel ne peut être qu’un concept purement négatif. Il semble donc que Kant pense comme nous sur ce point ; mais en réalité vis-à-vis de l’intemporel son attitude et la nôtre sont fort différentes. Lorsque nous identifions la conscience et l’être, nous affirmons qu’être, [p. 474] c’est vivre, nous faisons du temps une propriété essentielle des choses. Le temps est pour nous un absolu, et nous pouvons dès lors ne voir dans l’intemporel qu’un concept purement négatif. Mais lorsqu’au contraire on affirme que le temps est la forme sous laquelle on perçoit les choses, en soi intemporelles, c’est l’intemporel qui devient un absolu, puisque c’est seulement par rapport a cet absolu que le temps peut être conçu comme relatif à notre manière de sentir et de penser. Je puis dire de l’espace qu’il est une forme a priori de ma sensibilité, parce que tout ce qui est en moi n’est pas soumis à la forme de l’espace, et que ce qu’il y a de plus intime en moi se distingue de l’étendue. Mais il n’en va pas de même du temps. Tandis que l’inétendu est comme objet de ma pensée aussi réel que l’étendu, l’intemporel ne saurait au contraire, ni dans le système de Kant, ni en fait, se mettre sur un pied d’égalité avec le temporel. Si nous pensons tout, par hypothèse, sous la forme du temps, en affirmant que les choses en soi existent indépendamment du temps, je suis dans l’impossibilité de concevoir ce que j’affirme. Car concevoir l’intemporel, c’est ne plus penser sous la forme du temps. Ainsi, dire que le temps est une forme de notre pensée, c’est ne rien dire d’intelligible. Si le temps est une forme de notre pensée, il n’est pas une propriété des choses en soi, et par conséquent les choses en soi existent indépendamment du temps. Or en affirmant que les choses sont indépendantes du temps, les Kantiens prétendent sans doute comprendre ce qu’ils disent. Ils prétendent donc atteindre l’existence intemporelle des choses. Mais cela même, d’après eux, est impossible. Donc la théorie de Kant est absurde. Ce qu’il fallait démontrer.
Le monde que nous percevons ne peut exister indépendamment de notre conscience, car étant perçu, il n’est en dernière analyse qu’un état conscient, et plus précisément, étant perçu par nous ou par des êtres plus ou moins semblables à nous, il est l’état conscient d’un être défini. Quand nous parlons d’un univers qui existe sans être perçu, nous oublions- que nous l’imaginons et que nous le percevons ainsi par la pensée. Nous disons que les objets perçus par nous continuent d’exister quand nous cessons de les percevoir, et nous ne voyons pas que notre affirmation n’a de sens pour nous qu’autant que nous nous représentons ces objets et durons en eux, de sorte que la continuité de leur existence n’est en réalité que la [p. 475] continuité de la nôtre – la permanence de notre souvenir et le prolongement de notre propre vie. Nous croyons que le monde subsisterait si notre esprit et les esprits semblables au nôtre étaient anéantis, et nous ne prenons pas garde que l’impossibilité où nous sommes de nous représenter l’anéantissement du monde, n’est, au fond, que l’impossibilité de nous représenter notre propre anéantissement, ou, en d’autres termes, de nous penser nous-mêmes comme absolument inconscients. Le monde extérieur n’existe donc que pour nous, car il est notre représentation, et dire qu’il existe indépendamment de nous, c’est en faire une représentation impersonnelle et inconsciente.
Descartes, après avoir reconnu que nous étions des êtres conscients par essence (3), n’avait pas aperçu que la négation de la matière était une conséquence nécessaire de ses principes. Il distingua donc deux sortes de substances, la pensée et l’étendue. Berkeley démontra bientôt que l’étendue et la matière ne pouvaient avoir d’existence sinon dans la pensée. Kant ne fit que reprendre ses conclusions en posant les principes de son idéalisme transcendantal. La thèse de Berkeley était d’ailleurs trop solide pour être révoquée en doute. Et, de fait, aucune tentative sérieuse ne fut faite pour l’ébranler. Spencer fut le seul qui s’y attaqua d’une manière ouverte, mais il se trompa dans son effort, et s’étant donné beaucoup de mal pour prouver ce que Berkeley n’avait jamais songé à mettre en doute, il aboutit, sans le savoir, à des conclusions identiques à celles du philosophe qu’il combat. La thèse de Berkeley repose tout entière sur cette affirmation qu’il n’y a point d’objet sans sujet, proposition évidente que son adversaire ne peut contredire et qu’il admet expressément. Mais l’ayant admise, il établit avec beaucoup de force que nos sensations supposent une cause distincte de nous, cause qui ne ressemble en rien aux sensations qu’elle produit et dont nous ne pouvons rien dire sinon qu’elle est en dernière analyse identique à notre propre volonté motrice. Or Berkeley lui-même admettait ce point. II reconnaissait que nos sensations volontaires ont une cause distincte d’elles, cause qui ne peut être conçue que comme une activité, et [p. 276] par conséquent comme analogue à la volonté humaine. Schopenhauer ne parla pas lui-même un autre langage. Car après avoir affirmé que le monde est notre représentation, il ajoute que ce qui est pour nous représentation est en soi volonté. La seule différence, c’est que le fondement réel de la représentation, chez Berkeley, s’appelle Dieu, chez Spencer l’inconnaissable, chez Schopenhauer le vouloir vivre. Mais quand on est d’accord sur les choses, peu importent les mots.
Au lieu de chercher à réfuter Berkeley, Spencer eût sagement fait de l’approfondir. Il se fût ainsi épargné une erreur où sont tombés comme lui Schopenhauer et Kant. Ce que n’ont vu ni Kant, ni Schopenhauer, ni Spencer, c’est en effet que si la matière existe seulement pour la Conscience, la conscience en revanche existe en soi et ne peut être conçue autrement que comme une substance. On ne saurait dès lors faire du monde sensible une apparence sans admettre implicitement que l’esprit dans lequel il existe est une réalité. Kant a supposé que notre existence consciente était la manifestation phénoménale d’un noumène inconnaissable Schopenhauer l’a suivi dans cette voie en regardant les individus éphémères comme n’étant au fond qu’une seule et même volonté intemporelle; Spencer, à son tour, donne dans la même absurdité en faisant de la matière et de l’âme deux modes de l’inconnaissable. C’était méconnaître entièrement la notion d’existence subjective. Car si la matière est connue par l’intermédiaire de la conscience, la conscience, en revanche, est connue directement et en elle-même. Il n’y a pas d’inconnaissable dont elle soit la manifestation. L’existence subjective se suffit pleinement à elle-même. Comment d’ailleurs pourrions-nous avoir l’idée d’une existence en soi, si nous ne la trouvions en nous ? Car nous ne l’empruntons pas à la matière qui n’est qu’un mode de la conscience. Il faut donc que nous la tirions de la conscience elle-même. Et d’ailleurs dire qu’elle provient de la matière, c’est-à-dire qu’elle provient de la conscience, puisque la matière n’existe que dans la conscience.
III
Nous avons montré la contradiction qu’implique le concept de l’inconscient. Mais le préjugé que nous avons ici à combattre est si [p. 477] répandu, qu’il faut en découvrir l’origine ; car on ne peut extirper une erreur invétérée, qu’à la condition d’en retracer la genèse, les hommes étant toujours plus disposés à reconnaître la fausseté d’une opinion quand ils voient clairement les raisons qui la leur ont fait adopter.
C’est faute d’avoir suffisamment distingué la conscience immédiate de la conscience réfléchie qu’on s’est jeté dans de telles contradictions. Notre existence, réelle en soi, est aussi réelle pour nous ; elle constitue à nos yeux une vérité. Nous avons conscience, et nous savons que nous avons conscience ; nous existons et nous affirmons notre existence. Ainsi non seulement nous sommes, mais nous réfléchissons sur ce que nous sommes. Maintenant, si notre réflexion s’appliquait à toutes nos manières d’être, et d’une façon constante, nous n’aurions jamais pensé à supposer en nous de l’inconscient. Mais notre réflexion ne s’exerce pas continuellement et n’embrasse qu’une partie de notre vie intérieure. Or en tant que nous sommes doués de réflexion, cela seul existe pour nous qui tombe sous les prises de la réflexion. Le reste échappe entièrement à notre connaissance. Ce qui n’existe que dans la conscience immédiate n’existe absolument pas pour la conscience réfléchie, sinon après coup, lorsqu’il est représenté à la réflexion par la mémoire. C’est donc, pour la connaissance proprement dite, de l’inconscient. Dès lors les psychologues dont le rôle est précisément de réfléchir sur le contenu de la conscience seront fortement tentés de traiter en inconscient ce qui se présente ainsi après coup à leur réflexion. Nous remarquons, par exemple, que les hommes professent souvent de bouche certaines croyances qui demeurent sans influence sur leur conduite, et qu’ils agissent en même temps d’une manière précise et déterminée qui répond à des croyances absolument différentes.
Inversement, ce qui se présente après coup à la conscience réfléchie est supposé avoir existé antérieurement dans la conscience immédiate. Nous appelons ces dernières des croyances réelles par rapport aux premières qui demeurent purement verbales et extérieures. Pourtant nous ne pouvons nous empêcher de constater que ces croyances réelles n’existent pas dans l’esprit des hommes qui y conforment en fait leur conduite. Nous disons donc qu’elles existent, mais à l’état inconscient. Or en fait, elles [p. 478] n’existent pas du tout, mais elles symbolisent pour notre intelligence et traduisent en termes de représentation une tendance déterminée de l’âme qui pousse les individus à agir, comme s’ils étaient réellement guidés par les croyances que nous dénommons réelles. Ce qu’il y a de vrai dans ce point de vue, c’est que l’agent serait réellement guidé par ces croyances, s’il faisait d’une manière rationnelle ce qu’il fait actuellement d’une manière instinctive. Mais justement, il ne procède pas d’une manière rationnelle : et dès lors, parler de croyances inconscientes, c’est assimiler faussement l’activité instinctive à l’activité rationnelle, c’est projeter l’instinct sur le plan de la raison, c’est méconnaître ce qu’il y a dans l’instinct d’absolument original, de véritablement instinctif. En réalité l’instinct se suffit à lui-même. Mais la représentation que notre intelligence s’en fait ne suffit pas à notre intelligence ; elle cherche donc à le concevoir sur son propre type, et elle aboutit ainsi à ce postulat l’instinct est l’intelligence inconsciente ; l’activité instinctive est guidée par les mêmes représentations que l’activité rationnelle, mais ces représentations sont inconscientes-dans un cas, conscientes dans l’autre. En raisonnant ainsi, le psychologue obéit à l’instinct naturel de l’intelligence qui est de tout analyser et de tout comprendre au moyen des concepts. Dès que l’intelligence entre en action, elle prétend embrasser tout le réel, et lorsque le réel est d’une nature qui le rend insaisissable au concept, elle aboutit à des contradictions inévitables. L’inconscient est une contradiction de ce genre. Pour ces raisons, il succombera toujours sous les coups des logiciens, mais continuera d’être défendu par les psychologues. Et en effet, toutes les fois que nous essayons d’analyser l’âme humaine, force nous est bien de recourir aux concepts. Pour communiquer nos intuitions, le langage est indispensable, et le langage n’a prise que sur les concepts, et non sur les intuitions. Aussi nous faisons nous toujours après coup plus raisonnables que nous ne le sommes en fait, par la nécessité même où nous sommes de rendre compte aux autres de notre conduite, ou de nous en rendre compte à nous-mêmes. Il ne nous suffit pas de vivre; il faut encore que nous sachions comment nous vivons; il ne nous suffit pas d’agir, il faut que nous percevions pourquoi nous avons agi. Et ainsi, là où notre action n’a que des causes, nous lui supposons des motifs ; [p. 479] nous substituons à la vie la représentation de la vie. Le poète et le romancier composent d’instinct et sous l’inspiration qui les possède. Leurs créations ne résultent pas d’un plan préconçu, réalisé paragraphe par paragraphe ; et en fût-il ainsi d’ailleurs, le plan lui-même devrait avoir été découvert d’instinct, à moins de supposer un plan du plan, et ainsi de suite à l’infini. Cependant, qu’il s’agisse de l’œuvre, ou du plan de l l’œuvre, le poète et le romancier parlent toujours du dessein qu’ils ont eu et de la fin qu’ils ont poursuivie comme si ce qu’ils ont réalisé avait été dès le début étalé tout entier sous leurs yeux. Critique-t-on leur conception ? — « Vous vous trompez, répondent-ils. Vous n’avez pas saisi ma pensée. Ce n’est pas là ce que j’ai voulu faire. » Dans le fait, ils n’ont pas voulu au sens où ils prennent présentement ce mot. Mais l’inspiration étant par sa nature rebelle aux prises de l’intelligence, il faut bien la traduire en termes d’intelligence pour la faire accepter par d’autres esprits. Pour faire entrer leur interlocuteur dans leur intuition géniale, pour lui faire sentir ce que fut réellement leur énergie créatrice, il leur est nécessaire de décomposer en une succession d’idées générales juxtaposées et subordonnées les unes aux autres ce qu’ils ont trouvé d’instinct par un effort sui generis, précis et déterminé, quoique impossible à définir.
Le sens commun ne procède pas autrement que le psychologue. Notre tendance à nous représenter notre vie vécue est perpétuelle elle résulte de la nature même de notre intelligence, et du rapport nécessaire de notre intelligence à notre action. Aussi tombons-nous à chaque instant dans la même erreur que les psychologues, Par exemple nous regardons un paysage familier sans remarquer ce qu’il contient de nouveau, et même si l’on prend soin de nous dire que des changements s’y sont produits, nous promenons nos yeux sur tous les objets qu’il nous présente, sans y rien découvrir. On nous fait alors observer que des arbres ont été abattus, qu’une nouvelle maison s’est construite, et tout aussitôt nous reconnaissons la justesse de la remarque. Des changements produits nous avions sans doute conscience, puisque tout le paysage était là sous nos yeux : mais pour notre connaissance ces changements n’existaient pas, parce que nous étions incapables de les signaler en comparant à notre représentation actuelle nos représentations antérieures. —De même encore nous appelons inconscient ce qui, fondu pour [p. 480] ainsi dire dans un état d’âme total, peut devenir pour la réflexion un état d’âme distinct. Nous ne prêtons aucune attention quand nous parlons aux mouvements de notre bouche et de notre langue mais en réalité, ou bien ces mouvements sont conscients, quoique enveloppés dans notre état d’âme général, et par suite non distingués ou bien ils sont réellement inconscients, mais peuvent devenir conscients lorsque notre attention se portera sur eux. Nous disons aussi que nous étions sans le savoir épris d’une femme. Le sentiment que nous éprouvons alors est conscient puisqu’il existe en nous. Mais nous ignorons que ce sentiment est de l’amour parce que nous ne pouvons deviner les désirs auxquels, par son développement même, il donnera naissance. Nous éprouvons un sentiment, sans en avoir l’idée ; nous ne le rangeons pas sous le concept qui lui convient, nous ne lui donnons pas de nom ou nous lui donnons un autre nom que celui par lequel généralement on le désigne. Mieux éclairé sur notre avenir, ce que nous appelons de l’amitié ou de l’affection, nous l’appellerions de l’amour.
Notre erreur vient toujours de ce que nous perdons de vue le devenir réel de notre conscience. Nous fixons notre vie pour mieux nous la représenter, et nous considérons par suite comme permanent ce qui est éphémère et comme simultané ce qui est successif. Par exemple, lorsque nous rentrons dans notre appartement, nous en avons eu deux perceptions successives, l’une antérieure et l’autre postérieure à notre sortie. Mais comme ces deux perceptions sont exactement semblables, nous les considérons comme une seule et même chose qui est l’appartement lui-même, vu à deux moments différents. Nous en arrivons ainsi à concevoir notre appartement comme existant en dehors de nous puisque nous le retrouvons tel que nous l’avions laissé, c’est qu’il est demeuré en notre absence ce que nous le voyons maintenant. De même, un souvenir nous revient à plusieurs reprises en mémoire. En réalité si nous y réfléchissons, toutes ces apparitions successives du même passé sont autant de faits de conscience numériquement différents, mais comme leurs contenus sont absolument semblables, nous les identifions et nous disons que notre esprit s’est reporté plusieurs fois sur le même fait de notre passé. Nous faisons alors de notre passé une réalité immuable subsistant en dehors de notre esprit, comme une large fresque où toute notre vie est peinte et [p. 481] sur laquelle de temps en temps nous portons les yeux, où des parties sont effacées à jamais, d’autres momentanément obscurcies, et d’autres très claires et très nettes que nous ne nous attardons pas à regarder tant elles nous sont familières. Nous oublions que notre passé fut autrefois notre vie présente se réalisant dans la durée. Nous nous le représentons comme passé et extérieur en quelque manière à la durée, immobile sous le regard de notre esprit, au lieu de l’envisager dans son devenir continu, et nous ne voyons pas que nous mettons sur le même plan, en les considérant comme également actuels, des événements qui sont venus les uns après les autres et ne pouvaient exister ensemble. Ainsi nous nous comportons de la même manière vis-à-vis de notre passé et du monde extérieur. Nous faisons de la continuité indivisée de notre existence consciente quelque chose d’analogue à la matière, en transformant, ici et là, le successif en simultané et l’éphémère en permanent. S’agit-il de la matière ? Nous en parlons comme d’une représentation impersonnelle qui subsisterait en dehors de toute conscience, sans voir qu’elle existe à l’instant même dans cette conscience qui est la nôtre. S’agit-il de notre passé ? Nous en parlons comme d’une représentation personnelle, cette fois, mais toujours inconsciente puisqu’elle subsiste, pensons-nous, dans les intervalles de non-souvenir. Et qu’il s’agisse de la matière ou de la mémoire, nous tombons dans la même erreur grossière, en croyant percevoir directement la matière, et apercevoir directement le passé.
Il est des actions que nous accomplissons avec une pleine conscience, mais dont nous ne gardons aucunement mémoire. Par exemple, nous tenons certains propos, et nous les oublions entièrement. Or nous pouvons acquérir la certitude que ces actions ont été réellement accomplies par nous, et dans ce cas elles existent à nouveau pour notre pensée, sans que nous ayons conscience de les avoir faites. Elles se présentent donc à nous comme inconscientes. Nous en avons eu conscience quand nous les accomplissions. nous en avons conscience maintenant que nous nous les représentons; mais nous n’avons pas conscience de les avoir accomplies, tout en ayant la preuve qu’elles ont été accomplies par nous. L’impossibilité où nous sommes de les faire rentrer dans notre conscience du passé, coexistant avec ta nécessité où nous sommes de les incorporer à notre passé, nous induit à l’hypothèse purement verbale d’un [p. 482] inconscient, où tous les événements prennent place et subsistent immuablement. Mais comment les événements qui n’existent que dans un changement perpétuel pourraient-ils demeurer ce qu’ils furent en devenant à jamais invariables ? N’est-il pas-contradictoire de supposer que la vie perpétuellement modifiée se conserve en se .solidifiant. tout entière, que le pur devenir s’immobilise, que ses phases successives deviennent toutes à la fois simultanées ? Si nous admettons que le passé subsiste à l’état inconscient, nous n’avons d’ailleurs aucune raison de refuser à l’avenir le bénéfice de cette existence immuable. Le temps est dès lors une lumière qui se déplace à la surface du réel dont la partie éclairée constitue le moment présent, dont le passé et l’avenir représentent les portions obscures, illuminées de lueurs fugitives dans la mesure où nous sommes doués de prévision et de souvenir. La durée n’est plus alors une propriété essentielle de l’être, mais une illusion indéfinissable de notre esprit. Tout ce qui a existé, existe et existera est déjà déployé dans l’éternel. Mais une telle hypothèse se détruit elle-même, car en réalisant ainsi tous les faits dans un univers immuable, on ne peut s’empêcher d’en laisser un en dehors de cette immutabilité éternelle le fait même de la succession et de la durée. Dira-t-on que c’est une illusion de notre esprit ? Mais cette illusion même est un fait comme les autres, et ne doit pas échapper à la loi commune. Comment l’esprit que cette illusion possède et qui par là même s’identifie avec elle peut-il trouver place dans ce monde, spectateur mobile d’un immobile spectacle ? Une telle hypothèse est la négation même de la vie. Le passé n’existe plus que dans la mesure où il se survit dans notre présent et notre avenir n’existe encore que dans la mesure où notre présent le contient et le réalise. Notre erreur est toujours de substituer la vie représentée à la vie vécue, en oubliant que la vie vécue est la réalité dont la vie représentée n’est que l’apparence. Des changements s’opèrent dans l’univers réel qui se traduisent à nos sens par les métamorphoses qualitatives de l’univers sensible. Mais la substance même de l’univers persiste sous ces changements et nous apparaît dans l’immutabilité de l’espace et de la matière. La matière nous révèle la permanence des êtres comme l’espace l’indivisible unité de la Nature. Et comme nos sensations changeantes se succèdent dans l’espace immuable, elles participent en quelque [p. 483] mesure de l’immutabilité de l’espace. Parce que nous pouvons les évoquer à nouveau, nous nous persuadons qu’elles y peuvent subsister à jamais. Ainsi, nous étendons au détail des faits ce qui n’appartient qu’à l’ensemble des êtres, nous utilisons la permanence de notre esprit et celle de l’indivisibilité absolue de l’univers pour rendre simultané ce qui est successif, et dès lors tout est donné. Mais cette simultanéité est l’oeuvre de notre mémoire qui conservant en elle tout à la fois le détail des phénomènes successifs et l’ensemble immuable de l’espace les joint l’un à l’autre en une immobile vision. Ce monde où tout est donné n’existe que pour l’être conscient qui change sans cesse, et n’est à vrai dire qu’un de ses états éphémères.
Il en va de même en ce qui concerne le sentiment et la volonté qui nous semblent recéler de l’inconscient dans la mesure où leur nature échappe à la connaissance conceptuelle. Comme nous nous rendons compte en certains cas des motifs de nos actions, et que nous nous eiïbrçons toujours d’avoir de nos sentiments une conscience claire, nous appliquons à notre action spontanée ce que nous observons de notre action réfléchie. Toutes les fois que nous avons agi sous la poussée obscure d’un sentiment ou sous l’influence confuse d’un idéal vaguement entraperçu, nous essayons après coup de déterminer abstraitement le motif de notre action et de préciser notre idéal. Nous disons alors que nous avons obéi à des mobiles dont nous n’avions pas conscience. Mais les représentations dont nous faisons ainsi après coup les motifs abstraits de nos actes n’existaient pas au moment où nous agissions. L’inconscient n’est ici encore que du présent conscient illégitimement transposé dans le passé, et comme la conscience que nous avons du passé exclut formellement la conscience de ce présent, nous baptisons ce présent « inconscient » pour masquer la contradiction où nous tombons ainsi d’une manière inévitable. Nous affirmons que ce présent était passé, mais inconscient.
Or, comme chacun de nos sentiments et de nos actes aboutit à quelque effet, nous pouvons toujours regarder l’effet comme ayant été expressément quoique inconsciemment voulu et l’ériger ainsi en motif. Nous faisons alors de l’effet une fois produit la cause de l’action une fois accomplie. Or une telle conception est en opposition absolue avec l’intuition que nous avons de notre être. [p. 484] La finalité, entendue de cette manière, implique la même erreur que le mécanisme. Elle vient de ce que nous nous représentons la vie vécue au moyen des concepts, et la durée réelle au moyen de l’espace.
Qu’il s’agisse de la volonté ou de la mémoire, l’erreur dérive donc toujours des mêmes causes. Le dynamisme objecte au mécanisme que tout n’existe pas nécessairement en acte. Mais lui-même conçoit le virtuel sur le modèle de l’actuel. « Ce que nous voulons effectuer, dit-il, n’est pas encore effectué, mais tend à s’effectuer, et par conséquent existe. » Or en raisonnant ainsi il pose avant l’action le résultat futur de l’action. C’est toujours le même procédé parce que toute tendance peut se satisfaire un moment dans un idéal défini, on s’imagine que l’idéal était la fin inconsciente de la tendance ; parce que la vie réelle de l’univers peut être représentée après coup dans l’intelligence, on en conclut que la vie réelle de l’univers est contenue tout entière dans la représentation et ne consiste que dans ce que la représentation nous offre l’étendue et le mouvement. Le dynamisme tombe dans l’erreur qu’il reproche au mécanisme, car si le mécanisme nie toute virtualité en affirmant que tout ce qui existe, existe en acte, le dynamisme de son côté, en identifiant le virtuel et l’inconscient, actualise le virtuel. Il affirme que le virtuel existe, et existe en acte, mais dans l’inconscient. Il confond par suite le virtuel et l’actuel, méconnaît l’originalité propre du virtuel. Pour lui, ce qui existe en puissance, existe déjà en fait, mais sans être perçu. La volonté est incommensurable à l’entendement, l’action de l’être conscient est irréductible aux formes de sa représentation de l’univers ; or c’est réduire la volonté à l’entendement, l’action à la représentation que de supposer que ce qui sera existe sans être perçu. Car, dès lors, c’est le simple fait d’être perçu qui différencie ce qui existe en acte de ce qui n’existe qu’en puissance. Le vouloir n’existe plus en tant que tel l’action n’est que le passage d’une représentation à une autre et par conséquent d’un état passif à un autre état passif. Pour s’en tenir à l’immédiatement donné, il faut prendre le virtuel tel qu’il s’offre à nous dans l’intuition que nous avons de notre volonté. Il faut éviter de reconstruire notre propre existence, telle que nous la vivons, à l’imitation de l’existence d’autrui, telle qu’elle nous apparaît. [p. 485]
IV
Ce que nous faisons ici pour nous-mêmes, nous pouvons l’étendre à la nature entière. De là la conception classique de la finalité naturelle. Ce que la Nature a réalisé à un moment donné de son histoire est posé après coup comme une fin qu’elle se proposait expressément de réaliser. Ce qui a été une phase de la vie universelle devient le plan d’action de l’univers ; ce qui a été la vie vécue par la nature est supposé par nous avoir été une représentation directrice de la vie. Tout l’avenir existe donc déjà sous forme de représentation inconsciente. Quoi que la Nature puisse produire, elle ne fait qu’exécuter un programme dont les parties se trouvent simultanément imprimées et placardées dans l’éternel. L’expérience nous atteste qu’il se forme sans cesse de nouveaux êtres, mais rien ne nous autorise à supposer que cette création se conforme à un programme rédigé d’avance. Pourtant il faut que les hommes se représentent objectivement l’évolution de l’univers; dès qu’ils y perçoivent un certain ordre, cet ordre devient un plan préconçu. Et la Nature récite un rôle appris d’avance au lieu d’être un artiste inspiré.
Cette erreur initiale en provoquait une autre. Une représentation inconsciente étant une contradiction dans les termes, la tentation était forte de supposer une conscience dans laquelle existât le programme définitif de la vie universelle. Ou, pour parler d’une manière plus précise, la représentation de l’ordre total étant un état de conscience emportait avec elle la pensée d’une conscience totale de l’univers. De là l’idée d’une intelligence divine qui entraînait à son tour celle d’un Dieu architecte, présidant à toutes les démarches du monde.
Et en effet toute l’histoire de l’univers étant déjà représentée, le passé, le présent, l’avenir existent de toute éternité le temps devient une illusion de l’esprit. Mais cette illusion elle-même, comment est-elle possible et que signifie-t-elle ? Que vient faire dans l’immense obscurité de l’éternel cette petite clarté que nous nommons le présent ? Pourquoi se promène-t-elle ainsi sur la surface du réel ? Pourquoi vient-elle constituer, par son perpétuel devenir, une infraction à la règle de l’universelle immutabilité ? [p. 486] Les métaphysiciens qui ont escamoté la vie du monde doivent en laisser subsister cette dernière et misérable parcelle le devenir est un fait contre lequel rien ne saurait prévaloir, et après l’avoir nié autant qu’on l’a pu, on doit lui reconnaitre encore l’existence. Mais alors d’où vient que l’histoire du monde, donnée tout entière dans l’éternel, se réalise partiellement dans le présent ? D’où vient que toutes les phases de la vie universelle qu’on a supposé d’abord exister d’une manière simultanée se dévoilent à nos yeux d’une manière successive ? La réalisation progressive de l’histoire du monde devient ainsi un nouveau problème dont le Dieu architecte est la solution. La volonté divine réalise ce que l’intelligence divine a conçu. Le malheur c’est que cette volonté divine reconstitue intégralement, dans son absolue originalité, la puissance créatrice qu’on prétendait analyser. On voulait éliminer, au moyen d’une représentation équivalente, la notion de volonté ou dévie. Et voilà que cet équivalent prétendu traîne à sa suite la notion même qu’il doit remplacer. On n’a pas vu que la conception du Dieu architecte faisait double emploi avec la vie réelle de la Nature. Dès que le devenir est perçu, la puissance créatrice est donnée dans son originalité irréductible. En supposant un plan qui la guide, on prétend la rendre plus claire, mais l’adjonction de ce plan ne modifie pas sa nature, car, en tant que puissance créatrice, elle demeurera toujours incommensurable aux formes de la représentation, et l’on ne sera pas plus avancé pour avoir calqué l’activité du monde sur la volonté réfléchie de l’homme. La vie est un absolu un essayera vainement de la décomposer en éléments différents d’elle.
Ainsi l’hypothèse d’un Dieu extérieur au monde est inutile, et cependant les philosophes qui prétendent s’en passer ne nous satisfont pas plus que les autres. En effet, dès qu’un certain ordre existé dans le monde, il ne sert à rien de l’expliquer par le hasard, puisqu’on fait jouer au hasard le rôle de la Providence. Une force absolument aveugle qui agit en fait comme si elle réalisait un plan, ou un système de forces aveugles qui se comportent comme si elles concouraient consciemment, nous ramènent, en somme, à la conception du plan inconscient de la Nature. [p. 487]
V
Comment échapper à ces difficultés ? Si la nature du réel est telle que l’intuition seule la puisse saisir, la philosophie qui se traduit nécessairement par des concepts demeure, dans une certaine mesure, impuissante à l’exprimer tout entière. Et, cependant, nous ne pouvons nous résigner à rester enfermés dans notre intuition. Il faut que nous la communiquions aux autres hommes, et comment la leur communiquer, sinon par le langage ? Le sentiment de cette difficulté a eu pour résultat de modifier la forme de la métaphysique celle-ci peut être en effet architecturale, dramatique ou musicale. La philosophie de Kant nous offre un type du premier genre. Les différentes pièces de son système se soutiennent et s’étagent depuis la base jusqu’au sommet, et Schopenhauer a même pu relever dans ce vaste édifice de fausses fenêtres pour la symétrie. Platon nous a donné de son côté un exemplaire, demeuré unique, du second type. Ce n’est pas seulement en effet par le récit ou le dialogue que les écrits de Platon sont des drames. Chez lui, les idées elles-mêmes vivent et agissent, et les différentes parties de la doctrine entrent en scène à la manière des personnages d’une tragédie, au lieu de se superposer, comme chez Kant, en une armature rigide. Enfin nous trouvons le troisième type avec M. Bergson. L’œuvre de ce dernier peut se comparer à une symphonie. Nous n’éprouvons pas devant elle le sentiment que nous ressentons à l’aspect des grandes constructions des philosophes antérieurs elle ne nous frappe pas par sa grandeur et par sa masse, non plus que par la solidité de sa charpente. En revanche, elle est d’une souplesse qui lui donne une inépuisable puissance de suggestion et semble lui assurer une existence presque indéfinie. La pensée ne s’y déroule que dans la durée pure, et ressort du rythme plus que des mots. Or une métaphysique qui prétend saisir la vie devra s’éloigner de la forme architecturale, pour se rapprocher de la poésie et de la musique. Et la philosophie de M. Bergson en est une preuve. Le fond et la forme en sont solidaires.
Et pourtant une telle philosophie ne saurait, malgré tout, atteindre pleinement le but qu’elle se propose. Elle peut sans doute [p. 488] suggérer l’intuition, placer les esprits dans une disposition qui leur rende plus aisé l’effort nécessaire pour pénétrer le fond dernier des choses. II n’en est pas moins vrai qu’elle est incapable, en un certain sens, d’exprimer la vie intime de la Nature. Elle-même le reconnaît, et comment pourrait-elle le nier, puisque la métaphysique, du fait même qu’elle recourt au langage, est un effort pour traduire en termes de représentation ce qui, par essence, échappe aux formes de la représentation ? Il est significatif à cet égard que M. Bergson ait conservé la notion de l’inconscient quoiqu’elle fût en opposition avec son intuition de la durée. Dire, comme il le fait, que pour les souvenirs et les images, il n’y a qu’une différence de degré et non de nature entre être et être consciemment perçus, c’est dire qu’entre deux choses dont l’une est la négation de l’autre il n’y a qu’une différence de degré, ce qui est contradictoire. Admettre, en particulier, que notre passé subsiste intégralement sans que nous en ayons conscience, c’est le soustraire à la durée réelle. Rejeter la forme du système ne suffit pas. Il faut sortir de la philosophie elle-même.
Le problème étant en effet de s’exprimer par le rythme aussi bien que par les mots, il est un mode de pensée et de langage qui atteint la vie même des choses c’est la poésie. L’importance attachée par M. Bergson à la forme littéraire de ses ouvrages, et la haute valeur d’art qu’il a donnée à ceux-ci, tire précisément son origine du besoin de recourir à l’inspiration poétique pour retrouver le mouvement du réel. Richard Wagner a dit de la musique de Beethoven qu’elle tendait naturellement vers la poésie et avait fini par la rejoindre. M. Édouard Schuré, dans son beau livre sur le Drame musical, s’est efforcé, à son tour, de démontrer que toute l’évolution de la musique d’une part, et toute l’évolution de la poésie de l’autre, tendaient à l’union de la musique et de la poésie comme à leur fin naturelle. Ce que Wagner disait de la musique de Beethoven, on peut le dire de la philosophie de M. Bergson, et peut-être essayera-t-on quelque jour de le démontrer pour toute l’évolution de la métaphysique. En fait, toute haute métaphysique rejoint la grande poésie, et il n’est pas un seul grand système qui n’ait une valeur poétique. Inversement la poésie et l’art nous donnent une claire conscience du réel, mais sous forme de révélation et non plus de démonstration : non seulement les chefs-d’œuvre de l’art [p. 489] constituent déjà par eux-mêmes de véritables révélations métaphysiques, mais encore les grands artistes ont eu expressément conscience de ce fait. Bien plus, ils ont volontairement cherché à exprimer le fond des choses. Beethoven disait de la musique qu’elle est une révélation plus haute que la sagesse et la philosophie ; il nous a donné dans la Symphonie héroïque une conception du surhomme qui pourrait être utilement mise en parallèle avec celle de Nietzsche ; et sa cinquième symphonie en ut mineur, et sa neuvième symphonie, constituent à coup sûr une éthique et une métaphysique de la volonté qui sont tout à la fois la contre-partie et le complément de la philosophie de Schopenhauer. Wagner l’a suivi dans cette voie, et il a prétendu manifester par le triple moyen du drame, de la poésie et de la musique ce que Beethoven exprimait par la musique pure. Ainsi, tandis qu’un philosophe moderne appelle l’art au secours de la philosophie, des artistes sollicitent de la philosophie un concours du même genre et renforcent volontairement la portée métaphysique de leur art.
Nous ne voudrions pas d’ailleurs qu’on se méprît sur notre pensée. Si légitime et si désirable que nous semble l’union de la poésie et de la métaphysique, nous ne prétendons nullement méconnaître les droits de la métaphysique à une existence indépendante. En demandant, avec M. Bergson, que la poésie et l’art complètent la philosophie, nous ne voulons pas non plus exalter un moyen d’expression aux dépens d’un autre. Mais considérant les chefs-d’œuvre de l’art comme des moyens d’expression du réel au même titre que les systèmes philosophiques, nous voulons les faire concourir avec ceux-ci, et multiplier, par ce concours même, les moyens d’expression du réel. Pour cette raison, nous croyons que la critique d’art ne doit pas se borner à l’étude technique des chefs-d’œuvre, mais s’élargir jusqu’à la critique philosophique, et que l’histoire de la philosophie ne doit pas, de son côté, se limiter aux seules œuvres proprement philosophiques, mais embrasser aussi la littérature et l’art. En d’autres termes, nous pensons que la métaphysique dépasse à certains égards l’art et la poésie, puisqu’elle traduit le réel en symboles plus clairs et plus maniables, mais qu’elle reste à d’autres égards inférieure et demeure en quelque sorte à mi-chemin entre la poésie et la science.
Le monde de la représentation est le monde de l’apparence. Or [p. 490] ce monde est précisément, celui qu’étudie la science. Il en résulte que la science est impuissante à saisir la véritable réalité et, de ce point de vue, on peut se demander si le poète n’a pas un avantage réel sur le savant. Un préjugé contraire au poète vient de ce que l’idée de poésie est associée avec celle de fiction. Mais rien n’est plus illégitime que cette association si l’on prétend l’étendre à toutes les formes de la contemplation poétique. Elle perd toute valeur lorsque le poète ajoute aux données de la science sa propre puissance d’intuition. Si l’être et la vie ne font qu’un, en effet, la poésie qui nous fait vivre de la vie des choses est plus profonde que la science qui nous en montre seulement les manifestations extérieures. Et en ce sens, quoique en ce sens seulement, on peut dire qu’il y a plus de vérité dans la poésie que dans la science. De là, la nécessité d’une poésie qui s’inspire des découvertes de la science, et se serve de celles-ci pour restituer à notre représentation de l’univers la vie intérieure que la science en a chassée. La poésie doit donc tenter pour elle-même et par ses propres moyens ce que la métaphysique avait considéré jusqu’ici comme son rôle propre unifier les résultats de la science par une intuition plus pénétrante du réel (4). Et cette nouvelle fonction du poète se justifie par les conclusions mêmes auxquelles aboutit la, métaphysique moderne.
Si la conscience de notre vie individuelle constitue pour chacun de nous la vérité la plus certaine, la vie universelle est en revanche la vérité la plus haute à laquelle nous puissions parvenir. Comme la conscience d’un être est toujours à quelque degré le miroir de l’univers, et que sa puissance se trouve constamment entravée ou favorisée par celle de la Nature, le sentiment de la vie individuelle se lie à celui de la vie universelle, mais par des modes différents de conscience chez les différents êtres. Nous ne pouvons que très vaguement imaginer ce que peut être ce rapport de la vie intime [p. 491] de la plante à la vie intime du monde extérieur. Nous n’avons guère une représentation plus nette de ce qui se passe chez l’animal, comme le prouve notre étonnement devant les merveilles apparentes de l’instinct, et plus particulièrement devant le miracle permanent de l’instinct sexuel et de l’amour maternel ou paternel, toutes choses qui devraient nous paraître infiniment simples si nous comprenions comment l’âme de l’animal communie avec l’univers entier. Mais notre intelligence échoue parce qu’elle se transpose elle-même dans l’âme de l’animal, comme si celui-ci participait à la vie universelle au moyen de l’intelligence, alors que la solidarité de l’individu au tout est ici perception et affection, non perception et conception comme chez l’homme. L’intuition du poète est ici plus profonde que celle du penseur et, mieux que lui, perçoit, sous le voile menteur des couleurs et des formes d’un jour, l’activité incessante de la matière et de l’âme, et l’unité de la Nature éternelle. C’est qu’en effet le poète s’est habitué à vivre par la contemplation de la vie même de la Nature, à se sentir en elle et à la sentir en lui. Il se rapproche ainsi d’un état où le connaissant et le connu coïncideraient, tandis que le penseur cherchant à prendre possession de la nature sans vouloir être possédé par elle, rend en quelque sorte plus forte en lui l’opposition du sujet et de l’objet, et se condamne ainsi à ne voir du monde que ses dehors, ou la représentation, à l’exclusion de son dedans, qui est la volonté. La Nature ne livre pas son secret au savant parce qu’il demeure pour elle un étranger, mais elle ne le cache pas au poète, qui a pris soin de se familiariser avec elle. Si le savant ne partage pas les préjugés du vulgaire, il en a souvent d’autres qui dérivent d’une extension illégitime des méthodes scientifiques à la totalité de la connaissance. Il méconnait par là le profit qu’on peut tirer d’une vue synthétique de la nature. Pourtant, dans la mesure où ses observations le forcent à vivre dans la familiarité de la Nature, il finit par adopter, en quelque sorte à son insu, l’attitude de l’artiste, non sans doute dans le détail de ses expériences, mais dans la vision d’ensemble qu’il prend après coup de leurs résultats. Claude Bernard avait un juste sentiment de cette vérité, lorsqu’il disait que le savant, le poète et le philosophe parleraient un jour le même langage. Au fond, d’ailleurs, l’abîme est-il si grand entre les point de vue du savant, du philosophe et de l’artiste ? S’identifier [p. 492] avec les choses pour les comprendre, sauf à concentrer son attention sur un aspect particulier du réel selon la fin qu’on se propose, n’est-ce pas là la quintessence des procédés du savant, du poète, de l’artiste et du philosophe, le dernier mot de la contemplation esthétique, comme de l’observation scientifique, de la méthode mathématique comme de la réflexion philosophique?
Le but suprême de la science comme de la philosophie serait donc la reconstitution de la vie universelle. Le monde a son histoire qui se ne recommence point. Or nous ne pouvons nous expliquer le monde sans recourir à cette histoire. La présence des anneaux de Saturne, l’aplatissement de la Terre au pôle et son renflement à l’équateur, l’incandescence du soleil, ne sont intelligibles pour nous que par l’hypothèse d’une évolution générale de notre système planétaire. Nous ne comprenons la constitution actuelle de notre univers que lorsque nous sommes capables de nous représenter la genèse et la dissolution des mondes. Chacun des états, chacune des phases de l’univers dépend des états et des phases antérieures et s’explique par eux. Pour connaitre la Nature, il ne suffit pas d’en établir les lois éternelles, il faut encore se replacer dans son réel devenir. Par là nous sommes amenés à concevoir qu’il existe dans le monde une véritable continuité interne de vie, puisque le passé de l’univers persiste en quelque manière dans son présent. Les évolutions et les dissolutions qui s’accomplissent dans l’univers, que ce soient celles des corps inorganiques ou celles des sociétés, celles des organismes vivants ou celles des systèmes planétaires, sont ainsi subordonnées à la vie de l’ensemble, chaque phase de l’évolution universelle ayant sa répercussion sur les autres, et chaque destruction d’univers son influence sur la formation des univers futurs.
On peut ainsi se demander si le savant, à mesure qu’il tend vers une connaissance plus complète du réel, n’adopte pas, en un certain sens, le point de vue propre au poète. Boileau disait de la physique de Descartes qu’elle avait coupé la gorge à la poésie. La raison en est qu’elle s’en tenait au pur mécanisme et ne définissait la matière que par l’étendue et le mouvement. Mais la physique de Descartes n’a pu subsister. Et, avec la gravitation universelle que Leibnitz considérait à juste titre, du point de vue cartésien, comme une qualité occulte, avec les attractions, les répulsions, les [p. 493] affinités chimiques, avec la théorie de l’évolution, la science tend de plus en plus à pénétrer la vie réelle des choses. Elle se rapproche, bon gré, mal gré, de la métaphysique et de la poésie, en prenant une conscience plus profonde de la force et du devenir. C’est qu’au fond la pensée humaine est une, quelle que soit la diversité des objets auxquels elle s’applique, art, science, poésie, métaphysique, répondant, chacun à sa façon, au même désir, chacun reflétant dans la conscience humaine les multiples aspects de la vie innombrable.
ANDRÉ JOUSSAIN.
NOTES
(1) J’emploie le mot impersonnel faute d’un meilleur. Il ne s’agit pas ici de la personnalité, mais de l’individualité. Les altérations de la personnalité, telles que les ont étudiées MM. Ribot et Pierre Janet, par exempte, ne sauraient entamer l’individualité psychique.
(2) On voit par là que les historiens de la philosophie tombent dans l’erreur quand ils regardent les philosophies de Hume et de Kant comme le développement logique de la doctrine de Berkeley. Je n’insiste pas sur ce point, ayant eu occasion de montrer ailleurs que Berkeley bien compris eût rendu Hume impossible. Cf. Le Rêve d’un métaphysicien, ch. III (Paris, 1906).
(3) A cela près qu’il identifiait la conscience avec la raison, d’ou résulte sa théorie de l’automatisme des animaux, un être sans raison devenant nécessairement un être sans conscience. Mais c’est un point que nous pouvons négliger ici.
(4) Les œuvres littéraires qui s’efforceront de remplir ce rôle peuvent être extrêmement variées. En ce qui me concerne, je crois il la nécessité d’une épopée terrestre qui serait à la civilisation moderne ce que les poèmes épiques et les romans de chevalerie ont été à des civilisations antérieures. De cette forme d’art nouvelle, j’ai donne une première esquisse dans le Poème de la Terre (Les Chants de l’Aurore, III, 15), avant de tenter l’expérience sur un plan plus large (Anthologie néo-romantique, pp. 18 et 81). Mais ces courts fragments ne peuvent donner qu’une idée fort imparfaite de ce qu’on pourrait tenter en ce genre.
André Joussain

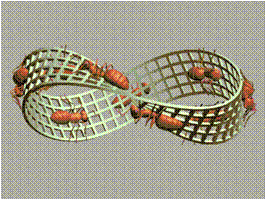

LAISSER UN COMMENTAIRE