 Edouard Pichon. La famille devant M. Lacan. Article parut dans la « Revue française de psychanalyse », (Paris), tome XI, fascicule 1, 1939, pp. 107-135.
Edouard Pichon. La famille devant M. Lacan. Article parut dans la « Revue française de psychanalyse », (Paris), tome XI, fascicule 1, 1939, pp. 107-135.
Edouard Pichon (1890-1940), médecin, spécialité pédiatrie, et psychanalyste, l’un des 12 fondateurs de la Société psychanalytique de Paris. Il fut le gendre de Pierre Janet.
Un texte important qui critique l’article de Jacques Lacan écrit et publié dans une première mouture, à la demande de Henri Wallon pour l’Encyclopédie française, puis, après de multiples corrections et révisions, parut dans le volume VIII de l’encyclopédie, intitulé La Vie mentale, en 1938.
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original, mais avons corrigé les fautes d’impression. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr
Les pages 131 à 137 manquent dans notre exemplaire, ainsi que sur l’exemplaire de le B.n.F. Nous avons donc emprunté ces pages dans la réédition qu’en a faite la revue Confrontation au printemps 1980.
[p. 107]
LA FAMILLE DEVANT M. LACAN·
par Edouard Pichon
I
1
Voilà M. Jacques-Marie Lacan élu membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris ; certes, il devient ainsi quelque chose ; mais, heureusement pour lui, il n’avait pas attendu nos suffrages pour être quelqu’un. C’est en effet à juste titre que M. Lacan passe pour un des esprits les plus brillants de la jeune génération psychiatrique française.
C’est pourquoi il serait de l’intérêt de tous les psychopathologistes qu’il se dégageât d’une certaine cuirasse où son esprit se chartre : cuirasse faite à la fois d’un jargon de secte et d’une préciosité personnelle. Ses ouvrages en sont déparés.
Ce n’est pas que je réprouve tout modelage conscient de soi par soi : le recherché peut être exquis, et les esprits distingués avoir raison de ne point se prostituer aux goûts du vulgaire ; mais, dans le cas particulier, il ne me semble pas que M. Lacan ait choisi pour son esprit, que toute sa formation tant héréditaire que familiale et sociale fait français, une parure qui lui convienne. Un de ses aînés, qui a été quelque peu son maître et qui est resté son ami, ai, je crois, le droit de le lui dire, et peut-être, si je suis écouté, M. Lacan, qui est encore tout florissant de bel âge, pourra-t-il bientôt donner ce qu’on attend de lui.
2
Les réflexions qu’on vient de lire me sont inspirées par la lecture attentive de l’article sur la famille que M. Jacques Lacan vient de publier dans l’Encyclopédie française, mise en chantier par M. Anatole de Monzie. Chacun sa petite performance : [p. 108] M. Lacan a lu Hegel et Charles Marx ; mais nous, nous avons lu M. Lacan. Et lire M. Lacan, pour un Français, c’est comme on dit familièrement, du sport ! Je crois qu’on peut oser le lui dire, car il sait écrire, et bien écrire : beaucoup de passages de ses ouvrages nous en convainquent. Les difficultés dont son style est cuirassé sont donc des blindages dont il se carapace secondairement, pour ne se montrer que sous l’aspect prémédité de chevalier de telles ou telles confréries.
Tous les professeurs d’anglais apprennent à nos enfants à se méfier des traîtrises de la similitude apparente de tels mots anglais avec des termes de notre langue, M. Lacan aurait dû se souvenir que l’allemand demandait des précautions de même ordre. Comme il lui a plu de ne pas se le rappeler, il écrit souvent avec des mots français, en n’y entendant, c’est le cas de le dire, que le haut-allemand.
Depuis longtemps, la langue française distingue entre la civilisation, fait collectif, et la culture, fait personnel. M. Lacan oublie cette distinction ; sans cesse, il dit culture pour civilisation, et cela nuit, en plusieurs passages, très nettement à la clarté du sens. L’on pouvait espérer pourtant que les grosses blagues qu’on faisait en France pendant la guerre de Quatre Ans sur la « coultour » allemande auraient eu au moins pour résultat de faire pénétrer dans des milieux assez étendus la discrimination entre culture et civilisation. Ce n’est servir ni la véritable culture, ni la civilisation propre à notre peuple que d’en adultérer ainsi la conception.
De même, M. Lacan germanise dans l’emploi qu’il fait du mot dialectique. Les auteurs français les plus classiques se sont servis de ce mot pour exprimer l’ensemble des ressources que les argumentateurs tirent d’une logique habilement, voire trop habilement, maniée. Aussi bien διαλεχτιχή a-t-il ce sens dès Platon. Honnête Français, qui savez tout cela, abordez un texte de M. Lacan, ce texte vous restera lettre close ; vous lirez avec ahurissement que le masochisme primaire est un « moment dialectique » ! C’est que dialectique, dans Lacan, a un sens purement allemand, dont il faut aller chercher la clef dans Hegel et dans Marx. L’Encyclopédie est certes bien inutile, si elle présuppose que ses lecteurs sont déjà initiés à l’hégélianisme et au marxisme au point d’en avoir assimilé, sans la transposition d’ailleurs nécessaire, le vocabulaire étranger. [p. 109]
Il y a plus encore, et plus indéfendable. Tous ceux qui ont réfléchi, ne fût-ce qu’un instant, à la question de la formation mentale de l’enfant, savent quel problème ardu c’est que de distinguer les éléments psychiques biologiquement transmis d’avec ceux qui résultent des paroles et des exemples fournis par les éducateurs. A l’hérédité s’oppose ainsi la tradition : le problème est clairement posé. Mais n’oublions pas que le terme « tradition » est proscrit ; ne savez-vous pas qu’il sent son réactionnaire et son bourgeois ? Aussi, paraît-il, un M. Conn a-t-il créé, pour exprimer, entre les générations, la « continuité psychique dont la causalité est d’ordre mental » le terme d’hérédité sociale. Fallait-il faire un sort à cette sottise ? M. Lacan l’a cru. Il ne rapporte peut-être ce terme qu’avec une certaine ironie, mais alors bien secrète ! Certes il reconnaît que ce terme est « assez impropre en son ambiguïté » (tu parles !), mais il ne le monte pas moins en épingle. Or, en vérité, ce M. Conn fait comme nos politiciens, qui ont résolu le problème des sergents de ville, des monts-de-piété, des asiles de fous, etc., en les appelant respectivement des gardiens de la paix, des établissements de crédit municipal et des hôpitaux psychiatriques.
D’autres fois, la bizarrerie vocabulaire ne paraît pas avoir d’autre but que d’étonner. Pour melting-pot, par exemple, bien des lecteurs français ignorent ce que cela veut dire. Pour ma part, ce n’est qu’en recourant à un dictionnaire anglais que je l’ai appris. M. Lacan croit-il sérieusement que ce terme lui était indispensable pour dire que Vienne-en-Autriche, entre 1860 et 1914, était le lieu de rencontre et de compénétration des mœurs les plus diverses ?
Le recours à un mot impropre est un des effets qu’aime M. Lacan ; mais une impropriété n’est jamais sans nuire à la portée même des idées de son auteur. Le français, langue délicate, ayant déjà demander, réclamer, exiger, etc., réserve depuis longtemps postuler, dans la disance philosophique, à une exigence d’ordre logique : telle affirmation, dit-on, postule qu’on ait admis telle prémisse. C’est pourquoi j’ai relu trois fois la phrase suivante : « les conditions de milieu que postule le développement des jeunes… » M. Lacan voulait-il vraiment dire que le fait que les jeunes pussent se développer était une preuve que certaines conditions de milieu étaient réalisées ? Finalement, je ne le crois pas ; 1’auteur semble vouloir simplement dire que le développement [p. 110] des jeunes exige certaines conditions de milieu. Mais alors qui le condamnait à employer « postuler », que le désir de recourir à un terme inattendu, qui déroutât et « épatât » un instant le lecteur ?
De même, dire que M. Freud a imaginé le complexe d’Œdipe, c’est laisser entendre qu’on ne croit pas à l’exactitude de cette sienne conception ; or, il semble bien que M. Lacan ait voulu dire que le maître de la psychanalyse avait découvert l’existence de ce complexe.
Pourquoi dérouter les gens en employant les bons vieux mots hors de leur sens ? Et pourquoi refuser de se servir des termes ordinaires quand on a précisément à exprimer l’idée qu’ils véhiculent ? Civilisation, tradition, exiger étaient à la disposition de M. Lacan comme des autres Français. Le néologisme n’est légitime que pour introduire dans un idiome donné une idée nouvelle ; et il doit alors ne pas prêter à l’équivoque.
Reproches de pure forme, dira-t-on ? Ce serait être bien mauvais psychologue. L’usage que l’on fait du langage est révélateur d’attitudes mentales profondes. Ne pas appeler la tradition par son nom, au moment même où l’on en reconnaît l’importance, c’est un reste affectif de scotomisation. Parler de « moment dialectique » en français, pour dire que le masochisme est un compromis qui résout tant mal que bien une antinomie conflictuelle, c’est se guinder dans une attitude d’école qui fasse éructer les Quirites. J’éructe en effet : M. Lacan sera content.
II
1
La pensée de M. Lacan marche, je viens de le dire, dans une colonne de nuées sombres, mais gravides, dont par déchirement naît et jaillit çà et là une étincelle de lumière. Dépouillons-la, mettons la belle nue, cette pensée à la robe d’orage ; elle en vaut la peine. Car l’essentiel de la doctrine de M. Lacan est vrai. Il a raison et archi-raison de montrer combien il est vain de construire des théories biologiques de la libido, de la famille, de la névrose, etc…, alors que l’on n’a, pour soutenir de telles doctrines, aucun [p. 111] commencement de preuve dans les faits. J’ai trop souvent, moi aussi, dénoncé cette vicieuse et tendancieuse extrapolation pour ne pas applaudir de toute ma force M. Lacan quand il en fait comprendre la vanité. Biologiquement, explique-t-il, il n’y a pas de famille, il n’y a que la parenté ; la structure des familles humaines est strictement civilisationnelle, comme le montre, remarque judicieusement notre auteur, le rôle que l’adoption a pu jouer dans certains types de familles humaines. Plus encore que d’hérédité, la famille est un agent de tradition. Voilà les vérités indéniables que M. Lacan a le mérite de proclamer dans l’introduction à son travail. Cette introduction se termine sur une vue historique cavalière de l’évolution réelle de la famille : Durkheim y est nommé, mais Fustel de Coulanges flotte en une présence efficiente ; quoi que l’on pense du caractère peut-être décevant de tout exposé historique aussi violemment ramassé, on ne peut qu’approuver hautement M. Lacan d’affirmer qu’il est plus désireux d’éclairer l’étude de nos mœurs par « les institutions positivement connues de la famille ancienne que par l’hypothèse d’une famille élémentaire qu’on ne saisit nulle part ». La critique de M. Lacan, évidemment dirigée ici contre certains développements particulièrement aventureux du freudisme, se trouve rejoindre non seulement la mienne, mais encore celle de M. Dalbiez. Je crois que la question est jugée. M. Lacan y reviendra cependant, nous le verrons. Ce préambule se clôt par la première apercevance du rôle que jouera, dans l’évolution de la famille, une institution d’importance capitale, celle même que l’on sait être selon moi le fondement essentiel de toute notre civilisation : le mariage. Il en sera reparlé plus loin.
2
A cette introduction succède un premier chapitre, intitulé : Le complexe, facteur concret de la psychologie familiale. Comme le fait très judicieusement remarquer M. Lacan, la recherche concrète des efficiences psychologiques de l’ordre familial « n’objective jamais des instincts, mais toujours des complexes ».
Des instincts, d’ailleurs, y en a-t-il chez l’homme ? « L’espèce humaine, nous disait l’auteur dans son introduction, se caractérise… par une économie paradoxale des instincts, qui s’y [p. 112] montrent essentiellement susceptibles de conversion et d’inversion et n’ont plus d’effet isolable que de façon sporadique. » Je vais plus loin : si la virtualité monotone qui pousse tel animal à refaire son nid exactement de même forme, au moyen de matériaux des mêmes sortes, sans changement possible, s’appelle un instinct, y a-t-il vraiment un grand avantage scientifique à donner le même nom d’instinct à la réserve d’énergie libidinale qui, comme notre prétendu « instinct sexuel », est précisément sujette à animer, suivant les hommes, des désirs et des réalisations d’ordre si divers ? Non, selon moi, il n’y a là aucun avantage; et c’est un des mérites de l’école psychanalytique française que d’avoir habitué les psychanalystes et les psychologues à penser pulsions, énergie libidinale, affects, aimance, beaucoup plutôt qu’instincts.
« Le complexe, selon M. Lacan, lie sous une forme fixée un ensemble de réactions… ; il reproduit une certaine réalité de l’ambiance… Son activité répète dans le vécu la réalité ainsi fixée, chaque fois que se produisent certaines expériences qui exigeraient une objectivation supérieure de cette réalité » ; ce qui veut dire que, selon notre auteur, le complexe ne représente pas seulement une étape de l’affectivité, mais une étape de la connaissance. Les complexes jouent un rôle d’organisateurs, et motivent comme tels, « non seulement des justifications passionnelles, mais d’objectivables réalisations ». Une pareille vue est une adhésion à la loi d’appétition (1) ; aussi bien M. Lacan s’est-il simplement laissé instruire comme moi par l’observation des patients, et notre commune tendance à mettre en évidence les stimulations affectives dans la genèse de la connaissance n’est-elle que le développement naturel du plus précieux des germes engendrés par le génie de M. Freud.
Mais dans sa conception élargie du complexe, M. Lacan, il l’avoue, s’est vu amené à donner place aux « phénomènes conscients de structure semblable. Tels les sentiments… » J’aurais, à la vérité, préféré que M. Lacan, tout en soutenant la même doctrine, réservât, aux fins de clarté, le nom de complexes aux constellations affectives en état de conscience virtuelle (i.e. « inconscientes »). Les termes d’affects, de [p. 113] sentiments, et bien d’autres, auraient suffi aux besoins de la description de l’affectivité dans l’état de conscience effective.
Loin, d’ailleurs, que, pour M. Lacan, la notion de complexe ait besoin de s’appuyer sur celle d’instinct, comme l’avait cru M. Freud, c’est au contraire peut-être celle d’instinct qui pourrait être éclairée par celle de complexe ; voilà une voie originale, que notre docteur nouveau indique nettement ; il reste à la frayer.
M. Lacan ne passe d’ailleurs pas à l’étude spéciale des complexes sans avoir défini l’imago : « représentation inconsciente ».
3
Le premier complexe, qui joue un rôle capital dans l’évolution humaine, c’est celui du sevrage. Ce complexe, affirme hautement M. Lacan, n’est pas du tout le simple reflet psychique du fait biologique de d’ablactation. Prétendre l’y réduire, « c’est négliger un caractère essentiel de l’instinct : sa régulation physiologique, manifeste dans le fait que l’instinct maternel cesse d’agir chez l’animal quand la fin du nourrissage est accomplie ». Chez l’homme au contraire, nous dit notre brillant auteur, c’est par une régulation d’ordre civilisationnel que le sevrage est conditionné. On sèvre plus ou moins tôt, on sèvre par tels ou tels procédés, suivant les peuples et les milieux; et le sevrage est bien souvent « un traumatisme psychique, dont les effets individuels… révèlent leurs causes à la psychanalyse ». On ne saurait mieux dire.
« Traumatisant ou non, ajoute M. Lacan, le sevrage laisse dans le psychisme humain la trace permanente de la relation biologique qu’il interrompt. » Et il faut bien avouer que cette phrase-là aurait aussi bien pu être écrite par M. Laforgue, qu’on ne se serait à vrai dire guère étonné de voir cité en cette affaire, si M. Lacan avait à cet égard la plume plus généreuse. Ce que M. Laforgue, par contre, n’aurait pas dit, c’est que la crise psychique du sevrage fût « la première sans doute dont la solution ait une structure dialectique ». Entendez, si je ne me trompe pas, la première où l’esprit résolve, par une conciliation ingénieuse, un antagonisme à première vue intolérable : « une tension vitale se résout en intention mentale. La conciliation hégélienne, à vrai dire, n’est encore ici que bien rudimentaire, puisque, de l’aveu de M. Lacan, il y a acceptation ou refus, sans d’ailleurs [p. 114] que cette alternative puisse être conçue comme un choix, faute qu’il y ait un moi constitué pour en extérioriser les deux possibilités comme contradictoires. Ici, j’ose dire à M. Lacan qu’il apporte des négations auxquelles les faits ne l’autorisent point ; une des plus grandes leçons de l’expérience vécue des activités investigatoires, c’est que, si les faits qu’on rassemble permettent souvent d’affirmer, presque jamais ils ne permettent de nier. Pas de moi constitué ? Pour se permettre légitimement une pareille négation, en y infusant un sens réel, il faudrait serrer de beaucoup plus près que ne le fait M. Lacan les problèmes du je, du me et du moi, de la personne et de la personnalité.
La lactation ne joue de rôle dans le développement intellectuel, indique M. Lacan, qu’au moment où elle a cessé : cela par l’imago du sein maternel, qu’elle laisse précisément subsister comme tendant à être rétablie dans sa vigueur fonctionnelle. Cette imago est bien spéciale, car la fusion orale regrettée n’était ni un auto-érotisme ni un narcissisme : stade buccal anérotique, ai-je dit pour ma part ; M. Laforgue avait dit « stade de la mère-nourriture ».
Mais il y a plus. M. Lacan croit avoir des raisons biologiques de penser que l’homme est essentiellement un animal à naissance prématurée, pour qui la vie extra-utérine est d’abord un perpétuel malaise, vu l’organisation posturale et équilibratoire de type intra-utérin qu’il conserve plusieurs mois. Conséquemment, l’auteur pense que l’ablactation ne prend sa grande valeur qu’en ce qu’elle « donne son expression psychique… à l’imago plus obscure d’un sevrage plus ancien… : celui qui à la naissance sépare l’enfant de la matrice ».
Ajoutons que M. Lacan pense que l’amour des mères pour leurs rejetons sature, par renversement psychique, l’appétence de l’imago du sein maternel. D’autre part, il vient soutenir que les faits l’ont amené à considérer comme normale chez l’être humain une certaine appétence de la mort ; il ne la rapporte pas à un instinct de mort, conception freudienne dont son psychopompe psychanalytique M. Rodolphe Loewenstein a fait une si pertinente critique (2), mais bien un complexe témoignant de l’insuffisance congénitale où se trouve le psychisme humain dans ses fonctions vitales. [p. 115]
Ce qui reviendrait à un abandon de lutte devant des difficultés : la fascination fécondatrice de M. Lacan fait surgir là une bien jolie Aphrodite des mers de M. Pierre Janet ! Pour ma part, je me demande s’il y a un grand avantage intellectuel à parler de complexe de mort, d’appétence de mort, etc., sans préciser à quel contenu psychologique réel répond ce terme de « mort ».
4
« Le complexe de l’intrusion représente l’expérience que réalise le sujet primitif, le plus souvent quand il voit un ou plusieurs de ses semblables participer avec lui à la relation domestique, autrement dit, lorsqu’il se connaît des frères. » La jalousie infantile est connue depuis longtemps, mais le « point critique » révélé par les recherches psychanalytiques est, nous dit M. Lacan, « que la jalousie, dans son fonds, représente non pas une rivalité vitale, mais une identification mentale ».
Pour comprendre le moins défectueusement possible ce que M. Lacan entend par là, rappelons quelques faits sur lesquels il met lui-même l’accent, et que voici :
Dès la période de lactation, l’enfant manifeste un intérêt spécial pour le visage humain : j’y ai insisté ; M. Lacan le souligne aussi. – D’autre part, dans les rapports entre deux enfants qui se donnent en spectacle l’un à l’autre, qui travaillent l’un à séduire l’autre, qui se dominent et s’asservissent l’un l’autre, il y a toujours une « participation bipolaire », « constitutive de la situation elle-même » : quel est le spectateur ? quel est le séducteur ? quel est le plus asservi ? Voilà, remarque M. Lacan, des questions qu’on peut se poser même si l’un des enfants déploie matériellement toute l’activité, l’autre étalant une passivité en apparence complète.
Ces faits conduisent à penser que chacun des partenaires joue mentalement, outre son propre rôle, celui de l’autre aussi : il s’identifie en pensée à cet autre, ou, du moins, à l’imago de cet autre. C’est en ce sens que M. Lacan fait de l’identification (entendez : mentale) un élément essentiel de la jalousie infantile, et même des jalousies ultérieures, la paranoïaque surtout.
L’identification préoedipienne, dont il s’agit ici, M. Lacan l’intègre dans sa notion générale de la structure narcissique du [p. 116] moi, au stade qu’il appelle stade du miroir, lequel répond « au déclin du sevrage ». Après l’âge de six mois, les enfants se mettent à reconnaître leur propre image dans les glaces. Pour M. Lacan, c’est un phénomène d’importance capitale, duquel il importe que les psychologues comprennent la signification prégnante. La portée d’une pareille reconnaissance est tout autre, croit-il, qu’elle n’était chez le chimpanzé ; l’homme n’a pas « cette adaptation immédiate au milieu qui définit le monde de l’animal par sa connaturalité « ; l’homme n’est pas connaturel au milieu ; chez lui, la perception acquiert de l’indépendance par rapport au système pulsionnel, elle devient « illuminative » et bientôt se constitue « le sentiment de compréhension sous sa forme ineffable ».
Au stade du miroir, l’image spéculaire sert à l’enfant de signal de son unité corporelle et mentale. Elle triomphe de ces fantasmes de démembrement et de dislocation « dont ceux de castration ne sont qu’une image mise en valeur par un complexe particulier ».
Mais l’unité du « moi » ainsi constitué (3) est essentiellement narcissique. « Le monde [entendez : mental] propre à cette phase est… un monde narcissique. » Il ne « contient pas d’autrui ». Car, selon M. Lacan, « la perception de l’activité d’autrui ne suffit pas… à rompre l’isolement affectif du sujet ». Le sujet subit la suggestion émotionnelle de l’activité d’autrui, mais il ne se distingue pas d’elle ; la tendance étrangère réalise seulement ce que M. Lacan appelle « une intrusion narcissique ».
Cette phase du développement mental est très importante selon l’auteur, car c’est elle qui donne leur bien connue ambivalence aux passions de voir et d’être vu, au sadomasochisme, etc.
Voilà une doctrine psychologique solide, cohérente, appuyée par des faits. Tous les psychologues auront désormais, me semble-t-il, à en tenir compte.
5
Mais M. Lacan a voulu lui donner une assiette biologique et cette seconde doctrine a beaucoup moins de solidité : la naissance [p. 117] humaine aurait selon lui, nous nous le rappelons, un caractère prématuré absolument (point un peu difficile à comprendre) ; c’est de là que dériveraient l’absence d’adaptation bestiale(4) au milieu et la libération de la perception par rapport aux pulsions.
De pareilles théories sont bien hasardeuses à soutenir, devant l’extrême variété des faits biologiques. Les oursons, les kangourouteaux, les serineaux, etc., ont-ils, du fait de leur infériorité morphologique et sensorimotrice natale, sur les cobayeaux ou les poussins un sort intellectuel beaucoup plus élevé ? Il ne le semble pas. Il importe donc de limiter les comparaisons à des domaines très définis.
Mais, à tout prendre, ce thème de la connexion entre le développement de l’intelligence humaine et le caractère particulier du développement biologique de l’enfant se rattache à tout un courant d’idées dont il n’est pas inutile de rappeler les principaux méandres pour bien situer la pensée de M. Lacan.
C’est une vue qui était d’actualité dans les toutes premières années du XXe siècle, que de souligner que, du point de vue biologique, l’homme était un animal d’un autre âge, une sorte de survivant, auquel le jeu naturel des défenses biologiques purement bestiales n’aurait pas permis, vu sa nudité et son inermité, d’arriver jusqu’à notre temps, qui, selon René Quinton, est, biologiquement, celui des oiseaux. C’est par un mode original d’évolution que l’homme s’est maintenu, a pullulé, a développé sa civilisation ; l’intelligence, disait dès cette époque M. Bergson, c’est la faculté de se créer des organes à l’extérieur.
Dans ces dix dernières années, M. Emile Devaux, s’inspirant des travaux de De Beer, a affirmé la connexion chez l’homme entre la lenteur de développement du corps et la hauteur du niveau intellectuel atteint par l’esprit. « En vérité, écrit-il (5), nous sommes des ralentis de développement et des ralentis de croissance, c’est là tout le secret de l’énigme humaine. » Et, pour le prouver, il nous compare aux anthropoïdes, sans oser décider nettement toutefois si c’est eux qui subissent un « désaiguillage » dans leur ontogenèse, ou nous qui bénéficions d’une néoténie par où nous soient conservés des caractères fœtaux. Il reste qu’il nous faut, comme l’a indiqué M. Jean Rostand, vingt fois plus de [p. 118] temps qu’aux grands singes pour nos étapes dentaires et ossificatoires, et que nous faisons, relativement à eux, figure de retardés génitaux, ce qui rend normale à notre espèce une macroscélie relative qui, à leur aune, serait eunuchoide. Notre encéphale, dans ce mode de développement, conserve entre le cerveau antérieur et le reste de l’encéphale un équilibre qui chez les singes est très tôt détruit au désavantage du premier. De là, selon M. Devaux, notre intelligence.
Cette conception fort intéressante est toutefois marquée au sceau d’un matérialisme évolutionniste postulé a priori par la docilité de l’auteur aux dogmes qui lui ont été enseignés lors de sa scolarité.
On se sentira beaucoup plus près des idées de M. Lacan chez un esprit beaucoup plus ancien, mais beaucoup plus libre.
« Un jeune animal, nous dit-il (6) a (et par ce terme d’animal il désigne ici les mammifères), tant par l’incitation que par l’exemple, apprend en quelques semaines d’âge à faire tout ce que ses père et mère font ; il faut des années à l’enfant, parce qu’en naissant il est sans comparaison beaucoup moins avancé, moins fort et moins formé que ne le sont les petits animaux. » Mais il y a, nous dit Buffon, « deux éducations » (7), celle purement individuelle, qui est la seule qu’exercent et subissent les bêtes ; celle de l’espèce, « qui n’appartient qu’à l’homme » (8). Or, « dès qu’elle commence à se former, l’éducation de l’enfant n’est plus une éducation purement individuelle… : c’est une institution à laquelle l’espèce entière a part, et dont le produit fait la base et le lien de la société » (9) ; et c’est parce que l’enfant est beaucoup plus lent que les petits des animaux les plus voisins à recevoir l’éducation individuelle, que « par cette raison même, il devient susceptible de celle de l’espèce » (10).
Ainsi, non seulement Buffon affirme déjà la connexion que contracte la hauteur du niveau spirituel de l’homme avec la débilité de l’enfant à sa naissance, mais encore il indique nettement, par le terme d’institution, le caractère essentiellement psychologique et social, bien plutôt que biologique, de l’éducation [p. 119] familiale. Il m’a semblé que ces vues méritaient d’être rappelées à propos de celles de M. Lacan.
6
Ce buisson battu, revenons fidèlement suivre la marche de notre guide. Pour lui, quant à la jalousie de l’enfant à l’égard de son frère, « l’image du frère non sevré n’attire une agression spéciale que parce qu’elle répète dans le sujet l’imago de la situation maternelle et avec elle le désir de la mort ». Voilà qui me paraît tout à fait contestable.
Cherchons à pénétrer, avec M. Lacan, le monde mental narcissique ne contenant pas d’autrui, c’est-à-dire n’ayant pas encore élaboré les conceptions qu’en psychanalyse on appelle objectales. La jalousie pose, selon cet auteur, une alternative où, comme il le dit en son style hermétique et inexact, « se joue le sort de la réalité ». Comme si la réalité était appendue en entier aux attitudes mentales de M. le bébé considéré ! Entendez : « une alternative où se joue le sort des conceptions que cet enfant pourra se faire de la réalité ». S’il reste dans l’identification narcissique, il va « s’accrocher au refus du réel et à la destruction [entendez : la scotomisation] de l’autre ». Mais s’il reconnaît une existence indépendante à l’objet, voilà la notion d’un autrui solidement assise, voilà un progrès important de la connaissance. La « socialisation [de l’objet] par la sympathie jalouse fonde sa permanence et sa substantialité ».
Fort bien, mais alors M. Lacan avait tort, au début de son développement, de prétendre que la jalousie était essentiellement une identification, puisque précisément elle ne joue son rôle fécondateur de la connaissance que quand elle est dûment acceptée ; or en ce sens, elle ne comporte plus pour l’objet d’intrusion narcissique, mais au contraire, la reconnaissance de sa réalité autonome. Certes, cette reconnaissance implique une appréciation de similitude avec le sujet : comme je l’ai dit ailleurs (11), l’esprit humain ne peut pas concevoir de substantialité autrement que par ce moyen. Mais cette opération mentale est l’inverse d’une introspection ou d’une intrusion identificatives. [p. 120]
D’autre part, une chose m’inquiète ; je me demande si, en matière de stade sadomasochique du développement, M. Lacan ne décrit pas tout uniment les mêmes faits que M. Codet, M. Laforgue et moi-même, en changeant seulement les mots : ce stade, disions-nous au moyen d’un terme proposé par M. Codet, comporte un traitement captatif de l’objet, traitement par lequel il ne lui est pas reconnu d’indépendance véritable, mais où, au contraire, il est comme ingéré, digéré, détruit. Le même terme, frappant, de destruction d’autrui (12), si évocateur de la pensée de M. Laforgue, vient sous la plume de M. Lacan décrivant l’intrusion narcissique. Dès lors, ce qu’il appelle identification narcissique est peut-être tout bonnement ce que, moins ambitieusement, nous appelons avec M. Codet captation. Notre nomenclature a, selon moi, l’avantage de ne pas donner de nouvelles limites au domaine sémantique du terme narcissisme, déjà compris si différemment par les différents psychanalystes ; elle me permet aussi, à moi personnellement, d’éviter le terme si mal choisi d’identification pour désigner les faits que vise M. Lacan.
III
1
Le complexe d’Œdipe a certes été, nous dit M. Lacan, celui qui a permis à M. Freud l’élaboration de l’idée générale de complexe. Mais en fait il n’intervient que relativement tard dans le développement psychique de chaque être humain.
J’ai moi-même insisté (13) sur le rôle extrêmement important d’une liquidation correcte du complexe d’Œdipe dans la constitution de la mentalité de l’homme civilisé suivant le mode de l’Occident européen ; M. Lacan confirme ces vues ; et de plus il semble penser que dans la phylogénie, conçue suivant la loi de Serres [p. 121] comme au moins grossièrement parallèle à l’ontogénie, le complexe d’Œdipe ne caractérise point le passage du singe à l’homme, mais le passage, beaucoup plus haut situé, du sauvage à l’homme civilisé tel que nous le concevons. Si, sur ce point, j’ai bien saisi la pensée de M. Lacan, il y a là une très importante nouveauté dans l’interprétation des faits.
M. Freud, avec son mythe du meurtre du « Père », voit dans l’oedispisme la « forme spécifique de la famille humaine » ; M. Lacan ne souscrit pas à cette vue. Il définit le complexe d’ Œdipe par la pulsion attractive vers le parent de sexe opposé, qui en est la « base », et par la frustration subie par cette pulsion, laquelle frustration est le « nœud » du complexe. L’enfant, néanmoins, entrevoit les relations amoureuses de ses parents ; « par ce double procès, le parent de même sexe apparaît à l’enfant à la fois comme l’agent de l’interdiction sexuelle et l’exemple de sa transgression ». La résolution de la crise oedipienne entraîne la formation de deux instances permanentes : « celle qui refoule s’appelle le surmoi ; celle qui sublime l’idéal du moi ». On voit ainsi reparaître sous la plume de notre nouvel auteur la même dualité qui avait inspiré à M. Charles Odier les notions de suça et de surmoi, et à moi-même celles de coactorium et de suasorium.
Le mode de description des faits adopté par M. Lacan met, il est vrai, plus nettement l’accent sur le fait que l’homme le plus normal est incapable de faire tous ses réfrènements sous forme de répression ; il y a toujours en lui un notable contingent de refoulements ; le coactorium n’est donc pas pathologique en soi, mais seulement quand il s’hypertrophie.
« Il y a là, ajoute judicieusement M. Lacan, un ordre de détermination positive qui rend compte d’une foule d’anomalies du comportement humain et, du même coup, rend caduques, pour ces troubles, les références à l’ordre organique qui, encore que de pur principe ou simplement mythiques, tiennent lieu de méthodes expérimentales à toute une tradition médicale. »
On ne peut pas mieux dire, même quand, médecin soi-même, on se réserve, comme M. Lacan et moi, la liberté médicale souveraine d’user comme on l’entendra des médicaments, nervins ou autres, chez tels malades que l’on voudra, et au moment où on le jugera bon. [p. 122]
2
Il est acquis que le complexe d’Œdipe existe, et que son rôle est capital dans notre développement psychique. L’agressivité qu’il crée vis-à-vis du parent rival et la crainte d’une agression en retour sont le fondement de ce que la doctrine freudienne a appelé le complexe de castration.
Avec leur souci doctrinal de traduire toujours les faits affectifs en langage d’anatomie topographique, M. Freud et ses caudataires orthodoxes ont fait reposer tout cet édifice de réaction à l’oedipodisme sur le fantasme d’être châtré en punition d’un inceste métrogamique. Et ils n’ont pas hésité à en inférer tout le roman préhistorique d’une horde patriarcale encore à peine humaine, avec « un drame de meurtre du père par les fils, suivi d’une consécration posthume de sa puissance sur les femmes par les meurtriers prisonniers d’une insoluble rivalité ; événement primordial d’où, avec le tabou de la mère, serait sortie toute tradition morale et culturelle ». Roman qu’on veut biologique et sociologique à la fois.
Sans reprendre ici tous les excellents arguments qui se sont levés en France contre cette conception, voyons ce qu’y répond M. Lacan lui-même. D’abord, il la trouve foncièrement vicieuse en saine logique, puisque l’on y attribue « à un groupe biologique la possibilité, qu’il s’agit justement de fonder, de la reconnaissance d’une loi ». Voulant bien passer outre, il discute néanmoins sur le fond.
Sur le plan biologique, il objecte avec justesse que ce que nous savons des grands singes anthropoïdes s’accorde mal avec les vues de M. Freud.
Sur le plan sociologique, M. Lacan allègue que presque partout on a retrouvé les traces du matriarcat sous le patriarcat. Ici il convient, à la vérité, d’être prudent.
D’abord, il faut s’entendre sur la notion de matriarcat. Ce qui la constitue, c’est la transmission des droits par la ligne maternelle. Mais, comme le fait remarquer Glotz (14), ce droit n’implique aucune position dominante de la femme, aucune gynécocratie. Le matriarche, comme l’indique d’ailleurs très bien [p. 123] M. Lacan, est un homme, oncle ou cousin du côté maternel de ceux auxquels il commande.
D’autre part, dans les sociétés dont la nôtre procède, le matriarcat n’a pu être retrouvé qu’à l’état de débris. La civilisation crétoise préhellénique adorait une Déesse-Mère, mais nous n’avons pas la preuve qu’elle se soit conservée matriarcale jusqu’à la grande époque minoenne (1700 ?-1400 ?). Glotz admet au contraire comme vraisemblable (18) que les Egéens avaient déjà effectué, avant l’arrivée des Hellènes, l’évolution familiale menant du γένος à la famille restreinte.
En tout cas les Hellènes, quand ils arrivèrent, durent infuser une nouvelle vigueur au patriarcat, car ils étaient Indo-Européens (comme les Italiotes et les Celtes). Je rappelle ici que les Indo-Européens (appelés quelquefois, par abus, Aryens, du nom de leur branche asiatique) ne se définissent que linguistiquement : sur la forme de leur crâne, la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux et l’emplacement de leur habitat, on ne sait jusqu’ici rien de positif. Mais par les faits linguistiques, nous savons de façon presque certaine que ce peuple était organisé patriarcalement. Notamment, pour les linguistes historiciens, l’absence d’un adjectif *μητριος* -matrius (le grec a μητρώος, le latin maternus) au regard de πάτριος -patrius ressortit probablement à l’organisation patriarcale de la famille indoeuropéenne. De même le sens et la répartition des termes indiquant les belles-parentés (18) •
Mais de plus les migrateurs indo-européens paraissent bien avoir apporté avec eux une sexualisation psychologique particulièrement forte, dont notre sexualisation occidentale est la continuation directe.
Si d’autre part nous considérons l’ancienneté du patriarcat chez les Juifs, générateurs du Christ, nous voyons que dans aucune de nos racines civilisationnelles l’on ne retrouve le matriarcat comme positivement attesté en l’état présent des recherches historiques. On en suppose simplement l’existence très ancienne, d’après certains indices épars.
Ces précisions ne vont d’ailleurs nullement contre l’opinion de M. Lacan, en tant qu’il pense que l’avènement du complexe [p. 124] d’Œdipe n’a pas dû marquer le passage de l’état matriarcal au patriarcat, mais bien plutôt, au sein même du patriarcat, le passage du stade de la grande famille gentilice, agnatique, sévère, à celui de la petite famille gamocentrique, dont le principal ressort affectif est la tendresse.
3
Quel est, dans cette conception, le rôle précis du complexe d’Œdipe ? Il est double : sur la maturation de la sexualité, l’action de l’oedipodisme est directe ; sur l’appréhension de la réalité (17), elle est indirecte. Il y a entre ces deux rôles du complexe, dit M. Lacan, une marge angulaire que comblent la répression des pulsions libidinales réprouvées et la sublimation d’icelles (18).
Sur la question de la maturation sexuelle oedipienne, on ne nous offre guère de gerbes nouvelles à engranger. On fait allusion aux travaux de M. Laforgue sur la mère-nourriture, mais sans en prononcer le nom. On présente, en quelques courtes lignes, une théorie fort discutable de la différence des sexes respectifs quant à leur maturation sexuelle, mais on ne la développe pas assez pour donner base à une discussion utile.
L’auteur passe ensuite au rôle du complexe d’Œdipe, dans la constitution de la notion d’objet. La « perte d’objet » (Objektverlust) des auteurs de langue allemande est avant tout une abolition affective. En effet, « ces qualités si diverses du vécu, la psychanalyse les explique par les variations de la quantité d’énergie vitale que le désir investit dans l’objet. [Cette] formule… répond pour les psychanalystes à une donnée de leur pratique; ils comptent avec cet investissement dans les transferts opératoires de leurs cures ; c’est sur les ressources qu’il offre qu’ils doivent fonder l’indication du traitement ». D’accord. Ni M. Laforgue, ni M. Codet ni moi certes n’y contredirons.
Mais voilà ensuite le plus déplaisant des passages de M. Lacan, car il y lance des attaques sarcastiques contre des gens qu’il ne daigne pas nommer ; c’est indigne de lui. Il vient dire : « L’attitude instaurée par la tendance génitale cristalliserait selon son [p. 125] type normal le rapport vital à la réalité. On caractérise cette attitude par les termes de don et de sacrifice, termes grandioses mais dont le sens reste ambigu et hésite entre la défense et le renoncement. Par eux une conception audacieuse retrouve le confort secret d’un thème moralisant : dans le passage de la captivité à l’oblativité, on confond à plaisir l’épreuve vitale et l’épreuve morale. » Quel est cet on ? La première phrase vise M. Laforgue ; puis, par un glissement savant, l’auteur amène son lecteur à une dernière phrase qui semble bien dirigée contre moi. L’ironie, sur la question du sacrifice et du renoncement, est facile, car elle touche à une des plus profondes antinomies de l’âme humaine. Que l’amour le plus désintéressé comporte un bénéfice hédonique pour l’aimeur lui-même, personne ne le nie. Et sans doute M. Jacques-Marie Lacan paierait-il comme moi un plein panier de guignes au philosophe ou au théologien qui nous expliquerait l’insondable mystère de ce qu’est l’Amour pur, intégral, avec abnégation complète de soi. Mais cette interrogation non résolue n’efface nullement le fait qu’il n’y ait pas, pratiquement, d’équivalence psychologique entre la rage de possession directement jouisseuse et le dévouement facteur du bien d’autrui. L’ironie de M. Lacan ne ruine donc point la « psychogenèse anagogique » (19) que j’ai esquissée. Je ne demande à la morale aucun confort secret ; je moralise ouvertement ; c’est avec intention, et après mûre réflexion, que je me refuse à distinguer l’épreuve vitale de l’épreuve morale.
4
Selon M. Lacan, beaucoup de processus que l’on a imputés à l’action du complexe d’Œdipe lui sont antérieurs. Beaucoup des éléments du complexe dénommé de castration ressortissent, pense-t-il, à ces fantasmes de morcellement qui « ne se rapportent à aucun corps réel, mais à un mannequin hétéroclite, à une poupée baroque, à un trophée de membres où il faut reconnaître l’objet narcissique », au sens où M. Lacan entend ce terme.
D’autre part, le surmoi le plus archaïque est préoedipien, il est d’origine maternelle. C’est pourquoi, dit notre auteur, « la [p. 126] rigueur avec laquelle le surmoi inhibe les fonctions du sujet tend à s’établir en raison inverse des sévérités réelles de l’éducation ». Mais cette prétendue loi clinique a-t-elle la valeur absolue qui lui est attribuée en ce passage ? J’en doute ; et les affirmations de M. Lacan s’en trouvent, pour moi, affaiblies d’autant.
L’identification oedipienne véritable diffère grandement, nous dit M. Lacan, de l’identification narcissique plus haut définie. Le fait capital, connu de tous les psychanalystes mais que, selon M. Lacan « on ne souligne pourtant pas assez » c’est que « l’objet de l’identification n’est pas l’objet du désir, mais celui qui s’y oppose dans le triangle oedipien ». Ainsi, tandis que l’ « identification narcissique » était « mimétique », l’oedipienne est « propitiatoire ». Le sujet arrive ainsi à concevoir un objet d’aimance indépendant de lui, et non plus équivalent à lui, comme dans l’identification narcissique de M. Lacan. M. Laforgue, M. Codet et moi disions ; l’objet d’aimance est conçu oblativement, comme ayant son existence propre, et non pas captativement, comme incorporable par le sujet. N’était-ce pas apercevoir les mêmes processus psychologiques ?
Il est vrai que M. Lacan prend texte de ces constatations observationnelles pour brosser un vaste tableau de l’évolution psychologique de l’homme : la conscience exprime l’angoisse primordiale, l’équivalence le conflit narcissique, l’exemple le complexe d’Œdipe.
Et de dire ensuite que c’est l’imago de son père qui « donne à la fonction de sublimation » du garçon « la forme la plus éminente » et qui polarise ainsi la forme la plus haute de l’idéal du moi. Rien là que de classique en psychanalyse.
Plus étonnant, et infiniment plus discutable est l’opinion de M. Lacan sur la fille, pour qui l’image maternelle aurait tendance à déchoir, et qui elle aussi cultiverait comme idéal de soi l’image paternelle, d’où l’idéal virginal. Dossier renvoyé à Mme Marie Bonaparte.
5
D’ailleurs, les effets psychiques de l’oedipodisme tiennent surtout, observe M. Lacan, à notre état social, où le père incarne [p. 127] à la fois la répression et la sublimation. Il n’en est pas toujours ainsi, dit-il. Dans les sociétés matriarcales, le matriarche a l’autorité répressive, et le père, qui n’est qu’un gendre, joue vis-à-vis de son fils, selon M. Malinowski, « un rôle de patronage plus familier, de maître en techniques et de tuteur de l’audace aux entreprises ». Mais la sublimation, ainsi séparée de la répression, est écrasée par elle. Voilà une vue très intéressante.
La fécondité des systèmes patriarcaux tiendrait donc, selon M. Lacan, à l’union de ces deux fonctions, cependant antagonistes, dans la personne d’un même homme. Et cette idée fructifie dans sa pensée au point de prendre une importance capitale quant à l’évolution des sociétés humaines. Le passage de l’autorité du père, c’est-à-dire l’identification (au sens réel du terme) entre l’agent répresseur et le provocateur des sublimations, « introduit dans la répression un idéal de promesse… A l’avènement de l’autorité paternelle répond un tempérament de la primitive répression sociale ». La morale devient ouverte, au sens bergsonien du moi.
Cette thèse paraît excellente en son fond, mais là encore il faut peut-être retarder le plein effet de la bivalence paternelle jusqu’à l’avènement du gamocentrisme, car dans l’organisation gentilice, seuls certains privilégiés se trouvent avoir pour père le patriarche ; pour tous les fils de branches cadettes, les deux fonctions envisagées restent incarnées dans deux hommes différents ; M. Lacan l’aurait-il oublié?
La réduction de la famille au type gamocentrique est ancienne d’ailleurs dans les civilisations d’où la nôtre est issue. A Rome, l’histoire ne nous montre qu’une organisation gentilice déjà altérée et glissant vers le gamocentrisme. La famille gamocentrique était en germe dès le début du patriarcat, car l’établissement de la filiation par les mâles appelait le mariage, qui s’est développé à Rome sous plusieurs formes. La famille gamocentrique a reçu sa consécration du christianisme, mais c’est précisément à cause de l’éminente dignité que cette religion a conférée au mariage ; à un certain point de vue, le christianisme apparaît comme la conquête de la confarréation pour tous.
En effet, comme je l’ai proclamé hautement et comme M. Lacan le clame aussi, c’est bien le mariage qui est le pivot de toute l’organisation psycho-sociale de la civilisation occidentale : le mariage, avec le libre choix, avec « l’exaltation apothéotique que le christianisme apporte aux exigences de la personne ». [p. 128]
Toutefois appeler conjugal ce dernier état de la famille, comme M. Lacan le fait après Durkheim, c’est très insuffisant, car, socialement, les conjoints ne sont que les outils de l’institution et les enfants le but. C’est pourquoi je dis : gamocentrique.
D’autre part, je comprends mal le terme de « paternalisme », introduit sans définition par M. Lacan. Appliqué au patriarcat gentilice, il n’apporte rien ; appliqué au patriarcat gamocentrique, il a l’air de mettre l’accent sur la prépondérance du père, alors que cette prépondérance s’y solde surtout par des charges.
M. Lacan, en somme, indique très bien le rôle de la famille gamocentrique dans la formation de l’homme d’aujourd’hui. L’idéal-du-moi, que la tradition fait passer de père en fils, permet la constitution de familles d’hommes éminents quand rien ne vient gêner le fonctionnement optimum du système. Mais il semble à M. Lacan que l’image paternelle a tendance à subir un certain déclin dans l’âme des nouvelles générations et que, même, « peut-être est-ce à cette crise qu’il faut rapporter l’apparition de la psychanalyse elle-même ». Pour justifier cette opinion, M. Lacan allègue que chez les Yankees il y aurait « croissance très sensible… des exigences matrimoniales ». Le sens de cette phrase m’échappe absolument.
IV
Dans un dernier chapitre enfin, M. Lacan étudie les complexes familiaux en pathologie.
Pour ce faire, il commence par demander très judicieusement que la disance scientifique réserve le terme de « familial » à ce qui dépend de la famille en tant que nœud de relations sociales, et partant renonce à qualifier, comme on le fait couramment, de « familiales » certaines maladies héréditaires.
1
Il n’y a pas à s’étonner que les psychoses aient un thème familial, car « le tout du psychisme est intéressé par la lésion ou le déficit de quelque élément de ses appareils et de ses fonctions ». Les objets du délire, notamment, ne font souvent que [p. 129] répondre à des formes archaïques de la notion d’objet. Un certain conformisme, maintenu quelquefois longtemps par le sujet vis-à-vis d’autrui et de lui-même, arrive à s’effondrer et à laisser voir l’archaïsme réel des relations psychiques du sujet au monde extérieur.
Ces vues de M. Lacan sont intéressantes à rapprocher de celles que M. Laforgue et moi avons émises dès 1926 sur l’approfondissement progressifdes schizonoïas et leur possible versement final dans la pleine psychose.
M. Lacan toutefois, en bon psychiatre classique qu’il est resté, maintient nette la distinction entre névroses et psychoses. La psychose, pour lui, a un thème familial, mais non pas une origine familiale. Il faut, chez elle, « quelque ressort organique pour la subduction mentale où le sujet s’initie au délire » ; et même, M. Lacan se congratule d’avoir indiqué que « c’est dans quelque tare biologique (20) de la libido qu’il fallait chercher la cause de cette stagnation de la sublimation » où il voit « l’essence de la psychose ». L’auteur nous semble retomber nettement ici dans ce biologisme gratuit qu’il reproche par ailleurs aux freudiens de la stricte observance. La distinction entre psychoses et névroses serait bien malade si vraiment elle ne pouvait être maintenue qu’au prix d’un aussi aventureux appareil doctrinal.
2
Dans les névroses, les complexes familiaux ont une fonction causale. M. Lacan l’admet avec tous les psychanalystes.
Il rappelle que M. Freud, dans ses premières études, avait conçu le symptôme névrotique comme représentant simplement l’expression du refoulé, mais que l’expérience lui a enseigné ensuite deux faits capitaux : « qu’une résistance est opposée par le sujet à l’élucidation du symptôme, et qu’un transfert affectif, qui a l’analyste pour objet, est la force qui, dans la cure, vient à prévaloir ».
De la première étape de la pensée freudienne, il reste pourtant, dit M. Lacan, que le symptôme est « une forme de division de la personnalité ». Dans les travaux les plus récents de [p. 130] M. Freud, il n’est plus prêté au symptôme une « claire fonction d’expression de l’inconscient, mais beaucoup plutôt « une plus obscure fonction de défense contre l’angoisse » : et la division de la personnalité résulte dès lors, indique M. Lacan, de ce que le sujet fait « sa part à ce danger en s’interdisant tel accès à la réalité, sous une forme symbolique ou sublimée ». C’est dire quel rôle étendu M. Lacan reconnaît à la scotomisation, bien qu’il ne mentionne pas les luttes que M. Laforgue a menées pour faire reconnaître dès 1926 à M. Freud l’intérêt de ce processus, intérêt qu’à cette époque le maître de Vienne ne concevait pas encore pleinement.
M. Lacan, si je l’ai bien compris, étend d’ailleurs la notion et l’active. L’interdiction scotomisatrice influe, fait-il justement remarquer, sur la structure même des conceptions que le névrosé se fait de la réalité ; son édifice de représentation du réel devient dès lors inaccessible aux retouches, d’où « l’échec… d’une conception morale des névroses ». Cette dernière inférence est abusive ; la clinique y contredit. D’une part, en effet, l’inconscient n’est jamais, pour l’investigation psychanalytique, que du conscient virtuel ; d’autre part, l’aspect sinistre de mécanisation absolue que donnent sur beaucoup de points les grands schizonoïaques n’est que secondaire ; la clinique en suit les progrès ; les premières scotomisations, où les sujets ont failli à user de liberté, n’ont été qu’un doigt dans l’engrenage où le bras a ensuite été tout entier broyé (21)
3
Quoi qu’on veuille penser de cette discussion doctrinale, il faut proclamer avec M. Lacan que c’est à l’organisation oedipienne et à ses troubles, c’est-à-dire en dernière analyse, à l’institution familiale gamocentrique, que sont liées la plupart des névroses que nous observons.
M. Lacan essaie d’assigner à chacune des névroses de transfert sa place psychologique précise : dans la zoophobie, l’animal représente la mère gestatrice, le père menaçant, les puînés intrus ; dans l’hystérie, il y a refoulement mutilatif des satisfactions génitales ; dans la névrose obsessionnelle, il y a déplacement de l’affect dans la représentation. [p. 131]
[Ici s’arrête la publication dans la revue originale de 1939 en notre possession – Nous reprenons la pagination de la réédition parue dans la revue Confrontation.]
[p. 205] Il passe ensuite aux névroses de caractère. Dans l’étude de ces dernières, j’ai salué au passage la silhouette de la schizonoia, dont la notion représente selon moi le germe essentiel du développement de la floraison psychanalytique française ; c’eût été trop, sans doute, que de demander à M. Lacan d’en rappeler les auteurs.
Dysharmonie du couple parental, incomplétude du groupe familial gamocentrique, irrégularités d’état civil, etc., sont des causes sociales névrosantes sur lesquelles M. Lacan met judicieusement l’accent, comme tout clinicien aux yeux ouverts est amené à le faire. Les névroses d’autopunition, les introversions plus ou moins poussées, les extra-sexualisations (22) psychologiques viennent naturellement se ranger dans les cadres étiologiques ainsi dessinés.
4
Il est temps d’essayer de dégager, pour les discuter, certaines conclusions de l’étude des névroses par M. Lacan. Mais son opinion ne s’étale nulle part en caractères lumineux ; il faut l’égousser, comme aurait dit la sibylle de Panzoût. Il me pardonnera donc, si ma traduction est infidèle ; j’ai fait de mon mieux !
Cela posé, je vais résumer la doctrine de M. Lacan sur les névroses en trois propositions, que je discuterai au fur et à mesure.
1° La civilisation occidentale gamocentrique ne se maintient pas sans effort ; elle est un système délicat, et de ce fait très fragile.
Voilà une vérité à laquelle j’ai apporté déjà mon appui le plus ferme et le plus complet (23). Oui, chaque personne humaine a, en construisant sa personnalité, à reconstruire, pour sa part spirituelle propre, la civilisation.
Mais, bien évidemment, cette tâche se trouve beaucoup plus difficile dans des époques et dans des pays où les gouvernements sont tombés aux mains d’hommes de culture insuffisante ou possédés par des syndromes névrotiques d’inacceptation.[p. 204]
M. Lacan, avec toute son admiration pour l’idéal du mariage réussi et psychologiquement fécond, semble, avec quelque pessimisme, considérer cet idéal comme pratiquement inattingible. Or, selon moi, les mariages réussis existent ; ils sont même relativement nombreux. Si, en France, l’institution semble à première vue assez mal en point, c’est que des mesures légales en ont, depuis quarante ans, diminué la force.
Pour remplir sa fonction sociale essentielle, le mariage évidemment doit être indissoluble, et considéré comme sacré. L’étroite famille gamocentrique où va se former la personnalité de l’enfant sera ou non un milieu favorable à cette formation, selon la qualité du ménage parental : c’est pourquoi j’ai écrit (24) : « il faut s’efforcer de réussir son mariage, car on en doit compte à ses enfants ». Voilà la raison pour laquelle nous psychanalystes avons le devoir de prévenir, dans la mesure du possible, le mariage de convenances familiales, le mariage d’argent, le mariage par amourette ou folle amour, et tous les formariages. Nous jouons ainsi notre rôle dans le concert des dirigeants (je ne dis pas des gouvernants), car loin que la marche normale de la civilisation pousse à une moindre différenciation sexuelle, nous apercevons partout les signes d’une sexualisation différentielle toujours plus accusée comme fondement de l’harmonie sociale (25). C’est d’ailleurs peut-être ce que veut dire la dernière phrase de M. Lacan ; je la livre à la sagacité des lecteurs telle que je l’ai lue ; il se trouvera peut-être quelqu’un, parmi eux, pour décider plus pertinemment que moi ce qu’elle signifie : « c’est en fonction d’une antinomie sociale qu’il faut comprendre cette impasse imaginaire de la polarisation sexuelle, quand s’y engagent invisiblement les formes d’une culture, les mœurs, les arts, la lutte et la pensée ».
2° La névrose est fonction de cette civilisation gamocentrique à laquelle s’adapter est si difficile.
Oui, cher Lacan, les névroses que nous voyons sont fonction de notre civilisation gamocentrique ; mais il ne faudrait pas laisser penser qu’aucune névrose ne soit possible qu’en civilisation gamocentrique. Certes, plus une civilisation est fine et subtile, plus facilement elle prête à l’inadaptation névrotique ; et à ce titre, la civilisation [p. 205] gamocentrique est pour l’heure la plus créatrice de névroses. Mais à chaque civilisation doivent correspondre ses névroses, car chaque tissu a un envers. Quand les observateurs européens viennent nous dire qu’ils n’ont point vu de névroses dans tel groupe civilisationnel, dit « primitif », il faut, je crois, entendre qu’ils n’ont pas rencontré de psychasthéniques, d’obsédés, etc., bref de sujets atteints de nos névroses. Il aurait fallu chercher leurs névroses à eux, ce qui était certes bien plus difficile !
3° La profusion des névroses tient à un développement interne de la civilisation gamocentrique elle-même. L’image du père tend à décliner. Et la femme produit une protestation virile qui n’est que la « conséquence ultime du complexe d’Œdipe ».
Ici, je me sépare absolument de M. Lacan.
Son opinion ne me semble échafaudée que sur la conception inexacte qu’il s’est faite de l’évolution psychologique de la femme. Le complexe d’Œdipe a normalement chez la femme sa liquidation comme chez l’homme ; le cours de cette liquidation la jette dans les bras du mâle élu, et son pucelage n’apparaît là, je crois, que comme le plus puissant symbole de son oblation entière. L’idée que cette intégrité hyméniale soit une sorte de parure virile existe certes chez certaines inacceptantes de leur sexe, mais je pense qu’il n’est pas sage de généraliser une signification occasionnelle que la virginité ne reçoit précisément que l’arriération affective même des sujettes.
V
En fin de compte, M. Jacques-Marie Lacan, malgré le petit vernis germanique dont il s’enduit à plaisir, appartient nettement à l’école psychanalytique française.
Cette école a, me semble-t-il, conquis son autonomie par les travaux sur la captivité et l’oblativité, ainsi que sur la notion de schizonoïa. Or, M. Lacan, on l’a vu, ne peut pas ne pas se référer à ces travaux. [p. 206]
Depuis cette époque, d’une part, les psychanalystes français ont toujours eu l’attention en éveil sur le problème capital des rapports de la psychanalyse et de la morale.
MM. René Laforgue, Angelo Hesnard, Charles Odier se sont penchés sur le problème du besoin de punition, c’est-à-dire du sentiment de culpabilité en état de conscience virtuelle ; M. Charles Odier, même, a essayé de comprendre psychanalytiquement le fondement du problème moral. Pour moi, ma doctrine de l’immoralisme originel des névroses ne s’est constituée, sous l’empire de mes observations tant psychanalytiques que psychopédeutiques, que grâce à une participation de plusieurs années à un pareil mouvement. Or, cet aspect moral des questions psychanalytiques, M. Lacan est loin de s’en désintéresser, puisque nous le voyons lier la famille gamocentrique aux acquisitions les plus élevées de la personne humaine.
D’autre part, l’affectivisme psychanalytique une fois admis, les Français ont senti se poser le problème du rôle des constellations affectives dans la constitution même de la connaissance. M. Lacan, M. Laforgue et moi-même, en ce domaine, marchons nettement sur des chemins convergents ; si nos conclusions ne sont pas exactement les mêmes, du moins avons-nous abattu des pans entiers du château de la même vérité.
Par cette tendance apparemment double, mais en réalité profondément une, à vouloir tirer des données psychanalytiques des acquêts qui vinssent éclairer les grands problèmes philosophiques proprement humains, celui de la connaissance et celui de la conduite, les psychanalystes français ont, chacun à sa manière propre, montré leur appartenance essentielle à la plus humaniste de toutes les civilisations, la française. Car la civilisation française, si vivante et si drue, conserve son précieux caractère d’humanisme, en dépit des efforts destructeurs tentés successivement par la Réforme, par la mascarade sanguinaire de 1789-1799 et par la démocratie fille du 4 septembre.
M. Lacan, sans rien abdiquer de son originalité, est, quant à cette françaiseté foncière, tout à fait des nôtres. Pour imbibé qu’il soit d’hégélianisme et de marxisme, il ne m’a semblé nulle part infecté par le virus humanitaire ; il n’a pas la sottise d’être l’ami de tout homme, on le sent l’ami de chaque homme ; c’est que ce [p. 207] psychanalyste est un optimate et par sa modelure ethnique et familiale, et par sa formation professionnelle médicale parisienne.
Allez, Lacan : continuez à fouler bravement votre chemin propre dans la friche, mais veuillez laisser derrière vous assez de petits cailloux bien blancs pour qu’on puisse vous suivre et vous rejoindre ; trop de gens, ayant perdu toute liaison avec vous, se figurent que vous êtes égaré.
Paris, le 2 février 1939.
NOTES
(1). Ed. Pichon, Le développement psychique de l’enfant et de l’adolescent, § 32, p. 34.
(2) Rodolphe Loewenstein, L’origine du masochisme et la théorie des pulsions, Revue française de Psychanalyse, t. X, n° 2, p. 298 et p. 318·319.
(3) Je laisse à M. Lacan la responsabilité de ce terme de moi, qui semble en contradiction avec l’emploi qu’il en fait dans la suite. Une comparaison avec les stades de personnalité admis par M. Pierre Janet serait intéressante, mais exigerait une étude approfondie. E. P.
(4). J’emploie ce terme de bestial parce qu’il s’applique à tous les animaux, sauf l’homme, ce qui semble correspondre à l’idée de M., Lacan. E. P.
(5) Emile Devaux, Le problème de notre origine, Revue générale des Sciences, 28 février 1935, tirage à part, p. 16
(6) Buffon, Nomenclature des singes, Histoire naturelle, Imprimerie royale, Quadrupèdes, t. 7, p. 34.
(7) Ibid., p. 34.
(8) Ibid., p. 34.
(9) Ibid., p. 38.
(10) Ibid., p. 35.
(11) Ed. Pichon, La logique vivante de l’esprit enseignée par le langage, Journal de Psychologie, XXXIe année, n° 9-10, IS novembre, 15 décembre 1934, p. 692.
(12) Pourquoi M. Lacan dit-il « l’autrui », au lieu d’ « autrui » ? C’est inutile ; et c’est ambigu, puisqu’en français classique, « l’autrui » signifie encore « le bien d’autrui ». Ne serait-ce pas qu’il faut bien germaniser ? Nous devons déjà beaucoup de reconnaissance à M. Lacan de ne pas affubler tous les infinitifs d’un le inutile et anti-français, comme le font beaucoup de messieurs allogènes ou xénomanes : « le se promener leur est un acte plus agréable que le rester-chez-soi-à-ne-rien-faire ». E. P.
(13) Ed. Pichon, A [‘aise dans la civilisation, I. §§ 14-18.
(14) G. Glotz, La Civilisation égéenne, liv. II, chap. 1er, p. 170.
(15) G. Glotz, ibid., p. 153.
(16) Voir notamment Ernout et Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latin, S. V. Pater ; p. 705, et aussi S. V. Levir (δαήρ), Glos, (γάλως), Janitrices (εΐνάτερες), Socer, Socrus (έχυρός, έγυρά).
(17) M. Lacan dit fâcheusement constitution de la réalité, E. P.
(18) M. Lacan appelle bien peu clairement cette sublimation ; « sublimation de la réalité ». E. P.
(19) Le texte de M. Lacan porte analogique, que j’interprète comme une faute d’impression, E. P.
(20) C’est moi qui souligne, B. P.
(21) Bd. Pichon, De Freud à Dalbiez, p. 17.
(22) Alias, « homosexualités ».
(23) E. Pichon, Le développement psychique de l’enfant, § 268, p. 268.
(24) Ed. Pichon, Le rôle de la famille dans le développement affectif et moral, Rerzu médicosociale de l’enfance, 5e année, n° 5, 1937, p. 331.
(25) Ed. Pichon, Evolution divergente de la sexualité et de la génitalité, Revue française de Psychanalyse, t. X, n° 3, p. 461-470.




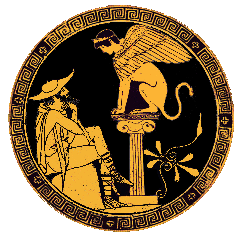
LAISSER UN COMMENTAIRE