 Anna Freud – Introduction à la psychanalyse des enfants. Traduit de l’allemand par Elisabeth Rochat. Paris, Les Editions psychanalytiques, 1931. 1 vol. in-8°, 12 p.
Anna Freud – Introduction à la psychanalyse des enfants. Traduit de l’allemand par Elisabeth Rochat. Paris, Les Editions psychanalytiques, 1931. 1 vol. in-8°, 12 p.
Anna Freud (1895-1982). Dernière fille de Sigmund Freud. C’est la première traduction française de ce travail que nous présentons ici, à l’origine une conférence présentée devant la Wiener psychoanalytische Vereinigung le 31 mai 1922 qui initia ses travaux et débouchera sr la publication en 1927 de Einführung in die Technik der Kinderanalyse » (Introduction à la psychologie des enfants, point de départ de la controverse avec Mélanie Klein.
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale du document. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Par commodité nous avons renvoyé la note de bas de page en fin d’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr
[p. 1]
Introduction
à la Psychanalyse
des Enfants
Mesdames, Messieurs,
Il est difficile de parler de la technique de l’analyse des enfants si l’on ne s’est auparavant mis au clair sur la question de savoir quand il est indiqué d’entreprendre l’analyse d’un enfant et quand il vaut mieux éviter ce traitement. Comme vous le savez, Mme Mélanie Klein s’est occupée à diverses reprises et de façon détaillée de cette question. Elle partage ce point de vue que tout trouble du développement de l’âme ou de l’esprit de l’enfant peut être corrigé, ou tout au moins influencé favorablement par une analyse. Elle va même plus loin et pense qu’une analyse peut être aussi d’un grand profit pour le développement de l’enfant normal. Par contre, quand cette question fut discutée au cours d’une réunion de notre Association (1), il se révéla que la plupart de nos analystes viennois furent d’un autre avis. Ils estiment que l’analyse d’un enfant n’est à sa place que dans le cas d’une véritable névrose infantile. Je ne pourrai, je crains, au cours de cet exposé, guère contribuer à l’éclaircissement de cette question. Je ne puis que vous indiquer en quels cas j’ai entrepris une analyse, quand cette détermination a été justifiée par le succès et quand son exécution s’est heurtée à des difficultés intérieures et extérieures. En somme, me semble-t-il, on a souvent l’impression, en travaillant avec des enfants, que l’analyse est un moyen trop compliqué, trop difficile et trop coûteux, et dont on risque d’abuser. Par contre, dans d’autres occasions, plus fréquentes, on trouve que l’on opère beaucoup trop peu par l’analyse proprement dite. On peut ainsi conclure de là, lorsqu’il s’agit [p. 2] d’enfants, que l’analyse doit subir parfois certaines modifications et certains changements, ou qu’elle ne doit pas être employée sans certaines précautions. Quand la possibilité technique d’observer ces précautions fait défaut, l’exécution d’une analyse est probablement à déconseiller.
Vous verrez, par plusieurs exemples, au cours de cet exposé, à quoi peuvent se rapporter les remarques précédentes. Je laisserai provisoirement de côté tout essai d’éclaircissement de ces questions, et je m’occuperai de la marche technique de l’analyse infantile dans des cas où, pour des raisons que nous ne discuterons pas davantage pour le moment, il a paru indiqué d’entreprendre un tel traitement.
Depuis l’année dernière, je fus souvent invitée à exposer, dans un des séminaires techniques de notre Association, l’évolution d’un cas infantile, et à expliquer, à cette occasion, la technique spéciale de l’analyse infantile. Jusqu’à présent, j’ai toujours repoussé cette proposition, craignant que les communications possibles sur ce sujet ne vous paraissent extrêmement banales et superflues. La technique spéciale de l’analyse infantile, justement dans ce qu’elle a de spécial, découle d’une idée très élémentaire : c’est que l’adulte, du moins en général, est un être achevé et indépendant, tandis que l’enfant est un être dépendant et en voie de formation. Il va de soi qu’en face d’objets différents, la méthode employée ne puisse être la même. Certains éléments, importants quand on s’occupe d’adultes, perdent de leur valeur quand on traite des enfants. L’importance relative des différents moyens d’action se modifie ; ce qui était là un moyen indispensable et sûr peut être ici une mesure un peu dangereuse. Mais ces modifications nécessaires apparaissent dans chaque situation donnée et ont à peine besoin d’être établies théoriquement.
Ayant eu l’occasion, au cours de ces deux dernières années, de traiter une dizaine d’enfants par des analyses de longue durée, je me suis efforcée, dans ce qui suit, de rassembler les observations que j’ai pu faire à leur sujet, comme vous en auriez aussi, probablement, eu l’idée dans les mêmes circonstances.
Nous nous en tiendrons donc à la marche réelle des faits dans l’analyse et commencerons par l’attitude de l’enfant au début du travail analytique.
Considérons d’abord la situation correspondante chez le patient [p. 3] adulte. Un homme se sent troublé de quelque manière dans son être intime, dans son travail, ou dans sa joie de vivre, et, pour une raison quelconque, prend confiance en la force thérapeutique de l’analyse ou en un certain analyste et décide de chercher la guérison par cette voie. Sans doute, il n’en est pas toujours ainsi. Ce ne sont pas toujours exclusivement des difficultés intérieures qui sont l’occasion de l’analyse, celle-ci n’est souvent entreprise qu’après des heurts avec le monde extérieur, heurts consécutifs eux-mêmes au trouble intérieur. La décision n’est pas non plus toujours prise par le patient d’une manière indépendante ; la pression des parents ou de l’entourage joue souvent un rôle plus grand qu’il ne faudrait pour le travail à venir. Et la confiance en l’analyse et en l’analyste n’est pas toujours considérable. Néanmoins, il reste que la situation idéale et souhaitable pour le traitement est bien celle où le patient s’allie de son plein gré à l’analyste pour lutter contre une partie de sa propre vie psychique.
Naturellement, un tel état de chose ne se rencontre jamais chez l’enfant. Le recours à l’analyse ne part jamais du petit patient, mais toujours des parents ou de l’entourage. On ne demande jamais à l’enfant s’il est d’accord. Si on lui posait cette question, il ne serait pas non plus en mesure d’émettre un jugement, ni d’y répondre. L’analyste est un étranger pour lui, et l’analyse quelque chose d’inconnu. Mais ce qui importe encore d’avantage, l’enfant, dans bien des cas, n’éprouve aucune souffrance, i1 ne ressent souvent lui-même aucun trouble ; son entourage, seul, souffre de ses symptômes ou de ses espiègleries. Ainsi, tout ce qui paraît indispensable, dans la situation de l’adulte, fait défaut dans celle de l’enfant : la conscience de la maladie, la détermination personnelle et la volonté de guérir.
Cependant tous les analystes ne considèrent pas cela comme un sérieux obstacle. Vous avez appris, par exemple, par les travaux de Mme Mélanie Klein, comment elle s’accommode de ces circonstances et quelle technique elle fonde là-dessus. Par contre, il me semble à moi qu’il vaut la peine de voir si l’attitude de l’adulte, reconnue comme si favorable à son analyse, ne peut être aussi provoquée chez l’enfant ; c’est-à-dire si les bonnes, dispositions qui manquent chez l’enfant ne peuvent être suscitées en lui de quelque manière.
Je me propose donc de vous montrer, dans ma première conférence, [p. 4] sur six différents cas d’enfants de six à onze ans, comment je suis parvenue à rendre le petit patient « analysable » à la façon de l’adulte, c’est-à-dire à susciter chez lui une conscience de la maladie, à lui inspirer confiance en l’analyse et en l’analyste et à changer le recours extérieur à l’analyse en une détermination d’ordre intérieur. Cette tâche nécessite pour l’analyse de l’enfant un temps de préparation que ne réclame pas l’analyse d’un adulte. Tout ce que nous entreprendrons dans cette période n’a rien à faire encore avec le travail analytique proprement dit, c’est-à-dire qu’il n’est pas encore question de rendre conscientes des choses ignorées, ni d’influencer le patient par l’analyse. Il s’agit simplement de changer un certain état défavorable en un autre état souhaité, en usant de tous les moyens qui sont à la disposition d’un adulte en présence d’un enfant. Ce temps de préparation, de « dressage » à l’analyse, pourrait-on dire, durera d’autant plus longtemps que l’attitude primitive de l’enfant est plus éloignée de l’attitude idéale du patient adulte.
Il ne faut pourtant pas se représenter ce travail comme trop difficile ; le pas qui doit être fait n’est parfois pas bien grand. Je pense, à ce propos, au cas d’une petite fille de six ans que j’eus en observation pendant trois semaines, l’année dernière. Je devais établir si le caractère difficile, taciturne et désagréable de l’enfant provenait de dispositions défectueuses et d’un développement intellectuel insuffisant, ou si l’on avait à faire à une enfant particulièrement inhibée et rêveuse. Une observation attentive me permit de constater, à côté d’une très grande intelligence et d’une logique pénétrante, l’existence d’une névrose obsessionnelle particulièrement grave et bien caractérisée pour cet âge. L’introduction à l’analyse se fit ici très simplement, la petite connaissant déjà deux enfants qui étaient en analyse chez moi. Elle vint la première fois avec sa petite amie un peu plus âgée qu’elle. Je ne lui dis rien de spécial, je la laissai seulement se familiariser un peu avec l’entourage. La fois suivante, lorsque je l’eus seule, je fis la première tentative. Je lui dis qu’elle savait bien pourquoi ses deux enfants amis venaient chez moi, l’un parce qu’il ne pouvait jamais dire la vérité et voulait perdre cette habitude, l’autre parce quelle pleurait tant et qu’elle en était elle-même fâchée. L’avait-on, elle, envoyée vers moi pour une raison semblable ? Là-dessus, elle me dit tout droit : « J’ai un démon en moi. Peut-on le faire sortir ? » Je fus très étonnée, [p. 5] au premier abord, de cette réponse inattendue. On pourrait bien le chasser, dis-je alors, mais ce ne serait pas un travail facile. Et s’il fallait l’essayer avec elle, elle devrait faire une quantité de choses qui ne lui seraient pas du tout agréables. (Je pensais naturellement : Me dire tout.) Elle réfléchit un instant. « Si tu me dis, répliqua-t-elle alors, que c’est la seule façon de faire, et de faire vite, je veux bien. » Ainsi, elle s’était librement engagée à observer la règle fondamentale de l’analyse. Nous n’en demandons pas davantage à l’adulte au début du traitement. La petite saisit ainsi parfaitement la question de la durée de l’ana1yse. Lorsque les trois semaines d’essai furent écoulées, les parents se demandèrent s’ils devaient la laisser chez moi en analyse ou la faire traiter autrement. Elle-même était très inquiète et, ne voulant pas abandonner l’espoir de guérir qui s’était éveillé chez elle à mon contact, elle me demandait avec insistance de la délivrer de son démon dans les trois ou quatre jours qui restaient encore. Je lui assurai que cela était impossible, que cela nécessitait une longue période de contact avec moi. Je ne pouvais rien lui faire comprendre par des chiffres, car, bien qu’elle eût atteint l’âge scolaire, elle n’avait, par suite de ses nombreuses inhibitions, encore aucune notion de calcul. Elle s’assit alors par terre, et, montrant le dessin de mon tapis : « Faut-il autant de jours qu’il y a ici de points rouges ? », me demanda-t-elle, « ou bien aussi autant de jours qu’il y a de points verts ? » Je lui montrai le grand nombre de séances nécessaires au moyen des nombreux petits médaillons du dessin de mon tapis. Elle comprit parfaitement, et elle fit tout ce ‘qu’elle put pour convaincre ses parents de hl nécessité d’une longue période de travail avec moi.
Vous direz, peut-être, que la gravité de la névrose facilita ici la tâche de l’analyste. J’estime que c’est une erreur. Je vous citerai, comme exemple, un autre cas où l’introduction s’effectua de la même manière quoiqu’il ne fût nullement question d’une véritable névrose.
Il y a environ deux ans et demi, j’appris à connaître par l’analyse une fillette de presque onze ans dont l’éducation causait les plus grandes difficultés à ses parents. Elle appartenait à la classe bourgeoise et aisée de Vienne, mais vivait dans des conditions familiales très peu favorables ; le père était faible et indifférent, la mère était morte depuis plusieurs années, et les rapports avec la [p. 6] seconde femme du père et un demi-frère plus jeune que la fillette troublés de diverses manières. Un certain nombre de vols, commis par l’enfant, une interminable série de grossiers mensonges et de grandes et petites cachotteries, avaient décidé la belle-mère, sur le conseil du médecin de la famille, à recourir à l’analyse. Ici, l’entente analytique se fit tout aussi simplement. « Tes parents ne savent que faire de toi ; avec leur seul secours, tu ne viendras jamais à bout de tes scènes et de tes conflits perpétuels. Veux-tu essayer avec l’aide d’un étranger ? »
Elle m’accepta sans difficulté comme alliée, contre ses parents, de même que la petite névrosée dont j’ai parlé tout à l’heure m’avait prise comme associée contre son démon. Tandis que la première se sentait obsédée, la seconde se sentait en conflit avec son entourage, mais l’agent actif commun aux deux patients était la grande souffrance qui provenait chez l’une du dehors et chez l’autre du dedans. Dans ce second cas, ma manière d’agir fut en tous points celle de Aichhorn, avec les enfants abandonnés que lui adresse l’Assistance Publique. L’éducateur, dit Aichhorn, doit avant tout se mettre du côté de l’enfant dissocial et admettre que l’attitude de celui-ci à l’égard de son entourage est justifiée. C’est ainsi seulement qu’il réussira à travailler avec son élève, au lieu de travailler contre lui. Je voudrais seulement faire remarquer ici que la position d’Aichhorn est beaucoup plus avantageuse pour ce genre de travail que celle de l’analyste. Il est autorisé à intervenir par la Ville et par l’Etat, et il a l’autorité de sa charge derrière lui. L’analyste, par contre, comme l’enfant le sait, est payé et engagé par les parents; il se met toujours dans une position fausse lorsqu’il se tourne contre ceux-ci, même si c’est dans leur intérêt. De fait, c’est toujours avec mauvaise conscience que je me suis trouvée en face des parents de cet enfant, toutes les fois que j’ai dû leur parler, et, finalement, au bout de quelques semaines, malgré les meilleurs conditions intérieures, l’analyse échoua par suite de cette situation trop peu nette.
Comme vous venez de le voir, les conditions nécessaires au début d’une vraie analyse : le sentiment de souffrance, la confiance et l’acceptation du traitement purent être suscitées sans trop de peine dans ces deux derniers cas. Passons maintenant à l’autre extrême, à un cas où n’existait aucun de ces trois facteurs.
Il s’agissait d’un garçon de dix ans affligé d’un mélange confus [p. 7] de craintes, de nervosité, de mensonges, et qui s’adonnait à des pratiques infantiles perverses. Plusieurs petits larcins, et un autre plus important, avaient été commis par lui au cours des dernières années. Le conflit avec la famille n’était ni déclaré ni conscient. Il ne se rendait nullement compte de son état peu réjouissant, et, n’avait pas le moindre désir, même superficiel, de le modifier. Son attitude à mon égard était négative et méfiante, et tous ses efforts tendaient à éviter la découverte de ses pratiques sexuelles. Je ne pouvais employer ici aucun des deux procédés qui s’étaient montrés si utiles dans les deux autres cas. Je ne pouvais ni m’allier à son moi conscient contre une partie de sa personnalité, comme il ne percevait aucune dissociation de son être, ni m’offrir à lui comme alliée contre son entourage, auquel, pour autant qu’il en fut conscient, il était très attaché. La voie que j’avais à suivre était différente, évidemment, plus, difficile et moins directe, il s’agissait de gagner la confiance de quelqu’un — ce qui, dans ce cas, ne pouvait s’obtenir d’une manière directe — et de s’imposer où quelqu’un qui pensait pouvoir très bien se tirer d’affaire sans moi.
J’essayai de plusieurs manières. Tout d’abord, pendant longtemps je ne fis rien d’autre que de me conformer à ses fantaisies et à ses humeurs et que de le suivre dans toutes leurs variations. S’il arrivait d’humeur gaie à l’analyse, j’étais aussi gaie ; s’il était sérieux ou déprimé, je me comportais de même. Si, au lieu d’être assis, ou couché, ou de marcher pendant la séance, il préférait aller se mettre sous la table, je faisais comme si c’était la chose la plus naturelle, je soulevais le tapis et je lui parlais ainsi. S’il arrivait avec une ficelle dans sa poche et commençait à faire des nœuds extraordinaires, je lui montrais que je savais en faire de plus ingénieux encore. S’il faisait des grimaces, j’en faisais de plus belles encore, et s’il m’invitait à mesurer nos forces, je me montrais incomparablement la plus forte. Je le suivais aussi dans tous les domaines de la conversation, depuis les histoires de pirates et les questions de géographie jusqu’aux romans d’amour. Dans ces entretiens, je ne considérais aucun sujet comme étant au-dessus de sa portée, ou trop délicat, et sa méfiance ne pouvait soupçonner aucune intention pédagogique derrière mes paroles. Je me comportais à peu près comme un film de cinéma ou comme une histoire amusante, qui n’a pas d’autre but que d’attirer le spectateur ou le lecteur, et qui se conforme aux intérêts et aux goûts du public, Je ne cherchais en [p. 8] effet rien d’autre qu’à me rendre intéressante à ses yeux. Et, durant cette première période, j’appris en même temps, sans y avoir guère compté, bien des choses utiles sur ses penchants et sur ses goûts.
Au bout de quelques temps, je fis intervenir un nouveau facteur. Je me rendis utile à lui, de façon très innocente. Je lui tapai ses lettres à la machine, pendant l’heure d’analyse. J’étais toujours prête à l’aider à mettre par écrit ses rêveries et les histoires qu’il inventait et dont il était très fier. Je fabriquais même, pendant la séance, toutes sortes de petites choses pour lui. Avec une petite fille, qui passait par la même période de préparation, je tricotais et crochetais avec ardeur, pendant l’heure, et j’habillais ainsi peu à peu toutes ses poupées et ses ours de peluche. Je fis intervenir ainsi une nouvelle qualité ; je n’étais pas seulement intéressante, j’étais devenue utile. Et, à côté de cela, un gain de cette deuxième période fut que, écrivant ses lettres et ses histoires, je pénétrai, peu à peu, dans le cercle de ses connaissances et de ses imaginations.
Ensuite, vint quelque chose de plus important encore. Je lui fis remarquer qu’être analysé offrait de gros avantages pratiques, que des actions blâmables, par exemple, aboutissaient à quelque chose de beaucoup moins pénible si c’était l’analyste qui les apprenait le premier, puis, par lui, les personnes chargées de son éducation. Il prit ainsi l’habitude d’avoir recours à l’analyse pour éviter des punitions et à mon aide pour remédier à des actes irréfléchis ; il me fit remettre à sa place de l’argent volé et me chargea de tous les aveux, nécessaires mais très désagréables, qu’il devait faire à ses parents. Il mit cent fois à l’épreuve mes capacités à cet égard, avant de se décider à y croire. Enfin, il n’y eut plus de doute. J’étais devenue pour lui non seulement une compagnie intéressante et utile, mais encore une personne très puissante dont il ne pouvait plus se passer. Je m’étais ainsi rendue indispensable de trois manières, et, pourrions-nous dire, il était arrivé, lui, à un état de dépendance complète. J’avais précieusement attendu ce moment pour exiger de lui, énergiquement — non par des paroles et non plus d’un seul coup — une sérieuse contribution au succès de l’analyse : la révélation des secrets qu’il avait si soigneusement gardés jusqu’alors. Cela remplit les semaines et les mois suivants et marqua le début de l’analyse proprement dite.
Vous le voyez, je ne me préoccupai pas dans ce cas de faire surgir une conscience de maladie. La chose se fit d’elle-même, et d’une [p. 9] tout autre manière. La tâche essentielle ici était d’établir un lien assez fort pour soutenir l’analyse à venir.
Mais je crains que, d’après la description précédente, il ne vous reste l’impression que tout ne dépend, en définitive, que de la formation de ce lien. A l’aide d’autres exemples, tenant le milieu entre les extrêmes cités plus haut, je voudrais essayer d’effacer à nouveau cette impression.
On me proposa d’analyser un autre garçon de dix ans, qui, depuis quelque temps, présentait un symptôme très désagréable et très inquiétant pour son entourage. Il se livrait à des accès de colère et de méchanceté, qui se produisaient chez lui sans cause extérieure compréhensible, et qui étaient d’autant plus frappants que l’enfant était d’ordinaire plutôt timide et craintif. La confiance de l’enfant fut, dans ce cas, facile à obtenir, car je lui étais déjà connue d’antre part. Le recours à une analyse s’accordait aussi tout à fait avec ses propres intentions, car sa petite sœur était déjà ma patiente, et la jalousie qu’il ressentait des avantages qu’elle en tirait au sein de la famille contribuait à diriger ses désirs du même côté. Malgré cela, je ne trouvai aucun point d’attaque pour l’analyse. Mais l’explication ne fut pas longue à venir. Le garçon considérait bien ses craintes comme une sorte de maladie, et faisait effort pour s’en débarrasser. Mais il n’en était pas de même quant au plus important de ses symptômes, ses accès de fureur. Il en était positivement fier et les considérait comme quelque chose qui le distinguait aux yeux d’autrui, quoique pas précisément de la manière la plus favorable. Il jouissait du souci qu’il causait ainsi à ses parents. Il se sentait par là, en quelque sorte, attaché à ce symptôme et aurait probablement résisté à toutes les tentatives de l’en délivrer, par l’analyse. Ici encore, je me servis d’un moyen détourné et pas très droit. Je résolus de le mettre en opposition avec cette partie de lui-même, je lui fis décrire ses accès aussi souvent qu’ils se produisaient, je me montrai soucieuse et grave à leur sujet. Je m’informai en quelle mesure il était en somme encore maître de ses actes dans de tels moments, et comparai sa colère à celle d’un fou pour lequel mon aide pouvait à peine être prise en considération. Il en fut surpris et déconcerté, car il ne convenait plus à son amour-propre d’être considéré comme fou. Il chercha alors de lui-même à dominer ses accès, il commença de s’opposer à eux, au lieu de les surestimer comme précédemment, et, constatant sa réelle impuissance à les [p. 10] réprimer, il éprouva une aggravation de sa souffrance et de son mécontentement de lui-même. Finalement, après plusieurs essais infructueux, le symptôme ne fut plus considéré comme un avantage précieux, mais comme un défaut gênant, dont il devait se corriger, et il se montra tout prêt à accepter mon aide pour cela.
Vous serez frappé de ce que, dans ce cas, j’aie provoqué l’apparition d’un état qui existait de prime abord chez le petit obsédé, c’est-à-dire une scission dans le moi intime de l’enfant. Dans un autre cas aussi, celui d’une fillette de sept ans, après une longue période de préparation très semblab1e à celle que nous avons décrite plus haut, je me décidai à employer le même artifice. Je détachai subitement d’elle-même, en la personnifiant, toute sa méchanceté, à laquelle je donnai un nom à part, et je la lui opposai. J’arrivai finalement à ce qu’elle se plaignît à moi de cette personne ainsi créée ‘et en prit conscience dans la mesure où elle avait à souffrir d’elle L’enfant devint ainsi de plus en plus aisément analysable dans la mesure où, de cette façon, on lui avait fait prendre conscience de sa maladie.
Cependant, il ne faut pas oublier de mentionner ici, un autre écueil. J’eus à faire longuement à une enfant de huit ans, exceptionnellement douée, précisément à la petite fille hypersensible dont j’ai parlé plus haut et qui pleurait trop. Elle avait toutes les intentions de changer et les capacités et possibilités de tirer profit de l’analyse. Néanmoins, le progrès, chez elle, s’arrêtait toujours à un certain point, et j’étais déjà prête à me déclarer satisfaite du faible résultat obtenu, c’est-à-dire de la disparition du trouble essentiel. Il apparut alors, d’une façon toujours plus claire, que l’attachement de la petite fille à une bonne auprès de qui l’analyse n’était pas en faveur, constituait l’obstacle auquel nos efforts se heurtaient quand ils atteignaient une certaine profondeur. En effet, la fillette acceptait bien ce qui ressortait de l’analyse et ce que je lui, disais, mais seulement jusqu’à un certain point, jusqu’au point où elle s’y autorisait et à partir duquel elle voulait rester fidèle à sa bonne. Ce qui dépassait ce point se heurtait à une résistance tenace et invincible. La petite reproduisait ainsi un ancien conflit d’affection, du fait qu’elle devait choisir entre ses parents, qui vivaient séparés, conflit qui avait joué un grand rôle dans sa petite enfance. Cette découverte, cependant, ne servit pas à grand’chose, car l’affection que l’enfant portait à sa bonne était des plus réelles et des [p. 11] mieux établies. J’entrepris en conséquence une lutte opiniâtre contre cette bonne pour gagner l’affection de l’enfant. Je cherchai à éveiller l’esprit critique de l’enfant, à ébranler son aveugle attachement, tirant parti à mon avantage de tous les légers conflits qui se produisent journellement dans la chambre d’enfants. Et je vis que j’avais atteint mon but lorsqu’un jour la petite fille, me racontant encore un de ces incidents qui l’excitaient si fort, termina son récit en disant : « Crois-tu qu’elle ait raison ? » Dès ce moment, l’analyse prit de la profondeur et, de tous les cas mentionnés ici, fut celle qui amena le résultat le plus riche en promesses.
La question de savoir s’il est permis d’agir de telle façon, de lutter pour gagner l’enfant, fut facile à résoudre dans le cas donné.
L’influence de l’éducatrice aurait été défavorable non seulement à l’analyse, mais aussi à tout le développement de l’enfant. Représentez-vous donc combien le rôle de l’analyste devient pénible quand il a comme adversaire non des étrangers, mais les propres parents de l’enfant, ou quand il doit se demander s’il vaut la peine, en vue du résultat du travail analytique, de soustraire l’enfant à une bonne et favorable influence de quelqu’un. Nous reviendrons encore de façon détaillée sur cette question, en parlant de l’exécution pratique de l’analyse infantile et des rapports de l’enfant avec son entourage.
Pour terminer ce chapitre, j’ajoute encore deux exemples qui vous montreront à quel point l’enfant est capable de saisir le sens de l’effort analytique et son but thérapeutique. La plus remarquable à cet égard fut bien la petite obsédée mentionnée déjà à plusieurs reprises. Me parlant un jour d’une lutte particulièrement bien soutenue contre son démon, elle manifesta subitement le désir d’avoir mon approbation. « Anna Freud, me dit-elle, ne suis-je pas beaucoup plus forte que mon démon ? Ne puis-je pas très bien arriver seule à le dominer ? Au fond, je n’ai pas besoin de toi pour cela. » Je le lui accordai entièrement : elle était vraiment beaucoup plus forte que lui, même sans mon aide. « Mais j’ai pourtant besoin de toi », ajouta-t-elle alors, après une minute de réflexion. « Dans les moments où je dois être plus forte que lui, il faut que tu m’aides à ne pas être si malheureuse. » Je ne crois pas qu’on puisse attendre d’un adulte malade une meilleure compréhension du changement qu’il attend de sa cure analytique.
Mon second exemple se rapporte au méchant petit garçon de dix [p. 12] ans que je vous ai dépeint avec tant de détails. Il entra, un jour, dans une période ultérieure de son analyse, en conversation avec un patient adulte de mon père qui se trouvait avec lui dans la salle d’attente. L’étranger lui parla de son chien qui avait mis en pièces une poule. Lui, le maître, avait dû payer la poule. « Il faudrait envoyer le chien chez Freud, avait dit mon petit patient, il a besoin d’une analyse. » L’adulte ne répondit rien, mais exprima plus tard sa désapprobation. Quelle étrange idée le petit se faisait-il de l’analyse ? Rien ne manquait au chien ; il lui prend envie de mettre en pièces une poule, et il le fait. Je savais très bien, moi, ce que le petit garçon avait voulu dire. « Le pauvre chien — avait-il pensé, — il voudrait tant être un bon chien, mais quelque chose en lui le force à mettre en pièces des poules. »
Comme vous le voyez, ce petit garçon névrosé se sent plutôt méchant que malade, et ce sentiment d’être méchant devient pour lui le motif tout à fait valable de l’analyse.
(1) Société psychanalytique de Vienne.
Alençon. — Imprimerie Corbière et Jugalu.

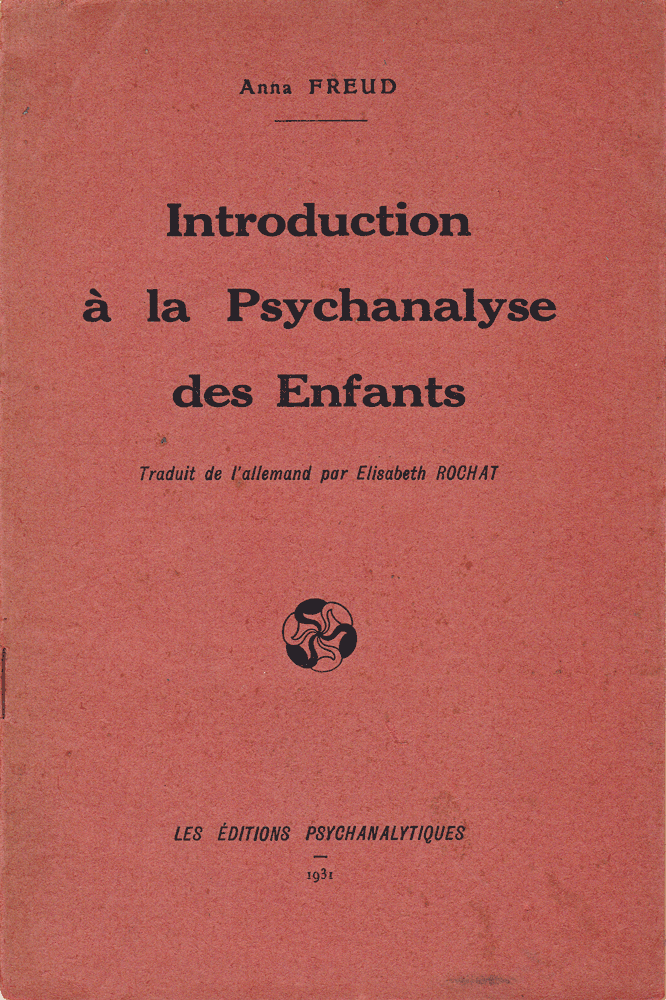



LAISSER UN COMMENTAIRE