 Françoise Dolto-Marette. Les sensations coenesthésiques de ben être et de malaise origines des sentiments de culpabilité. Extrait de la revue « Psyché – Revue internationale des sciences de l’homme et de psychanalyse », (Paris), avril-mai 1948, pp. 468-482.
Françoise Dolto-Marette. Les sensations coenesthésiques de ben être et de malaise origines des sentiments de culpabilité. Extrait de la revue « Psyché – Revue internationale des sciences de l’homme et de psychanalyse », (Paris), avril-mai 1948, pp. 468-482.
Tout Dolto se trouve en germe dans cet article, un des tous premiers paru après la thèse de l’auteur.
Françoise Dolto, née Marette (1908-1988). Médecin et psychanalyste. Aujourd’hui tout le mode connait Françoise Dolto.Nous renvoyons donc à quelques unes de ses publications les plus significative :
— Psychanalyse et pédiatrie. Le complexe de castration. Etude générale – cas cliniques. Paris, Amédée Legrand, 1939. 1 vol. in-8°, 281 p., 1 fnch. Bibliographie. Président de thèse : Laignel-Lavastine.
— Attitude devant le symptôme. Extrait de les revue « Sauvegarde de l’enfance », (Paris), n° hors-série, 1951, pp. 199-201. [en ligne sur notre site]
— Psychanalyse et pédiatrie. Les grandes notions de la psychanalyse. Seize observations d’enfants. Paris, Editions du Seuil, 1971. 1 vol. in-8°.
— Le cas Dominique. Paris, Editions du Seuil, 1971. 1 vol. Dans la collection « Le champ freudien ».
— Au jeu du désir les dés sont pipés et les cartes truquées. Extrait du Bulletin de la Société française de Philosophie, 1972. Paris, Armand Colin, 1972. 1 vol.
— L’image inconsciente du corps. Paris, Editions du Seuil, 1984. 1 vol.
— Tout est langage. Paris, Vertiges du Nord/Carrère, 1987. 1 vol.
— L’enfant du miroir. Paris, Rivages, 1987. 1 vol.
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr
[p. 468]
LES SENSATIONS COENESTHÉSIQUES
DE BIEN-ÊTRE ET DE MALAISE
ORIGINES DES SENTIMENTS DE CULPABILITÉ
par le Dr Françoise DOLTO-MARETTE.
SOMMAIRE
— Le Bon, le Mauvais, le Bien, le Mal. Méthode d’appréciation des sentiments vécus par l’observé : l’expression de crainte et le, sentiments de culpabilité.
— Les besoins vitaux. Hiérarchie. Conditions. Bien-être, malaise.
— Passivité et agressivité aux stades oral et anal avant la marche. Réceptivité, productivité. Affectivité en rapport. Autorisation, interdiction de l’expression par l’entourage. Conséquences.
— Age de la motricité corporelle.
— Dangers extérieurs. Exemples : le feu, la pesanteur, l’équilibre. Les contacts sociaux. Acquisition des échelles de valeur. Prudent, imprudent. Facile, difficile. Fort, faible.
— Dangers intérieurs. Exemples : épreuve, d’aimer en s’identifiant à l’objet d’amour. Apprentissage de la responsabilité avec ou sans culpabilité.
— Conclusion.
♦
Au cours de ces journées de Royaumont, on a parlé de modalités du sentiment de péché, c’est-à-dire du sentiment de culpabilité conscient, on a parlé des relations étroites entre le sentiment conscient de culpabilité et ce que les psychanalystes appellent, sans avoir encore trouvé un meilleur terme, le sentiment inconscient de culpabilité. Pour ce dernier, on a montré ses relations avec le mécanisme d’échec, avec les sentiments d’infériorité complexuels. Le docteur Laforgue a parlé du rôle apaisant que les religions, et surtout la religion catholique, peuvent avoir sur le sentiment de culpabilité inconscient de, leurs fidèles. Je voudrais, en tant que psychanalyste d’enfants, apporter une modeste part à cette étude par des observations cliniques sur les premières manifestations chez l’enfant du sentiment de culpabilité.
Quand l’enfant commence à exprimer un jugement moral sur ses actes on ceux des autres par l’adverbe « bien », ou « mal « , ces jugements sont toujours liés à une mimique de crainte ou de révolte, et il y a la notion impliquée d’une liberté de choix : on pourrait (ou l’on aurait pu) ne pas agir. Il y a aussi la recherche implicite d’une confirmation de jugement par un autre, et de préférence un adulte : l’adulte semble-t-il « content » ou « pas » voilà ce qui compte. Il est curieux de constater au contraire, que [p. 469] lorsqu’un enfant décrète qu’une chose est « bonne » ou qu’elle est « mauvaise », il ne demande pas son avis à l’adulte et peut même s’opposer sans trouble (sauf dans le cas d’une éducation très méprisante de la liberté de l’individu) aux jugements esthétiques, gustatifs ou sensoriels des adultes. Il y a donc une échelle de valeurs « Bien-Mal » qui ne subit pas dans la psychologie les mêmes règles d’élaboration que les échelles de valeurs « Bon-Mauvais », « Agréable-désagréable », « Beau-Laid » (1). Celles-ci sont des perceptions directes, inhérentes à la nature de chacun et, bien que relatives et dépendant de chaque individu, elles sont ressenties par le sujet comme des absolus. Ce que je trouve mauvais, ce qui m’est désagréable, moi seul en suis juge. L’échelle « Bien-Mal », au contraire, servant un but exécutoire est conçue comme absolue parce qu’il s’agit d’un concept partagé par les adultes ; et cependant elle s’élabore en chacun par la succession d’expériences vécues au contact des autres, c’est-à-dire d’une façon relative. L’enfant n’est jamais sûr de ce qui est bien ou mal. Il est seulement sûr de ce qui lui apporte du bon, ou du mauvais à vivre, c’est-à-dire à ressentir.
Mais l’enfant qui commence à parler du bien et du mal n’est pas né de la veille. C’est déjà un être très complexe, et il peut être intéressant d’étudier les étapes de son évolution par rapport au « Bon » et au « Mauvais », depuis sa naissance jusqu’à ses premiers jugements conscients sur le Bien et le Mal, vers deux ans et demi à trois ans suivant les sujets.
En observant les autres, nous n’observons jamais que des comportements. La psychologie infantile des tout-petits ne nous offre qu’un critérium, c’est la mimique de l’enfant ; car à cet âge l’être humain ne s’exprime pas autrement. Il va vers les choses quand il est positif à leur égard, attiré par elles, ou mis en appétit. Il s’en détourne quand il est négatif à leur égard, sans attirance pour elles. Lorsqu’il s’oppose activement, il serait superficiel de dire qu’il n’est pas attiré, à moins que ce qu’il n’aime pas lui soit imposé contre son gré ; dans ce cas il se défend. Plus généralement, s’opposer à quelque chose est chez l’enfant le signe de son attirance pour cette chose, mais aussi de la crainte mêlée à cette attirance à cause des désagréments qui suivraient l’acte. En présence d’une chose ou d’une personne qui lui est bonne, l’enfant se sent à l’aise et présente une mimique de détente, de dilatation, d’épanouissement et de repos. Au contraire, ce qui lui est mauvais le met mal à l’aise, provoque chez lui une mimique de tension, de fermeture, de crispation, d’excitation.
Toutes les observations aboutissent à la constatation suivante. Qu’il soit conscient ou inconscient, le sentiment de culpabilité, chez l’adulte comme chez l’enfant, est sous-tendu par la crainte. C’est la crainte d’un mal à subir, d’une blessure ou d’une douleur [p. 470] imaginée, d’un danger entrevu, d’un malaise fait de l’imagination, claire ou confuse, des conséquences d’un risque couru si le sujet exécute un acte qui a été (comme tout acte libre ou spontané) une expression de la vie à travers son propre corps.
Il est donc important d’étudier les expressions de fa vie d’un être humain, et les rapports qui s’établissent pour lui entre les expressions de sa vie et :les états de bien-être et de malaise. C’est seulement par des études cliniques de l’embryogénie des états inconscients de bien-être et de malaise accompagnant les étapes du premier développement, que nous comprendrons les rapports psycho-somatiques (l’angoisse et ses manifestations individuelles) du sentiment inconscient de culpabilité.
♦
Un enfant est né. C’est un agrégat synthétique organisé de cellules qui obéissent à des lois de mouvements progressifs à rythmes alternés, servant la persévérance de l’être et sa croissance vers un état de maturité caractérisé par la reproduction. Tous ces mouvements sont inscrits dans le temps et dans l’espace. La vie se caractérise par la modification continuelle de l’état interne. —A un certain rythme l’organisme éprouve des besoins relatifs à sa croissance. La sensation d’un besoin provoque une excitation, qui déclenche certains mouvements spontanés propres à en permettre la satisfaction chez le nourisson, la bouche s’ouvre en s ‘élira nt à la recherche du sein ; quoiqu’il trouve, il suce. Si du liquide vient, il boit. Cette satisfaction apporte la détente, avec l’expression apparente de bien-être, fa mimique de dilatation reposée. Nous savons que cela lui est lion. Ce qui n ‘est pas satisfaction lu; est mauvais ; il ~e crispe, il crie ; on pourrait dire à ce stade, dit oral, que la libido, pousse l’être à exprimer sa tension par Ile cri. Le cri est bon, parce qu’il soulage la tension libidinale. Le mouvement alternatif imprimé au corps (le bercement) est bon aussi ; il apaise une tension énergétique. Un objet à sucer qui convient au besoin de succion réflexe (expression de fa tension libidinale à cet âge) calme aussi l’enfant. C’est « bon » jusqu’à ce que le non-assouvissement de la faim soit ressenti de nouveau au bout d’un certain temps de succion sèche.
Tous les besoins végétatifs inhérents à la vie sont ressentis comme bons, désirables, en deçà et au-dessus de toute échelle de valeur esthétique et morale. Tels sont le besoin d’air, d’eau, de nourriture, le besoin de lumière, d’ombre, le besoin rythmé de veille et de sommeil. Pour chaque être humain et à chaque âge, l’expression rythmée de ces besoins spontanés est bonne alors que leur non-satisfaction ou leur satisfaction à contre-rythme est ressentie comme mauvaise. Si l’enfant a faim et crie, et qu’il ne reçoive pas de nourriture, au bout d’un certain temps l’organisme fatigué épuise sa libido ; le petit assoiffé, affamé cesse de crier ; il n’éprouve plus de besoin. La faim, à force de le faire souffrir, n’est plus « bonne », et l’enfant non seulement ne cherche plus à prendre [p. 471] la nourriture qu’on lui offre, mais il n’a plus d’incitation à manger. Il respire inerte, les yeux ouverts et sans cris, jusqu’à sa mort par inanition. Ce qui est bon peut donc perdre sa valeur bonne lorsque l’organisme a trop souffert de n’être pas satisfait. Il y a inhibition de l’appétit dans ses sources mêmes, recul de l’expression libidinale, « désinvestissement » du tube digestif, fixation régressive de la libido sur les sens de perception passive : ouïe, vue, puis plus tard encore sur l’arbre respiratoire et le sommeil.
En effet, on pense trop souvent que c’est par le mécanisme nutritif que le bébé manifeste ses premières réactions de vie. Cet exemple du bébé mourant d’inanition, comme certains ont, hélas ! pu en voir ces années dernières, montre que l ‘Instinct respiratoire est plus essentiel que l’instinct nutritif, et que le sommeil est une traduction du refuge à l’intérieur de soi quand les relations avec le monde extérieur n’apportent plus vie.
On sait que le rythme cardio-fœtal fait place à un rythme cardiaque tout différent, dès la première inspiration ; celle-ci s ‘accompagne d’une modification anatomique du cœur (l’obturation du trou de Botal). En même temps que se produit cette modification de l’anatomie et de la physiologie, l’enfant se sépare activement de l’organisme maternel, il y a arrêt du battement sanguin dans le cordon ombilical et autonomie organique. La relation étroite cardio-respiratoire d’angoisse est conservée chez l’adulte, et une manifestation fréquemment éprouvée chez les anxieux est le trouble du rythme cardiaque relié à une inhibition du souffle. La mimique de celui qui éprouve une surprise pénible n’est-elle pas classique : inspiration brusque, violente et bloquée, en même temps que le sujet porte la main à son cœur.
Le rythme respiratoire est donc la première manifestation du « Bon » mêlé au fait d’« Être » hors de l’utérus maternel. Or, il peut arriver que même sur ce plan le plus primitif des manifestations vitales, l’enfant éprouve un malaise dangereux et même mortel. Le mouvement respiratoire est une chose passive, semble-t-il, naturelle en soi. Mais il faut des conditions optima d ‘air et de température pour que l’inspiration soit ressentie par l’enfant comme bonne. Tout ce qui est chez le nourrisson est bon et correspond à un rythme intérieur euphorique, entraine, avons-nous dit, une mimique de dilatation. Si les conditions (température hygrométrique) lui sont mauvaises, nous remarquons chez l’enfant une mimique de crispation correspondant à un sentiment de malaise.
En février 1945, à Paris seulement, 1.000 nourrissons environ de zéro à deux mois sont morts dans la même nuit de bronchite aiguë, causée par le grand froid. Le « bon » de la respiration devenant « mauvais », l’enfant inhibe son mécanisme. Devant les dangers cosmiques l’être humain montre en effet par une mimique de crispation l’inhibition de ses rythmes vitaux. Au point de vue physique, nous constatons d’une part des alvéoles pulmonaires crispées dans la fermeture alors que d’autre part la vie veut s’extérioriser en les dilatant ; l’opposition de ce double mécanisme engendre la congestion des alvéoles, le suintement du sérum, [p. 472] l’obstruction des voies respiratoires, entraînant ainsi la sidération de la vie. Nous voyons la mousse apparaitre aux lèvres du nourrisson, le cœur et tout le système cardio-vasculaire relié dès la première respiration avec l’arbre bronchique est lui aussi dérythmé. Mécaniquement l’hématose du sang se fait mal, et l’enfant s’asphyxie.
J’ai assisté à cette lutte pour vivre chez un bébé de six semaines qui a subi l’assaut de ces grands froids et qui, grâce à la cloche à oxygène et peut-être aussi à son grand calme naturel a pu passer le cap des quelques heures dangereuses. En huit jours, toujours sous sa cloche à oxygène où on le mettait par périodes de moins en moins longue, il a récupéré la santé. Or chez cet enfant, élevé ensuite sans difficulté, à six mois, lors des premières manifestations dentaires, une crise d’asthme s’est produite et se déclenche depuis, chaque fois qu’il se trouve dans des états de malaise organique quelconque.
J’ai en traitement plusieurs enfants asthmatiques sujets à des crises plus ou moins fréquentes qui duraient généralement trois à quatre jours. Au cours de leur traitement psychanalytique entrepris d’ailleurs pour d’autres raisons (énurésie, troubles du caractère, mauvaise scolarité) ces enfants présentent des crises d’asthme qui surviennent subitement, soit au cours d’une séance, soit au cours des journées intercalaires, et qui sont caractérisées par leur courte durée.
J’ai actuellement en analyse un enfant qui fait de l’asthme pendant dix minutes à un quart d’heure, ce qui ne lui était jamais arrivé avant son traitement. Chaque fois que j’ai pu assister au cours de l’analyse à l’apparition ou à la disparition de son asthme, il s’agissait d’émois associée à des sentiments de culpabilité inconscients qui remuaient des résonances de malaise à vivre sur les plans les plus profonds de· la psychologie. Les asthmatiques me paraissent des êtres précocement sensibles et qui ont été précocément en danger affectif ou organique, à l‘âge du stade oral passif.
Si l’expression du malaise à vivre fait entrer en résonance un complexe de castration qui s’est installé sur le terrain où le malaise s’est une fois exprimé par la menace de manque d’air, le sentiment de culpabilité inconscient peut réveiller des troubles somatiques cardio-respiratoires. A un degré moindre de profondeur dans le stade oral, le malaise à vivre peut se traduire par un dérythmage du dynamisme nutritif; appétit, digestion, miction, défécation.
Les nourrissons diffèrent extrêmement entre eux pour le besoin qu’ils ont du lait, en quantité et en qualité. La faim et la soif ne sont pas confondues à cet âge. Tel nourrisson crie pour avoir de l’eau et non du lait. Ayez les deux biberons à portée et proposez-lui ] ‘un et l’autre : vous vous en apercevrez très bien. Maintenant que beaucoup d’enfants sont nourris au biberon, et que les mères qui nourrissent se montrent si respectueuses des prescriptions d’horaire et de quantités, les nourrissons sont beaucoup plus traumatisés dans leur nourriture qu’à l’époque, révolue dans nos sociétés civilisées, où fa nourrice donnait le sein dès que l’enfant criait. Chez mes [p. 473] propres enfants, j’ai constaté que la dilution nécessaire différait manifestement pour chacun d’eux.
L’enfant sain cric sans crispation. L’adulte expérimenté, la mère normalement intuitive savent très bien faire la distinction entre le cri sain, sthénique, non angoissé, non crispé, non douloureux, exprimant les besoins de la vie, la demande de changement, de tétée, et le cri de souffrance : colique du nourrisson, douleur des oreilles, faim douloureuse, douleurs dentaires. Il faut respecter les cris de l’enfant ; ils nous incitent à trouver ce qui lui manque. Si nous n’y parvenons pas, nous ne devons à aucun prix répondre par nos propres cris, exercer notre brutalité pour les réprimer. Pour l’enfant, crier est une manifestation de la vie, une expression de lui-même ; crier est meilleur que ne pas crier. Si c’est par l’effet d’une coercition que l’enfant s’abstient de son cri, l’inhibition s’installe comme une conséquence (réflexe conditionnel de perversion des rythmes vitaux, somatiques) de la traduction de sa vie. Ce qui est « naturellement bon » sur le plan des incitations devient étroitement associé au mauvais. Vie égale danger.
Les traumatismes qui surviennent à cet âge oral, en créant non seulement une perversion mais une inversion des rythmes vitaux, peuvent handicaper sérieusement le développement. ultérieur de l’individu. Condamner l’expression libre des rythmes vitaux au stade oral, c’est en effet condamner dans l’œuf l’ensemble de la libido qui aura à se développer dans les stades ultérieurs, anal, urétral et génital. Tout l’être psycho-affectif est vulnérable quand il est. atteint à a ‘âge au stade oral, de même que tout l’arbre est vulnérable dans la première pousse qui sort de la graine en germination.
Admettons que tout se soit bien passé au premier stade de la vie ; réception d’air, réception de nourriture. Les premiers mouvements de l’enfant sont l’expression même de sa vie, mouvement. des bras et des cuisses sur le tronc. Si ces mouvements ne sont pas libres il se sentira gêné dans sa manière de s’exprimer et d’être. Si crier apporte la souffrance, si remuer apporte la souffrance, l’enfant se dérythme sur le plan digestif ou sur le plan respiratoire. Mais il y a d’autres expressions que le mouvement non motivé. L’enfant à ce stade digestif communique avec le monde par sa bouche. De même qu’il vit en détruisant ce qu’il avale, et qu’il est bien à l’aise avec sa mère en avalant ce qui vient d’elle pour le détruire et en faire sa propre chair, de même les manifestations de sa libido transférée sur les objets seront à base de succion et destruction par la bouche ou par les mains des objets auxquels il s’intéresse. Si l’on condamne cette activité au· nom de la mésentente avec l’adulte et de la douleur infligée à ses mains ou à son corps trop bruyant et trop remuant, cette condamnation est ressentie par l’enfant comme atteignant une expression de sa vie. Ses incitations ultérieures à vivre, s’il est sensible et s’il a de la mémoire, réveilleront en lui la menace. Il inhibe alors toutes ses expressions gestuelles ; il a subi une « castration sur le plan anal », dit-on dans le langage psychanalytique. Il est important de laisser [p. 474] à l’enfant de dix à quinze mois qui se plait à détruire, à déchirer, à casser, cette activité spontanée qui lui est visiblement. très bonne, cela dans les plus grandes proportions possibles. Les restrictions doivent être partielles, et toujours compensées par une autre possibilité d’exprimer sa vie. Combien de fois entendons-nous dire : « ne touche à rien ; ne bouge pas, ne dis rien », négation de toute possibilité de créativité.
Or, dans nos sociétés citadines, c’est à cet âge-là qu’apparaît la coercition ; ce qui est bon pour l’enfant lui devient alors mauvais de par la foule des adultes et apporte le danger. L’enfant, pour obéir, inhibe ses mouvements d’expression un certain temps ; mais en lui la vie s’accumule sans s’exprimer. Les exigences instinctives eu conflit avec les exigences de la morale du comportement imposé par l’adulte amènent l’enfant à régresser sur un mode plus infantile. Il crie, tape du pied, tombe assis par terre en remuant les jambes et les bras par flexion sur le tronc comme le petit nourrisson. Parfois, en se roulant à terre, il traduit même une régression au stade d’avant quatre mois, antérieurement à la conquête de la position assise. Par tout ce comportement qu’on appelle un caprice, il peut retrouver une certaine satisfaction organique sur ces stades régressifs, satisfaction nécessaire à l ‘apaisement de sa tension libidinale.
Ces premiers « caprices » sont pour l’enfant une manière de traduire la souffrance de s’être exprimé mal, ou autrement qu’il le voulait. Par malheur l’adulte se méprend trop souvent sur leur signification. Il y voit une manifestation agressive dirigée contre lui. Il adopte alors une attitude agressive, et par là installe définitivement l’enfant dans un mode de réaction qui devient à son tour volontairement agressif. Que l’adulte, au contraire, évite de réagir de la sorte, et les caprices disparaîtront rapidement, à mesure que l’enfant sera mis en confiance par ses propres réussites, qu’on lui aura permis d’obtenir par lui-même.
Au stade anal passif correspondant au stade oral déjà agressif, (morsures volontaires et ludiques), l’enfant mange des aliments qui ont été des êtres vivants ; il mange la vie, la dissocie et en assimile les éléments. Pour vivre il est bon pour lui d’excréter, d’uriner d’abord passivement, et il ne le fait que lorsqu’il est dans un ordre intérieur, à l’aise. Le nourrisson ne fait pipi que sur les gens qu’il aime, il urine et défèque quand il est repu. Il faut que l’enfant sente que son incitation à déféquer qui est bonne pour lui, n’a pas de valeur aux yeux de l’adulte. Il faut que l’acte de la défécation soit laissé libre. La défécation au rythme qui est le sien, est pour lui la traduction spontanée des caractéristiques de sa vie.
Quand l’enfant commence à exprimer la motricité de ses muscles volontaires, il s’aperçoit spontanément que sa défécation et l’émission d’urine peuvent être arrêtées, inhibées, activées. L’enfant peut être incité à « pousser » par la présence du bol fécal sur son périnée, mais il peut aussi jouer à pousser, à partir du moment où, à l’occasion de nombreuses défécations spontanées, il a ressenti le mécanisme des muscles périnéaux. Des névroses obsessionnelles [p.475] peuvent naitre à ce moment du stade anal, si l’adulte demande, à plus forte raison s’il exige un certain rythme de défécation et d’excrétion pour conserver un commerce agréable avec l’enfant.
J’ai vu le cas d’une famille où la mère exigeait dès les premiers jours de la vie la défécation et l’excrétion d’urine à heures régulières, en grondant et en donnant quelques tapes au nourrisson récalcitrant. Dans celle famille, le petit que j’ai vu à huit ans avait été propre complètement à sept jours, et depuis fors n’avait jamais sali ni mouillé ses couches jusqu’à l’âge de quatorze ou quinze mois. A cet âge, il est devenu bizarre ; à dix-huit mois il s’est montré un obsédé du voyeurisme des régions sexuelles de tous les adultes, et a développé un comportement de plus en plus anormal qui aboutit à en faire un schizophrène. Dans cette même famille, une fille n’avait pas atteint la propreté avant deux à trois mois, malgré une éducation identique . Je ne l’ai pas vue ; elle était, m’a-t-on dit, normale dans son comportement.
Sans aller jusqu’à ces extrêmes, bien des mères ou des éducatrices croient bon, alors qu’au contraire cela est très dangereux, de « dresser » tôt l’enfant à la propreté sphinctérienne. Pourtant on sait bien que le système nerveux central n’est pas terminé avant dix-huit mois, deux ans, deux ans et demi. Souvent chez des enfants la moelle épinière n’atteint son complet développement que vers cet âge. Jusque-là, le développement anatomique des nerfs qui vont aux terminaisons des membres inférieurs, des régions cutanées, fessières et périphériques en général n ‘est pas achevé. Avant cet achèvement anatomique du système nerveux, la conquête de la motricité sphinctérienne par la libre découverte du jeu des muscles qui président au fonctionnement sphinctérien n’a pas été faite. Si l’enfant, quand il est tout petit, peut obtempérer aux interdictions et aux ordres de déféquer et d’uriner, imposés par l’adule dont toute sa vie dépend, ce n’est pas en agissant sur le sphincter seul. C’est en inhibant ou relâchant inconsciemment toutes des incitations nerveuses du plexus sacré, et même tout son être nerveux, car les plexus vago-sympathiques sont reliés entre eux. Dans ce « dressage », tout son être nerveux est pour ainsi dire « greffé » sur l’adulte au nom de la crainte que lui inspire le malaise affectif.
De tels enfants soumis au dressage précoce ne présentent par ailleurs aucune aisance dans leurs mouvements, aucune adresse acrobatique ou manuelle ; ils se caractérisent même par une absence de modulation de la voix. Ils ont l’expression générale de robots humains. De plus ils connaissent toujours, à trois ou quatre ans, une période pendant laquelle ils perdent la propreté sphinctérienne que la maman croyait acquise depuis si longtemps. Au cours de ces périodes plus ou moins longues de malpropreté inévitable, ils ont à apprendre ce qu’ils n’avaient jamais appris, le contrôle sphinctérien autonome.
En fait, l’enfant à qui a été épargnée la discipline sphinctérienne imposée, a l’avantage de s’élever sans ces brouilles affectives qui surviennent habituellement cinq à six fois par jour entre [p. 476] l’adulte et l’enfant. Il n’a pas honte de ses excréments ; il n’a pas peur de ses mouvements. L’expérience montre que lorsqu’il devient capable de monter ou de descendre seul quatre à cinq marches d’une vulgaire échelle de ménage, ce qui veut dire que son système nerveux pyramidal est achevé, il acquiert spontanément la propreté sphinctérienne. Il est propre parce que cela lui plaît, parce que cela s’inscrit dans sa libre nature humaine. Il ne s’agit pas, comme chez l’enfant « dressé », d’une conquête qui le fasse bien voir de l’adulte. Pour lui, ce n’est pas « bien » de déféquer et d’uriner à l’instar des adultes dans un endroit réservé à cet effet ; ce n’est pas « mal » de ne pas le faire. Cette pratique rentre dans les acquisitions des expériences de son corps et du sens social le plus primitif : l’imitation spontanée du comportement des autres, par identification-plaisir.
L’âge de la motricité corporelle volontaire.
L’enfant en grandissant se heurte à des dangers réels, indépendants du comportement des adultes qui l’entourent. Sa façon d’y réagir varie beaucoup d’un être à l’autre. Voici quelques dangers réels rencontrés par l’enfant, et les réflexions des enfants au cours de leur prise de connaissance.
Le danger du jeu. —Jean, 9 mois, et Katia, 14 mois, la première fois qu’on allume le poêle, s’approchent du feu, intrigués. Ils étendent une main pour sentir la chaleur. Celle-ci devenant trop forte, ils se retirent instantanément tout en faisant la mimique et l’onomatopée de souffler. Le souffle, expiration volontaire, exprime (associé aux rythmes respiratoires) l’éloignement du danger, le refus de l’envie, de l’aspiration à toucher.
Gricha a dix mois, enfant beaucoup plus instinctuel, a besoin d’appréhender les objets qui l’entourent ; l’expérience concrète, tactile, est pour foi une chose indispensable à son évolution. Son attitude devant la même expérience a été toute différente de celles de son frère et de sa sœur. Il touche le poêle d’abord une fois, me regarde ; je lui dis : « ça brûle » ; il sourit d’un air rusé et recommence, retire encore sa main, puis le touche une troisième fois à dessein, en se brûlant un peu plus à chaque reprise. La dernière lui fait une brûlure étendue à toute la paume. Cette expérience en trois temps, il l’a faite en pleine liberté, avec un air amusé et rusé, tout en conservant sa mimique dilatée et réjouie. Il lui a fallu sentir dans son corps les effets du feu pour croire à ses conséquences mauvaises ; s’étant ainsi brûlé il a pleuré à peine et était visiblement satisfait de lui. Cette souffrance semblait être ressentie par lui comme bonne, comme un résultat positif, l’enseignement d’une expérience libre. Le fait d’avoir pendant plusieurs semaines une main invalide ne l’a nullement gêné. Il n’a plus touché le feu, [p. 477] mais il n’en avait pas plus peur que son frère et sa sœur : on l’évite, c’est tout. Toucher au feu n’est pas défendu par la conscience morale mais par la prudence acquise.
Il est important au point de vie psychologique que l’enfant soit libre de ressentir ses expériences. Il ne faut pas que l’adulte l’empêche de courir les risques réels qui font partie de la connaissance du monde au nom d’un risque ou d’une menace d’intervention brutale. L’enfant aime observer par lui-même, expérimenter. S’il y a risque, il doit pouvoir le courir, à condition naturellement qu’il ne s’agisse pas d’un risque très grave ou mortel. Or la nature ne propose pas d’emblée au bébé des risques mortels. Les risques qu’elle propose, s’il peut librement les courir, lui enseignent seulement la prudence.
Le danger de l’élévation. —Jean, âgé de sept mois, se trouve à la 9e ou 10e marche de l’escalier qui monte à l’étage supérieur. Il s’était glissé à quatre pattes par la porte du palier restée ouverte. Je le cherche dans la maison, et l’aperçois enfin, tout étonnée de le trouver là en si dangereuse posture. Sa figure dilatée de plaisir par l’effort réussi d’avoir monté les marches, se crispe soudain à ma vue. Sa bouche s’ouvre, ronde, sans crier ; ses yeux s’agrandissent, chargés d’angoisse et me regardent, inquiets sans doute de voir mon visage à la hauteur du sien : situation insolite d’être haut sans être porté à bras. Quoi qu’il en soit des motifs intérieurs, il était heureux avant de m’avoir vue ; il a cessé de l’être et il est anxieux. Je me hâte de monter et de le prendre dans mes bras, je le complimente, je l’embrasse, et nous refaisons ensemble le même chemin… Le souvenir du danger resta ainsi dans l’esprit de l’enfant associé à quelque chose de bon : au danger qui pouvait être surmonté. Si j’avais adopté une attitude. de peur et de reproches, l’enfant aurait eu un sentiment inconscient de culpabilité. La crainte de l’adulte méchant serait venue confirmer et aggraver le malaise initial, dû à la situation elle-même, par un malaise affectif, ce qui aurait probablement engendré la peur d’entreprendre de nouvelles expériences. Bien sûr, j’ai veillé à la porte d’entrée, mais désormais l’échelle de ménage a été fréquemment ouverte et laissée à sa disposition, pour qu’il puisse y grimper à quatre pattes, ce qui représentait pour lui un effort risqué et très captivant, agrémenté de chutes et de recommencements.
Les dangers des contacts sociaux. —Jean arrive au jardin d’enfants. Il a deux ans et demi. Et y a là une fillette de sept ans, nommée Bernadette, légèrement retardée par un traumatisme obstétrical et qui frappe systématiquement tous les « nouveaux » sur la tête. A l’entrée de Jean, elle prend un bâton et, se livre à son exercice habituel. Jean dit : « Ho là là » et se dérobe comme il peut. Chaque fois que les enfants étaient laissés à eux-mêmes le même manège recommençait. Le troisième jour, même jeu, Jean ne se défend toujours pas. Étonnement de la jardinière. Fallait-il inciter l’enfant à répondre par la violence à la violence ? Jusqu’alors elle avait ce principe de ne pas intervenir entre les enfants. Le soir Jean [p. 478] pleure, refuse de retourner le lendemain à l’école sans toutefois en avouer le motif réel. Dans cette crise d’angoisse, c’est son contact avec la société qui est en cause. C’est pourquoi je le reconduis à l’école malgré les larmes, le mettant ainsi en face du conflit à résoudre. Ce jour-là, qui est le quatrième, Jean à son entrée est accueilli par tous les enfants au cri de : « Voilà le bon Jean Dolto ». L’enfant relève la tête et déclare, un peu solennel, dans un silence étonné : « Aujourd’hui il faut faire attention, j’ai mes nerfs ». Les enfants stupéfaits de cette déclaration imprévue la répètent : « Le bon Jean Dolto dit qu’il faut faire attention, il à ses nerfs ». Bernadette ne l’a pas touché. Il était définitivement libéré d’elle. Je viens chercher l’enfant à la fin de la matinée et lui apporte des douceurs pour compenser le chagrin du matin. Il prend les bonbons et me demande s’il peut en donner. —« Bien sûr ». Il porte un bonbon à Bernadette. Celle-ci sidérée, n’y touche pas. Il le pose devant elle, va trouver la jardinière et lui dit : « Va lui dire que c’est pour elle. Elle ne comprend pas. Sur le chemin du retour il me confie : « J’aime bien toutes les fiancées et c’est Bernadette que j’aime le mieux. » Bernadette avait été l’épreuve majeure apportée par le premier groupe social. Épreuve difficile, pénible à surmonter. Mais, une fois passée, elle a laissé l’enfant content, apaisé, et inconsciemment reconnaissant à celle qui avait été la cause de cette acquisition d’expérience.
Cette observation nous révèle que chaque enfant a son type de réaction ; il importe de respecter ce type et de ne pas proposer à un enfant un mode de défense particulier. Il trouve le mode qui est le sien dans sa nature même, si devant une situation d’infériorité réelle il peut réagir avec ses ressources propres, et sans être alourdi par des sentiments d’infériorité complexuels étrangers à la situation. L’obstacle a été surmonté, dans l’exemple précédent, non pas d’une façon motrice, mais d’une façon mentale. Bernadette avait été l’élément dangereux avec lequel il fallait composer. Jean a dû apprendre à composer avec la nature qui était la sienne. Bernadette a été ressentie pour lui comme « mauvaise » ; il a cherché d’abord à l’éviter. Mais devant la persistance de la difficulté après une tentation de fuite, il l’a considérée comme une sorte d’élément à dominer, qui n’avait rien à voir avec le bien ou le mal moral. Plus tard, comme on parlait de la manie de cette fillette qui recommençait son manège aux dépens d’un autre, Jean affirma : « Elle est embêtante à taper sur les autres, mais elle est pas méchante ». Il réagissait en somme vis-à-vis de cette petite comme vis-à-vis d’un quelconque problème de sécurité posé par un danger réel.
♦
Après ces exemples de dangers extérieurs à l’enfant, voici quelques dangers inscrits dans sa nature affective, et qui peuvent être [p.479] la source de sentiments inconscients de culpabilité, si l’enfant n’est pas laissé au libre jeu de ses mécanismes psychologiques autonomes.
Expériences de danger d’aimer.
J’ai déjà parlé, dans un article publié dans Psychésur la jalousie du puiné, du danger ressenti par le dernier dans le fait d’aimer un petit qui nait après lui dans fa famille. Aimerentraine une identification de soi à l’objet d’amour ; la tentation d’aimer un plus petit que soi, image involuée de soi-même, incite à la régression dans ses propres stades infantiles. Il faut donc que le puîné refuse l’amour pour le nouveau, l’attaque afin de se défendre du danger de l’aimer, lui cause un dommage. Mais, alors que c’était « bon » pour lui d’avoir envie de lui en causer un, le fait de le lui causer réellement déclenche une souffrance en retour, par identification de l’attaquant à l’attaqué. Quand l’enfant aime, il aime manger ; il est important qu’il puisse être actif et qu’il ait le droit d’imaginer qu’il va mordre et manger ce qu’il aime.
—Oh ! me dit Jean à trois ans dix mois, d’un air réjoui, n’est. ce pas qu’on va la manger la petite sœur, on la mangera à Pâques ? » (la fête en vue après Noël écoulé). « Dis, maman, tu me promets, on va la cuire et la manger, elle est si bonne, si bonne », ajoute-t-il d’un air attendri. » —« Mais oui », dit maman. Et Jean, heureux, renouvelle ses marques d’affection envers la cadette, quitte à me dire deux mois après : « Tu le rappellera, maman, quand j’étais petit (sic)je disais que je voulais la manger. Mais elle est bien trop bonne, si on la mange on ne l’aurait plus… » Et Jean se contente depuis ce jour-là de la manger des yeux, et de baisers dans ses moments d’attendrissement, de la frapper dans ses moments de domination.
A l’âge où il désirait manger sa sœur, dominait aussi le désir de percuter la femme, accompagné de propos et de gestes ludiques. « Marie », dit Jean à trois ans dix mois, « je m’en vais vous crever le popotin » et, armé d’un manche à balai dont il la poursuit, il rit au seul contact de sa jupe. Le lendemain il lui donne un coup de poing dans le flanc. La bonne, qui faisait un lit, et qui se trouvait en équilibre instable, tomba sur le lit. Quelques heures après cet événement, Jean, triomphant, court vers un ami de son père et lui dit : « Monsieur, vous savez, je suis grand, j’ai donné un coup de poing à Marie et elle est tombée ! Je suis un homme ». Ainsi s’établit en vue d’affirmer sa personnalité le contact avec un être complètement sexué. Tout cela partait d’incitations spontanées, « bonnes », émanant des rythmes mêmes de la vie masculine au stade moteur, oral, anal, uréthral. La petite sœur ne souffrait pas ; la bonne, non seulement n’avait aucun mal, mais encore riait d’un air gêné. D’autre part, Jean était extrêmement gentil avec elles et affectueux. A. cet âge le garçon rêve de manger, de percuter, de battre et de faire tomber celles qu’il aime. [p. 480]
Gricha, deux ans et demi, mord au sang le doigt de la petite sœur de cinq mois et s’effraie aussitôt de découvrir chez elle une expression de douleur. Il me regarde d’un air inquiet et buté à la fois, prêt à se révolter . Je prends les deux bébés ensemble dans mes bras et dis : « La petite sœur est bien contente d’avoir un frère si fort. » La mimique de Gricha se dilate, mais il ajoute : « Peut-être aussi elle a un peu mal ? » (La petite sœur hurle en effet) et Gricha, tendre grand frère, l’embrasse alors, compatissant, en disant : « C’est rien du tout, ma petite Katinka, c’est fini ». —« Mais oui, on va la consoler », approuvé-je. Et depuis, jamais plus l’enfant n’a mordu ni sa petite sœur, ni quiconque.
Un geste issu d’une bonne intention au point de vue végétatif a été ressenti comme mauvais parce qu’il a fait souffrir la petite sœur à laquelle il s’intéresse (une identification en chemin). Si je m’étais fâchée, ce geste désagréable, mais parti d’une incitation bonne, eût été associé à l’idée qu’il apporte du danger réel : « Je suis méchant ». En fait, l’enfant s’est senti malheureux, mais non « coupable ». Il voulait la manger. Mais alors que Jean s’était contenté de l’imaginer, Gricha avait besoin d’une tentative d’exécution (cf. son expérience du feu). Avoir fait mal à sa sœur lui a fait mal en retour.
« Salope ! » dit Jean (trois ans) à la bonne entrée en service chez nous depuis quelques jours. En effet celle-ci l’aide pour la nième fois à le mettre sur sa chaise, à attacher sa serviette, bref l’empêche d’agir seul dans Ies choses qui le concernent et qu’il exécutait seul avant son arrivée dans la maison. L’incident fait du bruit. J’entends crier Marie et j’arrive. La bonne me raconte ce qui s’est passé. Je demande à Jean : « Sais-tu ce que « salope » veut dire ? » Il n’avait jamais prononcé ce mot et je croyais qu’il ne l’avait jamais entendu. Je sus ensuite qu’il l’avait appris en écoutant cette femme parler. « Non » dit-elle, « elle est assommante, elle ne veut pas me laisser monter seul sur la chaise. Elle veut pas qu’on fasse rien ! » Je lui explique que ce mot veut dire que Marie serait si dégoûtante, si sale qu’il ne voudrait jamais ni la loucher ni la regarder, ni l’aimer. Il dit : « Oh ! mais elle n’est pas comme ça, elle est gentille aussi ». « Salope » dans l’esprit de l’enfant était conçu comme anti-vie, Mari l’empêchait d’exprimer sa vitalité motrice, de s’affirmer, et il était juste au point de vue végétatif oral de sa part, de le dire, il ne voulait. rien avoir de commun avec elle, sa vitalité se sentait mise en échec, en danger. Il la salissait, l’écrasait pour l’annihiler. La bonne venait d’entrer à notre service et agissait de façon castrative par bonne intention. Déjà, elle aimait bien les enfants, elle avait visiblement de la peine et paraissait aussi vexée que, au lieu de frapper ou gronder Jean, je lui pose cette question sur le sens du mot injurieux. Je dis à Jean quelques instants après seul à seul : « Tu demanderas pardon à Marie tout à l’heure si tu veux être un bon garçon »· —« Non jamais ! » répond-il, à ma surprise, d’un air buté. » —« Mais puisque tu vois bien que tu lui as dit quelque chose de très dégoûtant et que ce n’est pas vrai ! » [p. 481]
— « Ça ne fait rien ! Jean me quitte furieux, je n’insiste pas. Il revient 10 minutes après, l’air penaud, s’approche de moi avec un air coupable et me dit entre ses dents comme s’il me lonçait une sottise : « Je lui ai donné son pardon »· Entendant mal je dis : « Quoi, qu’est-ce que tu ·dis ? »—« Je lui ai donné son pardon » me jette-t-il avec une voix sourde el bizarre. —Ah, eh bien voilà un bon garçon ! » —« Ah non ! ne dis pas cela, ce n’est pas bien… » (et les yeux pleins de larmes) : « Mais elle avait de la peine », et sa bouche fait la moue, il se retient de pleurer et va près de la fenêtre cacher qu’il pleure et rêver seul à tout cela. Au ton avec lequel Jean a dit : « Ce n’est pas bien » j’ai senti un accent de vérité. Ill n’y avait pas de vexation, il avait honte d’avoir été obligé de réparer, au nom de sa souffrance d’identification, le mal qu’il avait fait innocemment, en se défendant légitimement.
Expérience de la perte d’un objet aimé. —Jean vers deux ans et demi reçoit son· premier fusil de panoplie, très désiré et dont il est très lier. Il l’emporte au Luxembourg. Au moment d’aller sur un manège, au lieu de le donner à sa grand’mère avec qui il se promène et il le pose à terre. Après le tour de chevaux de bois, il le cherche et ne le retrouve pas ; sa grand’mère est très ennuyée, me raconte l’incident en rentrant à la maison : « Ce n’est pas de ma faute je suis désolée, tu vas être ennuyée, Jean a perdu son fusil ». Je demande : « Est-ce que Jean a été ennuyé ? » —« Pas du tout, figure-toi », dit la grand’mère d’un air répréhensif, « quand je lui ai dit que c’était très bête de l’avoir perdu, il m’a répondu : « Ça ne fait rien il y en aura un qui l’aura trouvé et qui a été content. » —« Eh bien moi », dis-je alors « je ne vois pas pourquoi je serais plus ennuyée que lui ! Jean à raison, sûrement il y a eu un enfant content d’avoir trouvé ce beau fusil, .Jean est tout content « de penser à ce « un » qui a été content. On ne parle plus du fusil. Mais une dizaine de jours après Jean, semblant sortir d’un rêve, dit : « Si je ne l’avais pas mis par terre, mon fusil, je pourrais encore jouer avec… J’aimerais bien encore jouer avec ! » —« Une autre fois, lui dis-je, si tu aimes beaucoup quelque chose tu feras attention à ne pas le perdre. » —« Oui ». Il avait acquis le sens vrai d’une valeur, alors que grondé d’avoir perdu son jouet, sans en éprouver la privation, (grâce à l’identification au trouveur) il aurait eu seulement un sentiment de culpabilité imposé par un adulte, d’un geste sans aucune valeur morale.
Il y avait dans cette expérience vécue : l’apprentissage du sens de la responsabilité, et l’apprentissage de la valeur du bien possédé, le sens du « tien et du mien », que tant d’enfants ont de la difficulté à apprendre. Or, l’acquisition de ce sens naît en même temps que celui de la responsabilité. Avant d’acquérir le sens de sa responsabilité sociale il faut avoir celui de sa responsabilité individuelle par rapport à ses propres besoins. Là encore comme on le voit saisi sur le vif, la liberté pour l’enfant de juger soi-même ses actions dans tous les objets qui n’ont d’intérêt affectif que pour lui est la seule attitude qui lui permette de faire l’expérience de ses relations [p.482] avec les objets. Il faut d’abord désirer un objet, puis l’ayant reçu l’avoir perdu, pour que dans cette épreuve, le jour où on en prend conscience (on voit que pour Jean il a mis une dizaine de jours à l’éprouver) on gagne le sens de sa propre responsabilité indépendamment de tout sentiment de culpabilité.
♦
Cette étude n’a pas d’autre but que de vous faire partager les observations que j’ai pu faire et les remarques qu’elles m’ont suggérées. Il m’a paru important de retrouver les sources du sentiment de culpabilité dans les premières sensations de malaise à vivre. Les conditions physiologiques de la vie chez le petit d’homme ont leurs exigences intrinsèques parfois contradictoires. Ce malaise est inhérent à la condition humaine, quelles que soient les circonstance, extérieures contingentes. Ces épreuves peuvent être libératrices de libido et source de créativité, ou au contraire agglomératrices de libido et freinatrices de puissance créative dans la mesure où le sujet est soutenu ou non dans ces épreuves. L’entourage le plus secourable est celui qui développe au maximum une ambiance de détente, de confiance, de droit à s’exprimer librement, même quand l’expression que l’enfant donne de lui, de sa libido, est une expression de sa souffrance mentale, affective ou physique.
J’ai entendu parler du service hospitalier du Dr Ribadeau¬Dumas. Dans ce service les infirmières consacrent deux fois une demi-heure par jour, indépendamment des soins, à jouer avec les quelques enfants dont elles ont individuellement la charge, à jaser, sourire, à les porter, les câliner, bref à exprimer fa dilatation et la détente dans des relations maternelles agréables et aimables, quelle que soit la réceptivité apparente du petit malade, Or, la mortalité dans ce service est infime par rapport à celle des autres services. L’expérience a montré que si l’on supprime ces moments de plaisir gratuits dans les bras de l’adulte, la mortalité augmente malgré la même qualité de soins. En même temps que l’enfant a besoin de soins et de nourriture matérielle, il a besoin aussi d’aliments et d’échanges affectifs el cela très précocement. Ces échanges affectifs sont basés d’abord sur la permission qui lui est laissée de s’exprimer librement par la voix, la mimique, le geste, et même clans tous ses actes qui ne présentent pas dc dangers graves pour lui ni pour les autres. Ils ne se réduisent pas à cela ; mais ils ne peuvent exister entre des adultes et les enfants sans cette première attitude du respect de la vie et de l’expression que [‘enfant en donne aux stades prégénitaux.
Françoise DOLTO-MARETTE.
Note
(1) Pour celle dernière échelle de valeurs, une étude particulière serait intéressante à faire, car elle tient à la fois des caractéristiques des valeurs ressenties e des valeurs vérifiées.

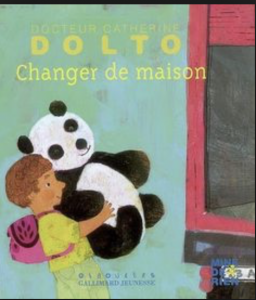
LAISSER UN COMMENTAIRE