 Jacques Damourette & Edouard Pichon. La grammaire en tant que mode d’exploration de l’inconscient. Article paru dans l’Evolution psychiatrique, (Paris), 1925, pp. 237-257.
Jacques Damourette & Edouard Pichon. La grammaire en tant que mode d’exploration de l’inconscient. Article paru dans l’Evolution psychiatrique, (Paris), 1925, pp. 237-257.
Jacques Damourette (1873-1943), linguiste.
Edouard Pichon (1890-1940), médecin, spécialité pédiatrie, et psychanalyste, l’un des 12 fondateurs de la Société psychanalytique de Paris. Il ft le gendre de Pierre Janet.
Ils sont dans l’œuvre de Lacan les auteurs les plus cités explicitement, après Saussure et Jakobson. Leurs travaux furent un ferment essentiel aux construction théorique de Lacan. N’oublions pas, également, que c’est à Pichon que Lacan empruntera le terme de forclusion, qui définit le mécanisme psychique caractéristique de la structure psychotique.
Publications : DAMOURETTE Jacques (1873-1943) & PICHON Edouard (1890-1940). Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française. 1911-1927. Réédition : Paris, Editions J. L. L. d’Artrey, 1968. 7 vol. in-8°, formant 3162 p. Dans la collection des linguistes contemporains.
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Les images on été ajoutées par nos soins. -Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr
[p. 237]
LA GRAMMAIRE
EN TANT QUE MODE D’EXPLORATION
DE L’INCONSCIENT
par J. DAMOURETTE &. ED. PICHON
Il n’y a peut-être pas une voie par laquelle on puisse pénétrer plus avant que par l’étude du langage dans l’analyse de la pensée. Nous espérons communiquer au lecteur notre conviction que cette étude est, en particulier, la voie de choix pour arriver à la connaissance du fonds inconscient commun des membres d’une même collectivité nationale.
Il n’est pas besoin d’être grand clerc pour savoir que, quand on parle couramment, on ne fait pas intervenir le jeu conscient de l’intelligence dans le choix et l’ordonnancement des matériaux linguistiques dont on constitue ses phrases. Que si la culture, et à un degré plus élevé encore l’art littéraire, donne un caractère conscient à certaines parties du mécanisme, ce n’est que secondairement, et la nature essentiellement spontanée du langage n’en est pas foncièrement altérée.
Or, il ne nous paraît pas impossible de faire apparaître à la lumière de la connaissance scientifique les facteurs inconscients ou tout au moins subconscients du langage. Rassemblant patiemment les cas tant oraux qu’écrits dans lesquels figure une tournure ou une forme grammaticales, on pourra arriver à faire la synthèse de la notion inconsciente commandant l’emploi de cette forme ou de cette tournure. C’est [p. 238] cette méthode que, depuis 1911, nous avons appliquée à l’étude de la grammaire française, et il nous semble avoir déjà obtenu dans ce domaine quelques résultats intéressants.
Il va sans dire que des exemples sur lesquels nous nous sommes appuyés nous nous sommes bien gardés d’exclure les tournures réputées incorrectes, ou les phrases spontanément prononcées que l’on prétendait ensuite avoir dites involontairement. Dans le domaine linguistique, comme dans tous les autres, le lapsus est une des voies d’accès à l’inconscient.
Notre méthode, qui remonte du fait linguistique au fait psychique dont il est l’extériorisation, ne doit pas être confondue avec celle qui, descendant de conceptions logiques dogmatiques, prétendrait classer les faits linguistiques d’après ces conceptions. Procéder ainsi serait vouloir aller de l’inconnu au connu.
Le lecteur du présent article devra évidemment nous faire crédit, car, pour lui administrer la preuve réelle que ce quel nous disons ici n’est pas spéculation pure, il faudrait que nous pussions lui mettre sous les yeux tous les matériaux que nous avons rassemblés et toutes les conclusions parcellaires que nous en avons tirées dans les détails : c’est une chose impossible à faire dans un article de revue, et même dans un livre de faible étendue. Au surplus, notre Essai de Grammaire de la Langue française n’aura pas d’autre but que de montrer les fruits que l’on peut tirer de la méthode ci-dessus: indiquée.
Nous nous contenterons donc d’indiquer ici les notions générales auxquelles nos études nous ont permis d’aboutir. Elles ont toutes subi le contrôle rigoureux des faits, et le, caractère de généralité qu’on va leur trouver, et qui pourrait paraître un peu dogmatique, n’est que le résultat final d’une laborieuse synthèse.
Il n’y a pas à douter que la langue ne soit l’instrument par lequel la pensée humaine a pû s’élever au-dessus des idées animales. Certainement le pas a été franchi le jour où aux agglutinats psychiques formés par l’association d’images [p. 239] sensorielles directes, l’une auditive, l’autre visuelle, l’autre tactile, etc., ont été substituées des idées ayant pour substratum une image auditive verbale, c’est-à-dire une image sensorielle ayant une valeur indirecte. Mais ce pas n’a pas été sauté brusquement. Rien n’est plus inadmissible que la croyance à une convention originelle ayant créé le langage de toutes pièces. Il faut donc bien admettre qu’il est sorti par évolution naturelle du cri animal, et que partant les idées se sont constituées en même temps que les mots, idées et mots n’étant que deux aspects pratiques d’une même réalité.
Lors donc qu’on envisage le côté psychique du problème linguistique, il est parfaitement légitime de dire que le langage se compose d’idées.
Le langage laisse voir en lui deux éléments : d’une part, un matériel idées pouvant s’accroître indéfiniment; d’autre part, un certain nombre d’idées directrices servant au classement sommaire des idées-matériaux et à leur mise en œuvre dans le discours. Les idées du premier genre, qui n’ont pas de valeur· spéciale dans la texture du langage, ont reçu de nous le nom de sémièmes ; elles sont du ressort de la lexicographie qui en dresse un inventaire forcément toujours incomplet, puisque s’enrichissant à chaque instant par le fonctionnement mental même des sujets parlants.
Aux idées du second genre, qui servent de charpente au langage, nous donnons le nom de taxièmes. Les taxièmes fonctionnent comme des repères, des occasions de classements ; les notions taxiématiques, perpétuellement présentes dans l’inconscient du sujet parlant, y deviennent comme des questions implicites posées. à propos de tout ce qui s’énonce.
Les éléments du langage se répartissent, en réponse à chacune de ces questions, en autant de classifications partielles, que nous appelons les répartitoires. Chacune de ces questions a une portée plus ou moins générale ; chacune implique un point de vue particulier. C’est pourquoi les répartitoires ont dans le langage une extension plus ou moins grande, et c’est aussi pourquoi ils s’entrecroisent les uns avec les autres de très complexe façon. Débrouiller cet enchevêtrement et y [p. 240] retrouver les idées taxiématiques desquelles il est essentiellement constitué, c’est là le but propre de la grammaire.
Le caractère le plus profond d’un idiome se traduira par son système taxiématique, c’est à dire par le nombre et la nature de ses taxièmes et les connexions répartitorielles qu’ils auront entre eux. Il fallait a priori s’attendre à ce que chaque idiome eût un système taxiématique propre, différent de celui de tous les autres. De fait, les travaux de beaucoup de linguistes et nos études personnelles nous font tenir cette proposition pour surabondamment prouvée. Un parler est donc essentiellement un système de pensée, et un système inconscient pour la plus grande part.
Amener à la lumière les ressorts inconscients d’un système taxiématique, ce sera donc un des moyens les plus efficaces pour pénétrer le fonctionnement de l’inconscient dans une collectivité nationale donnée.
Ceci posé, il est entendu que tout ce que nous avancerons ci-dessous n’est scientifiquement justifié que pour le français, qui nous a servi de matériel d’étude.
Le parler humain est un fait de nature dont les origines se perdent dans la nuit des temps, et il faut concevoir que, du cri de l’homme primitif encore plongé dans l’animalité ancestrale jusqu’aux langues d’aujourd’hui, une évolution insensible et continue s’est poursuivie. Le cri a déjà deux valeurs: subjectivement, il complète en l’activant la passion ressentie par l’animal, mais il a également une valeur extérieure, en ce qu’il agit sur les autres vivants. Aussi loin donc que l’on remonte dans la genèse du langage, il apparaît comme un fait psychique à deux. L’expression part du locuteur, l’impression arrive à l’allocutaire. Ils sont bien les personnes essentielles de la grammaire, la première personne et la seconde personne.
La valeur extérieure, communicative, du cri est toute directe et toute affective: signe extérieur d’une émotion, il est apte à en faire ressentir une à l’auditeur. Le jour où cette valeur extérieure purement affective s’est doublée d’une valeur représentative, c’est-à-dire où elle a été interprétée, fût-ce subconsciemment, par l’allocutaire comme représentant une [p. 241] émotion donnée chez le locuteur, le cri est déjà en voie de devenir langage. Le langage existe tout à fait quand le locuteur destine à l’allocutaire les sons qu’il émet, avec le désir de provoquer une réaction chez celui-ci. Dès, son aube, la langue a donc une valeur extérieure double, représentative, et affective; ces deux valeurs sont, à vrai dire, inséparables.
On peut envisager deux plans dans le développement du langage : sur le plan sans doute le plus ancien, la langue ne connaît que les deux premières personnes ; c’est un subjectif à deux ; le monde extérieur, objectif, n’y figure pas. Rien n’est proprement conçu ni jugé à son endroit, Domaine encore inexploré, il n’a de rôle qu’indirect, en ce qu’il peut être la cause des réactions émotives des deux personnes. Ces réactions émotives seules, sont la matière réelle du langage ; les deux personnes ne se font sentir l’une à l’autre que des nuances plus ou moins grossières de leur état affectif. Pareil langage est construit sur le plan locutoire.
Quand la notion du monde extérieur arrive à s’introduire, dans le psychisme du locuteur, naît la troisième personne, celle dont on parle, le délocuté. Le locuteur arrive à se situer lui-même, ainsi que l’allocutaire, dans ce monde dont il parle. Les trois personnes, locutive, allocutive, délocutive, ne sont plus que des choses dont le discours raconte l’histoire. A leur sujet, le locuteur émet désormais des jugements. Pareil langage est construit sur le plan délocutoire.
Or, si évoluées que soient nos langues, et le français particulièrement, on y retrouve encore actuellement des éléments appartenant au plan loculoire : telles les interjections, les impératifs, les vocatifs et exclamatifs, qui marquent tous, de façon locutoire, l’appréhension de faits nouveaux.,
A ce répartitoire très général du langage en plan locutoire et plan délocutoire, nous donnons le nom de personnaison, parce que c’est lui qui commande la conception des personnes. Dans le plan locutoire, l’allocutaire seul apparaît pour recevoir communication de l’impression du locuteur; dans le délocutoire, le répartitoire de personne est constitué avec ses trois éléments, la première la seconde et la troisième [p. 242] personnes, qui en réalité sont sur ce plan présentées toutes trois comme des personnes dont on parle.
L’existence du répartitoire de personnaison nous montre déjà quelle grande part l’affectivité conserve dans le langage, puisque des deux cases de ce répartitoire, une entière, la case locutaire, n’admet d’éléments qu’affectifs. Encore le domaine de l’affectivité ne se borne-t-il pas au locutoire, le délocutoire lui-même contenant des éléments affectifs importants, telle subjonctif, qui apparaît dans bien des cas comme la projection de l’impératif sur le plan délocutoire (cf. il dit que tu viennes).
Après étude analytique des faits linguistiques français actuels, on est amené à classer les mots suivant les deux répartitoires auxquels nous avons donné les noms de catégories et de classes.
Les catégories marquent surtout l’opposition des phénomènes aux substances. Les mots essentiellement destinés à marquer les phénomènes sont les factifs, ceux essentiellement destinés à marquer les substances sont les substantifs. Ce répartitoire est complété par deux cases accessoires : celles des adjectifs et des affonctifs, dont on peut respectivement dire grosso modo qu’ils marquent qui des qualités, qui des modalités.
Le répartitoire de classe se ramène plus malaisément aux banales notions de la logique scolaire. Dans ce répartitoire, trois cases : les struments, qui n’expriment que des taxièmes ; les verbes, mots qui expriment des sémièmes, mais qui jouent néanmoins dans la phrase un rôle constructif ; les noms, mots qui n’expriment que des sémièmes et n’ont pas de rôle constructif.
Ces deux répartitoires se croisent, ce qui crée douze essences linguistiques où viennent se ranger les différentes « parties du discours » des grammaires usuelles : le substantif nominal (nom ou substantif des grammaires usuelles) ; l‘adjectif nominal (adjectif qualificatif) ; l’affonctif nominal (adverbe pro parte) ; le factif nominal (interjection) ; le substantif verbal (infinitif) ; l’adjectif verbal (participe) ; l’affonctif verbal (gérondif) ; le factif verbal (modes personnels [p. 243] du verbe) ; le substantif strumental (pronom) ; l’adjectif strumental (article, adjectif pronominal) ; l’affonctif strumental (adverbe pro parte, préposition, conjonction) ; et le factif strumental (adverbe pro parte).
D’ailleurs, il est particulièrement intéressant de remarquer que chacune de ces subdivisions répartitorielles définit non seulement, une essence organique, mais encore une valence fonctionnelle. En effet, grâce à des mécanismes variés, un terme soit seul soit accompagné d’un cortège de compléments, peut arriver à assumer dans la phrase un rôle normalement dévolu à une essence linguistique différente de la sienne. Un tel terme ou groupe de termes s’appelle un équivalent. On conçoit que l’équivalence complique étrangement la structure du langage, mais aussi qu’elle augmente singulièrement les ressources d’expression linguistique.
Tout un jeu de répartitoires variés vient régner sur ces subdivisions logiques. De ces répartitoires, l’extension est plus ou moins grande, les cases sont plus ou moins nombreuses. Il nous est impossible de songer à dresser, ici, même le simple catalogue raisonné de ce système taxiématique plantureux et fin ; mais le lecteur en sait maintenant assez sur notre méthode pour en examiner avec fruit un échantillon. D’ailleurs, même sur ce terrain restreint, notre documentation en exemples sera, bien entendu, infiniment moins abondante que celle qui a servi, en réalité, de base à nos travaux, et que le lecteur pourra retrouver dans notre Essai.
C’est la dissociation de la notion de temps dans le verbe que nous présentons ici comme échantillon de notre méthode.
Le Verbe se compose d’éléments appelés communément « temps de verbe » : tels l’indicatif présent, le subjonctif imparfait, l’infinitif passé, etc. Nous donnons à ces éléments appelés ordinairement temps de verbe le nom de tiroirs verbaux.
La notion de temps à laquelle nous nous attaquerons ici n’est pas celle-là, c’est celle que les grammairiens opposent à celle de « mode » ; en somme, ce dont nous reprenons l’étude, c’est le répartitoire que l’on prétend constituer avec présent- [p. 244] imparfait-passé défini-passé indéfini-passé antérieur-plus-que parfait-futur-conditionnel. » Ce pseudo-répartitoire est une conception gratuite ; 1’examen des faits permet de penser que les notions inconscientes qui guident l’emploi des tiroirs verbaux dans le domaine dit du « temps » sont en réalité beaucoup plus fines.’
Hors certains cas exprimant des nuances subtiles, les propositions complétives subordonnées à un tiroir verbal exprimant le passé veulent des imparfaits : c’est à-dire l’imparfait au lieu du présent ; le plus-que-parfait au lieu du passé composé ; le conditionnel au lieu du futur ; le conditionnel passé au lieu du futur antérieur:
1° Je suppose que tu apprends l’anglais ; je supposai que tu apprenais l’anglais, ex. :
D’abord, j’estime qu’on n’improvise pas une pareille affaire.
(Jules Romains. Les Copains, l, p. 38)
Je me mariai chez moi : je fus cocu ; et je vis que c’était l’état le plus doux de la vie.
(Voltaire. Histoire des voyages de Scarmentado)
2° Je suppose que tu as appris l’anglais ; je supposai que tu avais appris l’anglais, ex. :
On dit qu’on a vu même, en ce désordre affreux,
Un dieu qui d’aiguillons pressoit leur flanc poudreux.
(Racine. Phèdre. V, 6).
Mais hier, quand elle sceut qu’on avoit pris journée
Et qu’enfin la bataille alloit estre donnée, …
(Corneille. Horace. 1. 1.)
3° Je suppose que tu apprendras l’anglais ; je supposai que tu apprendrais l’anglais, ex. :
J’espère, messieurs, que vous nous ferez l’honneur de diner avec nous.
(Labiche. Un chapeau de paille d’Italie. III. 9)
Le vieil homme prophétisa qu’il atteindrait la plus éminente spiritualité.
(Maurice Barrès. Une enquête aux Pays du Levant, in la
Revue des Deux Mondes du 1er Octobre 1923, p. 526).
– Tant que je verrai mes poules picorer et que j’entendrai mon· coq chanter, c’est que tout ira bien.
(Lucie Delarue-Mardrus. A la Dérive, in Le Journal, 1er Février 1924, P.2, col. 4.) [p. 245]
Mais vous nous avez répété tous les jour que tant que vous verriez vos poules picorer et tant que vous entendriez votre coq chanter, tout irait bien. Eh bien ! elles picorent, vos poules, et, votre coq, je crois qu’il chante assez fort. Alors ?
(Id. – Ibid. col. 5)
Le commandant va venir par le boyau M. Il a dit qu’il serait chez vous dans cinq minutes
(Capitaine Z. L’Armée de la guerre. p. 201)
4° Je suppose qu’à mon retour, tu auras appris l’anglais ; je supposai qu’à mon retour, tu aurais appris l’anglais, ex. :
Mais moi qui ne suis pas du monde, j’imagine
Qu’elle aura trop aimé quelque indiscret amant.
(Alfred de Musset. Namouna. I. 4.)
Il fut convenu avec la servante que personne n’aurait vu Valentin, et qu’on l’aurait laissé passer par mégarde.
(Id. Les Deux Maîtresses. V.)
Or, déjà dans ce tour, on remarque que l’emploi d’un imparfait au lieu d’un non-imparfait ne modifie en rien le rapport de temps entre la proposition principale et la proposition subordonnée, et que, d’autre part, l’emploi de l’imparfait n’implique en aucune· façon que le fait qu’il exprime appartienne au passé. Dans le second exemple de Madame Delarue-Mardrus, le père Lourdier voit précisément des poules picorer et entend son coq chanter au moment exprimé par les imparfaits. Le présent du contexte ultérieur l’indique à l’évidence. Dans l’exemple de M. le capitaine Z, le « va venir » du contexte antérieur indique que le fait exprimé par l’imparfait serait est encore dans l’avenir.
Dans la série d’exemples qui nous occupe, l’imparfait sert donc simplement à faire sortir le verbe subordonné de mon temps à moi, locuteur présentement parlant, pour le placer dans le temps dont le présent est représenté par le verbe de la principale et qui est centré par rapport au sujet de cette principale, ou pour parler de façon plus concise, à substituer à ma notion de temps celle du sujet de la principale au moment du fait qu’exprime celle-ci.
Les emplois des imparfaits en dehors de la complétive vont nous permettre de confirmer et de compléter la notion acquise. [p. 246]
L’imparfait en principale exprime le présent dans le passé, mais ceci se relie à l’emploi ci-dessus indiqué par ce que le locuteur doit imaginer mi temps différent du sien propre pour pouvoir considérer comme actuelle fait mis à l’imparfait. Exemples :
Le bouc était déjà parti pour le Bourg d’Oisans sur les épaules colossales du grand Bormand.. et serait détaillé demain sur l’étal du boucher.
(Henry Bordeaux. La Combe du Loup, dans la Revue des Deux Mondes du 15 Septembre 1923, p. 270)
Dans cet exemple, M. Henry Bordeaux se reporte dans une actualité ayant pour présent le moment des faits suivants : « Le bouc est parti pour le Bourg; il sera détaillé demain. » Dans l’exemple suivant, le transfert dans une actualité autre que celle du présent authentique est plus frappant encore, puisqu’on voit l’affonctif aujourd’hui, qui indique les présents, accolé à l’imparfait :
Ce labeur compliqué s’ajoutait aux autres soins déjà dévolus aux modestes « canevas de tir » du début. L’appellation « groupe de canevas de tir » s’appliquait aujourd’hui à de grands établissements composés de bureaux, d’ateliers, de laboratoires …
(Arthur Lévy. Le Service géographique de l’Armée pendant la Guerre, in Revue des Deux Mondes, 15 Septembre1923. p. 437)
Tous les emplois du présent sont, dans ces conditions nouvelles, ouverts à l’imparfait. Le présent narratif lui-même peut êt.re remplacé par l’imparfait, ex. :
Les Napolitains furent arrêtés dans leur marche, et les Anglais repoussés du sol de l’Italie, au moment même où ils allaient entrer à Livourne. Deux jours plus tard, ils débarquaient 12 mille hommes.
(Thiers. Histoire du Consulat. Livre VLI. p. 213)
Du fait que l’imparfait place les phénomènes dans une actualité autre que celle du présent, il sert à marquer les époques désormais révolues, ex. :
LÉNORE. – Il y a les deux camarades que nous étions ; il me semble qu’ils nous regardent…
DULAURIER. – Non, Lénore, ils s’effacent peu à peu… Car tu dis toi-même: les deux camarades que nous étions.
(Tristan Bernard. Les petites curieuses. Acte III, Théâtre, Tome III, p. 137) [p. 247]
Aussi est-il d’usage d’employer l’imparfait pour parler du caractère ou des habitudes des morts. C’est ce qui rend l’emploi de cette forme grammaticale particulièrement tragique dans des lettres écrites du front comme les suivantes :
Ma chérie, c’est fini, je t’aime, et pour toujours, jusque dans l’éternité. Ma Rietta, adieu. Ton Génot qui t’adorait.
(Eugène Deshayes. Lettre écrite en Août 1914, publiée par le Temps du 21 Août 1920, p. 3, col. 4)
Si j’y reste pensez quelquefois à moi car sous des dehors froids je vous aimais bien et recevez de bons baisers du fond du cœur.
(Lettre de Monsieur M.I. à Madame E. D., le 10 Octobre 1914)
L’imparfait est le tiroir naturel du style indirect. Cet emploi se rattache d’une part à l’emploi en complétive parce que souvent l’imparfait de la complétive succède à un tiroir passé d’un verbe signifiant dire, affirmer, etc., ex. :
Puis se prenant à sourire, il ajouta qu’on savait bien qu’il pouvait envoyer les gens où il lui plaisait ; mais que ce n’était pas la peine d’user de ce pouvoir, quand d’un mot on pouvait également ce qu’on vouloit, et que, quand on ne l’avoit pas, ce n’étoit que faute de le dire.
(Saint-Simon. Mémoires. Tome III, chap. IV, p. 38)
Mais l’imparfait du style indirect peut, d’une manière plus générale, être conçu comme se rattachant à l’imparfait indicateur d’une actualité non présente, car, dans le style indirect, le locuteur choisit pour présent celui du discours même qu’il rapporte. Parmi les innombrables exemples qu’on en pourrait donner, citons :
Elle allégua pourtant les délices du bain,
La curiosité, le plaisir du voyage,
Cent raretés à voir le long du marécage:
Un jour il conterait à ses petits enfans
Les beautés de ces lieux, les mœurs des habitans,
Et le gouvernement de la chose publique
(La Fontaine. Fables. IV. II. La Grenouille et le Rat)
– N’est-ce pas, mam’selle, v’s êtes de Paris ? Non : elle était de l’Anjou; elle avait été élevée dans cette sage et maligne province.
(R. Benjamin. Gaspard. p. 178)
Elle dit son âge, vingt-trois ans, fournit des références. Elle savait parfaitement la sténographie et la dactylographie ; elle lisait l’anglais. Pui elle pourrait venir le malin.
(Fréderic Boutet. Le désir de M. Laubépin, in Le Journal du 17 Mars 1923, p. 2, col. 4) [p. 248]
Tant pis ! tant pis ! Sa mère sortirait. Et après ? Elle rentrerait, bien sûr !… Elle rentrerait, à sept heures, bourgeoisement.
(F. de Miomandre. Ecrit sur de l’eau, Ami de jeune fille, p. 89).
L’imparfait a le même caractère de durée que le présent lui-même. C’est pourquoi les autres tiroirs viendront brocher sur lui comme sur un fond, exemple :
Un soir, t’en souvient-il ? nous voguions en silence,
On n’entendait au loin, sur l’onde et sous les cieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
Tes flots harmonieux.
Tout à coup des accents inconnus à la terre
Du rivage charmé frappèrent les échos…
(Lamartine. Premières Méditations poétiques. XIV. Le Lac)
Au lieu de venir brocher sur le fond continu marqué par l’imparfait, le fait nouveau peut mettre fin à cette situation chronique, ex. :
Federigo voulut reprendre l’offensive. Tous les siens s’y opposaient ;
Lorsqu’un soldat, qui avait traversé les lignes, parut et le supplia d’intervenir.
(R. de la Sizeranne. Le vertueux Condottière, dans la Revue des Deux Mondes du 1er Décembre 1923, p. 568)
Oui, l’aigle un jour planait aux voûtes éternelles,
Lorsqu’un grand coup de vent lui cassa les deux ailes.
(V. Hugo. Les Chants du Crépuscule. V. Napoléon II – IV. p. 260)
Les serviteurs veillaient dans une antique salle
Attendant l’heure du coucher,
Leurs groupes se taisaient, quand soudain sur la dalle
Retentit le pas d’un archer.
(Ch. Scapri. Page, Ecuyer, Capitaine).
Le phénomène même que marquait l’imparfait peut rester en suspens :
On y amenait [à Mantoue] le jeune Federigo, lorsque, brusquement, son père s’étant brouillé avec le nouveau pape Eugène IV, la République sérénissime s’entremit entre les deux pour amener une réconciliation. Il y eut un échange d’otages pour assurer la bonne foi des parties pendant les négociations : l’enfant fut compris dans cette combinaison bizarre, et, au lieu d’aller à Mantoue, le voilà en route pour Venise.
(R. de la Sizeranne. Loc. cit., p. 559)
Au point extrême de cette évolution, avec des verbes ayant [p. 249] un sens suffisamment instantané, l’imparfait ne marque plus qu’un fait fictif, que la survenance trop précoce du fait intercurrent a en réalité empêché de se produire : « Je lançais déjà la balle quand Juliette m’arrêta le bras ».
Il n’y a qu’une différence sémantique minime entre ce dernier tour et celui où l’imparfait apparaît comme sensiblement équivalent à un conditionnel passé : « Si tu ne m’avais pas retenu je me cassais la jambe », c’est-à-dire approximativement : « je me serais cassé la jambe », ex. :
En même temps, elle avança vivement la tête. Une seconde de plus, sa bouche-anus s’appliquait sur la poitrine de Gilliatt. Gilliatt, saigné au flanc, et les deux bras garottés, était mort.
(V. Hugo. Les travailleurs de la Mer. Ill, IV, 3. Tome Ill, p. 103.)
…Quand je pense que si nous ·avions retardé de quatre jours notre mariage, on m’arrêtait seul et je partais tout seul, je ne puis me pardonner.
Vigny, Servitude et grandeur militaires, Livre l, ch. v. p. 63.)
Si j’avais eu deux points de plus, j’entrais à l’école de Lyon et j’étais médecin militaire à l’heure actuelle.
(Ex. oral recueilli dans la bouche de M. M. L. le 13 novembre 1923.)
Dans ce dernier exemple, le second imparfait équivaut même à un conditionnel présent, comme le marquent les mots : à l’heure actuelle.
Les emplois du plus-que-parfait, ainsi que certains emplois du conditionnel et du conditionnel passé, sont calqués sur ceux de l’imparfait simple.
L’emploi propre du conditionnel ou du conditionnel passé pour marquer un fait conditionné rentre lui-même aussi dans la notion d’imparfait, puisque le fait soumis à une condition n’appartient pas à la conjoncture présente. C’est le conditionnel, imparfait du futur, qui est appelé à cet emploi, probablement parce que le fait soumis à une condition est conçu comme toujours futur à la réalisation de cette condition, elle-même marquée par l’imparfait :
S’il n’y avait qu’une sorte d’académicien et qu’une sorte de bienheureux, l’Académie et le Paradis seraient monotones.
(Anatole France. La Vie Littéraire. 2e Série, p. 103.) [p. 250]
Jamais il n’aurait osé lui avouer un sentiment qu’il jugeait presque ridicule, si elle ne lui avait pas dit un soir, en sortant d’un bal…
(Gérard d’Houville. Le Séducteur. I, p. II.)
L’ensemble des tiroirs verbaux imparfaits a donc une réelle unité sémantique. Il s’oppose à l’ensemble des tiroirs non-imparfaits. Ainsi est défini un premier répartitoire, où la notion de temps n’a pas en réalité de rôle taxiématique : le répartitoire d’actualité, avec deux cases : d’une part, le noncal (non-imparfait), qui convient au fait réel, vu dans une actualité centrée autour du temps présent du sujet parlant ; d’autre part, le toncal (imparfait), convenant au fait exclu de l’actualité noncale parce que centré autour d’autre chose que du locuteur présentement parlant, exemples :
Il songeait : – Si je pouvais tuer tous ceux qu’elle a aimés.
(Anatole France. Thaïs, p. 340.)
Et il voyait en une minute tout un avenir se dérouler. Ils demeuraient quai Voltaire, et souvent le matin, elle sortait avec lui, allant au Louvre des femmes. Il la conduisait jusque sous les arcades. Elle le reprenait pour aller déjeûner. D’autres jours, elle entrait à quatre heures dans son bureau…
(Remy de Gourmont. Un Cœur virginal, p. 50.)
Ecoute, je rêvais
Que nous étions très vieux, les mains ratatinées …
Oh ! c’était dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d’années.
(André Rivoire. Il était une fois. Scène II)
L’endroit est convenable pour y promener ses grands-parents quand ils étaient tout petits.
(Lucien Daudet. Calendrier, Le Jardin d’Acclimatation, p. 48.)
Si l’on envisage maintenant la proposition subordonnée temporelle, il est facile de s’apercevoir que tous les tiroirs n’y sont pas non plus également recevables. Le passé simple ne s’y rencontre généralement pas. Si la principale a un présent, l’antériorité de la subordonnée est marquée par un passé composé, exemple :
Lorsque les plaisirs nous ont épuisés, nous croyons avoir épuisé les plaisirs.
(Vauvenargues. Réflexions et Maximes. CXCV.)
D’une façon générale, les propositions subordonnées temporelles destinées à marquer un fait antérieur au fait exprimé [p. 251] par la principale nous montrent toujours des tiroirs relatifs antérieurs, c’est-à-dire le passé composé pour marquer l’antériorité par rapport au présent ; le plus-que-parfait pour la marquer par rapport à l’imparfait ; le passé antérieur pour la marquer par rapport au passé simple ; le passé surcomposé pour la marquer par rapport au passé composé ; le futur antérieur pour la marquer par rapport au futur, et le conditionnel passé pour la marquer par rapport au conditionnel :
1° Chaque jour, quand j’ai déjeuné, je sors, ex. :
Dès qu’il a bu un verre de trop, il est bon à tuer.
(Jules Romains. Les Copains. l, p. 19.)
2° Chaque jour quand j’avais déjeuné, je sortais, ex. :
Le principal divertissement était le retour des barques. Dès qu’elles avaient dépassé les balises, elles commençaient à louvoyer.
(G. Flaubert. Un cœur simple. II, p. 27).
3° Quand j’eus déjeuné, je sortis, ex. :
Elle est triste, cette Civita-Vecchia où il [Stendhal] fut envoyé, quand Metternich lui eut refusé de l’envoyer à Trieste.
(Paul Hazard. Notes sur l’Italie nouvelle, dans la Revue des Deux Mondes du 1er décembre 1922,p. 593).
4° Quand j’ai eu déjeuné, je suis sorti, ex. :
Et quand j’ai eu appuyé mon fusil à quelque chêne, et contemplé ces talus rongés de primevères, et entendu ces oiseaux, et touché cette mousse, et aspiré ce jeune parfum des eaux courantes, j’ai ressenti pour la première fois que le printemps renaissait partout.
(Fr. Jammes. – Feuilles dans le Vent, p. 213).
Emile de Girardin mon ami, m’a présenté à Coste, et, après qu’il a eu lu mes articles de journaux et mon livre, il a paru attacher beaucoup d’importance à m’avoir.
(Lettre de Balzac à madame Carraud, 28 septembre 1830, dans la Revue des deux Mondes du 15 décembre 1922, p. 818).
5° Quand j’aurai déjeuné, je sortirai, ex. :
Quand ce moment sera venu, Madame, nous aviserons.
(Courteline. Le Commissaire est bon enfant, Sc. III.)
Cette lettre te sera remise demain matin par Annette Sauvet, à qui je la donnerai tout à l’heure. La brave créature t’amène ma petite Micheline. Ma dépêche t’aura prévenue.
(Paul Bourget, Gérard d’Houville, Henri Duvernois, Pierre Benoît, Le Roman des Quatre. I. Dans Les Annales du 10 décembre 1922, p. 637). [p. 252]
6° Je décidai que, quand j’aurais déjeuné, je sortirais, ex. :
D’après ce système, on devait abolir tous les diocèses existants. Pour cela on s’adresserait aux titulaires anciens qui vivaient encore, et le Pape leur demanderait leur démission. S’ils refusaient, il prononcerait leur déposition : et quand on aurait ainsi fait table rase, alors on tracerait sur la carte de France soixante nouveaux diocèses.
(Thiers. Histoire du Consulat. Livre XII, p. 338, col. 2.)
Une nouvelle notion est apparue ici, celle de l’antériorité d’un fait par rapport à un autre. Il y a donc à distinguer un nouveau groupe de tiroirs : les tiroirs antérieurs, et ce nouveau taxième, différent du taxième d’actualité, se combine avec lui, puisque des tiroirs comme le plus-que-parfait et le conditionnel passé, que nous avons déjà vus classés parmi les toncaux se rangent aussi parmi les tiroirs antérieurs.
Les faits grammaticaux permettent d’ailleurs de s’apercevoir qu’il existe aussi en français des tiroirs marquant la postériorité. C’est ainsi que, lorsque la principale est au présent, la subordonnée temporelle qui marque un fait ultérieur à celui de la principale contient un tiroir du type « je vais faire », le futur étant irrecevable dans cet emploi : « Lorsqu’un enfant va rire, son regard s’illumine d’abord ».
Il semble donc qu’il faille accepter J’hypothèse d’un répartitoire de temporaineté distinguant d’une part des tiroirs qui ne sont pas indiqués comme asynchrones au contexte, d’autre part des tiroirs antérieurs et des tiroirs postérieurs.
Ce point acquis, il reste à voir si les emplois des tiroirs antérieurs et postérieurs en dehors des subordonnées temporelles sont susceptibles de rentrer dans la notion taxiématique que l’étude de ces subordonnées a permis d’entrevoir. Or, ils y rentrent en effet. .
Le présent postérieur (je vais faire), par opposition au futur, marque le fait à venir, en tant qu’il est vu du moment présent, dont il apparaît en quelque sorte comme l’immédiat développement, ex. :
Eh bien ! elle va passer ici, d’un moment à l’autre.
(Jules Romains. M. Le Trouhadec saisi par la Débauche. I, I,p. 13) [p. 253]
De même, le présent antérieur (passé composé), en opposition avec le passé simple, marque le fait passé, en tant qu’il est vu du moment présent ; et c’est cette notion méthodiquement extraite des faits de langage qui donne la véritable clef de la différence entre les emplois du passé composé et du passé simple.
Les emplois appartenant au domaine du parfait, grec, c’est-à-dire ceux dans lesquels le fait passé est présenté comme une chose terminée actuellement en pleine force de production de conséquences et peut n’être précisé par aucun adverbe de temps, ressortissent en propre au passé composé, à l’exclusion du passé simple ; ex. :
Mais, dites-moi, la belle hôtesse,
De lui vous aviez trois enfants;
Vous en avez six à présent.
– J’ai tant reçu de ses nouvelles
Qu’il était mort et enterré,
Que je me suis, remariée.
(Chanson populaire.)
Dans les emplois appartenant au domaine de l’aoriste grec, c’est à dire les emplois purement narratifs, on trouve en français soit le passé simple, soit le passé composé, mais ici encore, l’étude des faits montre que l’emploi du présent antérieur se rattache à la notion de relativité temporelle que nous supposons en être le fondement inconscient. En effet, par le passé simple, le locuteur raconte l’histoire de la personne délocutée (délocutive, allocutive, ou même locutive) en l’abandonnant dans l’abîme du passé, tandis qu’avec le présent antérieur, le, locuteur conserve dans le présent la personne délocutée, encore que racontant les événements qui l’ont atteinte dans le passé.
L’ensemble des tiroirs verbaux antérieurs d’une part, celui des tiroirs verbaux postérieurs d’autre part, ont donc une réelle unité sémantique. Ils s’opposent à l’ensemble des tiroirs non relatifs. Ainsi est défini un second répartitoire, où la notion de temps n’a de rôle taxiématique qu’en tant qu’elle permet d’exprimer une relation d’asynchronisme : antériorité ou postériorité entre deux faits. Nous l’appelons répartitoire de temporaineté. Ce répartitoire comporte trois cases : [p. 254] l’ex-temporané, qui convient aux faits vus sans relation temporelle, ou en simultanéité avec un fait repère, et les deux distemporanés, respectivement l’antérieur et le postérieur, qui conviennent aux faits présentés comme asynchrones, de l’une de ces deux façons, au fait repère.
Il est d’ail1eurs intéressant de remarquer de, quelle façon radicalement différente le génie linguistique français conçoit la liaison au présent selon qu’il s’agit du passé ou de l’avenir ; pour le passé, cette liaison est exprimée statiquement, par une possession (j’ai fait), tandis que pour l’avenir elle l’est dynamiquement, par une progression (je vais faire). Il est à peine besoin de souligner l’intérêt psychologique de cette constatation.
Le terrain une fois déblayé de la question noncal-toncal et de la question extemporané-distemporané, il reste encore en français, dans le domaine dont nous avons défini les limites et que nous étudions ici, une distinction grammaticale non réduite : celle du présent au passé simple et au futur.
Comme nous l’avons dit ci-dessus, par le passé simple ou antif, le locuteur plonge résolûment la personne délocutée dans le passé et ne raconte les faits de l’histoire de cette personne que comme des événements périmés que le génie inconscient du langage n’envisage pas, du moins au moment du discours, comme susceptibles d’avoir des conséquences encore vivantes.
C’est en effet en concevant de cette façon le taxième de l’antif que l’on peut éclairer la différence que les faits de langue marquent d’une part entre le présent antérieur et lui, d’autre part entre le toncal et lui. Soit l’exemple suivant :
En deux dépêches au cardinal Doria, Consalvi a dépeint ses anxiétés. Rentré à l’hôtel de Rome, il lut, à tête reposée, la nouvelle rédaction qu’il n’avait fait que parcourir dans l’après-midi. ,
(Pierre de la Gorce. Le Concordat de 1801, dans la Revue des Deux Mondes du 1er novembre 1923, p. 605)
Dans cet exemple, on aperçoit très nettement que le présent antérieur a dépeint désigne un fait encore susceptible de conséquences, puisque la dépêche où Consalvi a fait cette peinture nous reste; tandis que l’antif tut désigne un fait à [p. 255] jamais noyé dans le passé. Voilà le motif réel pour lequel M. de la Gorce a pu très élégamment, dans la suite du même récit, passer d’un tiroir à l’antre.
Considérons maintenant l’exemple ci-dessous :
Et Fra Minovit que, s’étant levé, elles cueillirent des roses à pleines mains, et s’avancèrent vers lui.
(A. France, Le Puits de Sainte-Claire. Saint Satyre, p. 19)
La différence de sens entre l’emploi de l’antif cueillirent et l’éventuel emploi du toncal cueillaient après le même antif vit est nette. Par le toncal, cueillaient, on marquetait que, dans le passé, les femmes sont en train de cueillir des roses, et que, pendant la durée de cet acte, le frère Mino les voit ; la vision serait conçue comme brochant sur la cueillette. Par l’antif cueillirent, au contraire, l’acte de cueillir est conçu sans durée, comme étant un des éléments du spectacle vu par le frère Mino, et, comme ce spectacle entier, cette cueillette est noyée dans un passé périmé.
En ce qui concerne l’avenir, la répartition sémantique est la même.
Par le futur, le génie linguistique inconscient du locuteur enfouit le délocuté dans les brumes de l’avenir, sans présenter cet avenir comme procédant du présent par génération continue.
Le répartitoire d’époque comporte donc trois cases, le mansif (présent), l’antif et le futur, à quoi répondent grossièrement les notions conscientes de présent, de passé et d’avenir.
En somme, les taxièmes qui, dans la conjugaison verbale, sont communément confondus dans le domaine dit de temps, doivent être rangés en trois répartitoires : l’époque, la temporaineté et l’actualité. Dans chacun de ces répartitoires, l’une des cases est proprement indifférenciée, c’est à dire convient à ce que l’on n’a aucune raison spéciale de mettre dans les autres cases du répartitoire. Tout ce qui n’est pas toncal est noncal ; tout ce qui n’est pas envisagé du point de vue de la relation temporelle est extemporané ; tout ce qui n’est ni antif ni futur est mansif. C’est pourquoi l’indifférencié universel (présent de l’indicatif ou mansif noncal [p. 256] extemporané de l’indicatif) correspond à tous les emplois· généraux dans lesquels aucun des taxièmes spéciaux aux répartitoires envisagés ne joue.
L’indépendance mentale de ces trois répartitoires est prouvée par leurs riches possibilités de combinaisons: par exemple j’aurais aimé est un futur toncal antérieur.
De même, j’eus aimé est un antif antérieur, ex. :
Le baron parut bientôt, suivi de Julien ; dès qu’il eut pénétré dans la pièce enténébrée, il sonna, criant: « Vite, vite, de la lumière ! il fait triste ici. »
(Maupassant, Une vie, VI, p. 110)
Cette indépendance grammaticale des trois répartitoires de temps prouve que l’inconscient ou tout au moins cette partie de l’inconscient que la grammaire nous révèle et qui est proprement le génie de la langue française, n’opère pas la synthèse des idées claires, mais simples, de présent, de passé et d’avenir. Ces idées, le conscient ·les possède pourtant depuis assez longtemps pour que nous les voyions appartenir au plus ancien fonds philosophique. Elles se transmettent de peuple à peuple. Mais elles sont trop, privées de couleur affective pour pouvoir vivre dans l’inconscient. Si l’on compare après étude leurs domaines respectifs avec ceux des taxièmes répartitoriels de temps, on voit qu’elles empiètent sur les trois répartitoires, mais qu’aucun pourtant ne les présente sans une addition affective.
Le temps n’est pas la seule notion logique que la grammaire nous révèle très différente dans l’inconscient de ce qu’elle est dans le conscient. Beaucoup d’autres mécanismes mentaux, même parmi ceux qui jouent dans la logique classique un rôle capital, sont en réalité, sous la forme où cette logique les connaît, étrangers au fonctionnement intime de l’esprit. C’est ainsi que la notion robuste, mais peu souple, de négation, telle que nous la montre la logique formelle, est en réalité étrangère à la langue française. Plus retors, nous ne pouvons réaliser la négation pleine que par le concours de deux notions plus fines, que marquent les deux morceaux de notre ne… pas.
En somme, si par d’autres méthodes on peut espérer [p. 257] connaître ce qu’il y à d’individuel dans l’inconscient, la grammaire, seule, paraît pouvoir nous éclairer sur cet inconscient national collectif qui s’appelle le génie d’un peuple. Et même peut-être, comme en réalité il n’y a pas deux personnes dont le parler soit rigoureusement identique, peut-on espérer que le jour où sera suffisamment avancé ce qu’on pourrait appeler la grammaire nationale moyenne, les particularités spéciales observées chez tel ou tel individu pourront contribuer à éclairer son inconscient individuel. De sorte que les écrivains arriveraient à nous livrer, par leur style même, l’histoire de leur âme.

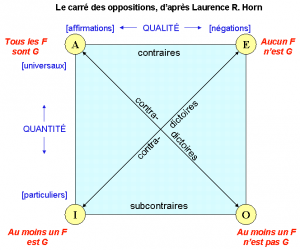
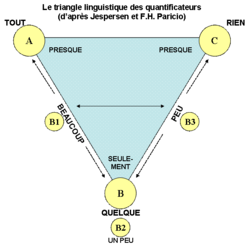

. Pichon et J. Damourette, La grammaire en tant que mode d exploration de l inconscient , dans Le d veloppement psychique de l enfant et de l adolescent, volution normale pathologique traitement. Manuel d tude