 Germaine Guex. La psychanalyse et le problème de l’autonomie morale. Extrait de la « Revue de théologie et de philosophie », 7, 1939, p. 95-113.
Germaine Guex. La psychanalyse et le problème de l’autonomie morale. Extrait de la « Revue de théologie et de philosophie », 7, 1939, p. 95-113.
Germaine Guex (1904-1984). Psychologue et psychanalyste didacticienne, ‘assistante de Jean Piaget au laboratoire de psychologie. Compagne du psychiatre et psychanalyste suisse, Charles Odier, ils mirent en évidence le syndrome d’abandon. Avec Winnicott elle a su repérer les éléments de la dépression anaclitique, sans en avoir défini la terminologie. Quelques publications :
— (avec L. Bovet, Madeleine Rambert et G. Richard). Parents et enfants. Causeries données à Lausanne durant l’hiver 1942-43, Éditions du Groupe Esprit, 1943.
— Agressivité réactionnelle dans l’angoisse d’abandon. Extrait de la Revue française de psychanalyse, tome 12, n° 2, avril-juin 1948, p. 251-261.
— Le névrose d’abandon, Paris, PUF, 1950. — Réédition en 1973 aux PUF, sous le titre : Le syndrome d’abandon.
[p. 95]
LA PSYCHANALYSE
ET LE PROBLEME DE L’AUTONOMIE MORALE
Il arrive souvent qu’ayant terminé leur traitement psychanalytique, des sujets, enfants ou adultes, écrivent à l’analyste pour lui rapporter leurs expériences nouvelles. Or, dans ces lettres se retrouve toujours, bien qu’exprimé de mille manières, un même sentiment : sentiment de libération, d’autonomie. Une jeune fille écrit : « Maintenant, je sais pourquoi je fais telle chose plutôt que telle autre, les vieux esclavages inconscients sont de l’histoire ancienne » ; une autre: « Il faut avoir souffert ce que j’ai souffert pour savoir ce que signifie être libre ». D’un garçon de quatorze ans, chef, malgré son âge, d’une bande de jeunes voleurs de quinze à vingt ans : « Maintenant vous pouvez être sûre que je ne vole plus. Les premiers temps je vous garantis que ça me faisait un drôle d’effet de payer pour ce qui, avant, aurait passé si facilement de l’étalage à ma poche. Mais maintenant je peux ne plus voler ».
Etre libre d’agir en accord avec soi-même, pouvoir supprimer de sa vie de multiples comportements que l’on déplorait, mais auxquels il semblait qu’on ne puisse échapper, qu’est-ce que cela ? Quelles réalités psychologiques recouvrent ces expressions de délivrance, ces sentiments de libération, que nous rencontrons souvent au cours du traitement analytique et de plus en plus fréquemment à mesure que le traitement avance vers son but ? Quelle interprétation donner de cette liberté dont l’analysé guéri fait, ou croit faire, une expérience toute nouvelle ? Tels sont les problèmes que je désire poser ici.
Problèmes de praticienne : ce sont des faits de l’activité quotidienne qui les ont soulevés. C’est en praticienne aussi que je chercherai à en éclaircir les données psychologiques. [p. 96]
Considérant comme suffisamment connus le but et la méthode psychanalytiques, je ne ferai qu’en rappeler brièvement l’essentiel. La psychanalyse, procédé thérapeutique tout d’abord, est devenue une méthode extrêmement féconde de connaissance psychologique. D’une manière générale, elle doit être envisagée à ce double point de vue. Le premier nous intéresse ici particulièrement, mais c’est seule ment grâce aux connaissances que la psychanalyse nous a apportées que nous pouvons tenter de donner une interprétation fondée des phénomènes psychologiques qui se produisent au cours du traitement. La cure psychanalytique consiste à déceler chez le sujet, au moyen de tout ce qu’il extériorise, tant par ses paroles que par son comportement, les processus psychiques inconscients qui sont causes de symptômes pathologiques dans sa manière d’être ou d’agir. Par une prise de conscience progressive, l’action contraignante de ces facteurs inconscients, soumis à la réflexion et à la critique, est détruite. L’ana lysé retrouve le contrôle d’éléments de sa personnalité qui lui échappaient, et règle dès lors sa conduite d’après des choix conscients.
L’existence d’une vie psychique inconsciente n’étant plus à discuter, j’entrerai d’emblée dans l’exposé de quelques-uns des déterminismes inconscients les plus importants qu’une pratique psychanalytique permet de voir constamment à l’œuvre. Déceler l’action de ces mécanismes dans le comportement du malade est pour l’analyste le premier stade du traitement, puisque c’est d’eux que relèvent les symptômes morbides dont il s’agit de libérer le sujet. J’exposerai sommairement les mécanismes suivants : phénomènes d’identification, répétition d’attitudes infantiles, mécanismes d’auto-punition, soumission passive et persistante aux contraintes éducatives. En examinant certains cas nous pourrons suivre l’évolution du traitement analytique, ce qui nous permettra de saisir la signification psychologique du sentiment d’autonomie qu’un tel traitement fait naître chez le malade qui se rapproche de la guérison.
Par identification, nous entendons le fait d’établir des rapprochements inconscients entre des êtres distincts ayant, pour des raisons variées, une valeur identique du point de vue de l’affectivité du sujet, de telle sorte que le sujet est contraint de se comporter de la même manière envers chacun d’eux, que cette façon d’agir soit ou non adéquate. Il semble que notre vie affective s’organise autour d’un certain nombre d’images schématisées datant de l’enfance, images que Piaget a bien mises en évidence dans la formation de la pensée [p. 97] enfantine, et dont l’action limitative est d’autant plus forte dans la vie de l’individu que celui-ci est demeuré à un stade psychologique peu évolué et peu conscient. Au degré extrême, ces représentations primitives, images globales du père, de la mère, de frères ou sœurs, ou de quelque autre personne ayant joué un rôle de premier plan dans la vie de l’enfant, tendent à stéréotyper les réactions affectives de l’individu à l’égard des autres, ces réactions s’effectuant par séries d’identifications à l’une ou l’autre de ces images.
Tel est le cas, par exemple, de ce jeune homme de vingt-cinq ans, B. M., dont l’enfance s’est écoulée entre une mère très passionnément aimée et un père apparemment respecté, mais au fond jugé brutal. Par suite de multiples conflits et d’un certain manque de dynamisme, ce garçon est resté entièrement soumis à ces deux images affectives. Image du père, c’est-à-dire de l’homme exerçant l’autorité, à qui l’on doit une obéissance et une soumission d’autant plus serviles que cette attitude extérieure compense les sentiments hostiles que l’on éprouve à son égard. Image de la femme maternelle, amoureusement aimée, mais sexuellement interdite. Sa vie d’adulte est de ce fait entièrement faussée. D’une part, il est incapable de rapports normaux avec ses supérieurs, qui au même titre que son père représentent pour lui l’autorité. Ses professeurs, ses chefs ont été de tout temps l’objet de ses critiques ; il les épie, cherche à les prendre en faute pour se gausser d’eux par derrière, tandis qu’en fait il se rend leur esclave. Dans le domaine de. sa vie amoureuse, en particulier, il est lié par leur opinion, il craint d’être vu par eux en compagnie d’une jeune fille, il cache sa correspondance, renouvelant ainsi l’attitude de culpabilité qui était la sienne lorsque, enfant et jeune garçon très épris de sa mère, il se reprochait plus ou moins consciemment de considérer son père comme un rival détesté. D’autre part, son comportement à l’égard des femmes est faussé, lui aussi, par l’identification immédiate qu’il opère entre l’image qu’il a gardée de sa mère et la femme aimée. Sur le plan psychique il en résulte de nombreux conflits, dûs à ce que ces deux images ne se recouvrent pas comme il le désirerait; sur le plan physique, des inhibitions l’entravent, car sa mère ayant été l’objet d’amour défendu, la jeune fille qui la réincarne participe de cette même interdiction. Presque fiancé à plusieurs reprises, il a toujours fait surgir des obstacles au moment où ses fiançailles allaient aboutir, tant sont intenses les conflits inconscients ainsi déclenchés.
On relève fréquemment des exemples d’identification moins [p. 98] complexes chez l’enfant qui transfère sur son maître les sentiments qu’il éprouve pour son père, ou sur son institutrice ceux que sa mère a fait naître. Ainsi, ce jeune garçon de douze ans, intelligent, cordial, ne manquant pas par ailleurs d’esprit critique et de contrôle de soi, qui s’accusait de manifester à son maitre des sentiments nettement agressifs, tout en jugeant ce maître bon et juste et en déplorant de ne pouvoir agir autrement à son égard. Cet enfant, qui craignait son père, trop exigeant et dur, traitait son maître, qui incarnait égale ment pour lui l’autorité et la discipline, comme il aurait voulu traiter ce père redouté avec lequel il n’osait se permettre d’extérioriser son ressentiment. Ce fut seulement lorsque les conflits à l’égard du père furent résolus que l’enfant put se comporter envers son maître conformément à l’opinion favorable qu’il avait de lui.
Des cas de ce genre se rencontrent fréquemment. La sympathie ou l’antipathie immédiate dont l’enfant témoigne souvent à l’égard de ses éducateurs relève généralement d’identifications inconscientes.
Il faut insister encore sur le fait que ces mécanismes se déclenchent absolument à l’insu du sujet, dont ils altèrent la conduite sans que le sujet en ait aucunement conscience. Ce caractère d’inconscience est commun à tous les déterminismes psychologiques que nous examinons ici.
Les répétitions d’attitudes infantiles se laissent facilement observer dans la vie courante, et il n’est souvent pas besoin de recourir à la technique analytique pour les déceler. Pour beaucoup d’êtres, l’enfance, malgré ses nombreux conflits, est demeurée un stade de vie regretté. C’est vers cette période de simple soumission, d’acceptation facile de tendresse et de soins qu’ils ont tendance à régresser, toutes les fois que leurs responsabilités d’adulte se font trop lourdement sentir. Ces régressions ressuscitent, en face des difficultés de la vie, un comportement qui a fait ses preuves durant l’enfance comme moyen d’écarter la peine ou le souci. De ce fait, elles replacent le sujet dans une ambiance et un rôle inactuels qui ne coïncident plus avec l’ensemble de sa personnalité.
En voici des exemples : Une enfant, Ninette, dont la mère, pour des raisons de santé, ne peut s’occuper elle-même, croit ne pas être aimée des siens jusqu’au jour où, une maladie grave ayant mis sa vie en danger, elle réalise l’affection dont elle est l’objet à travers l’inquiétude qu’elle lit sur le visage de ses parents. Dès lors et durant bien des années, elle recourt inconsciemment à la maladie et aux soins [p. 99] affectueux qu’elle lui apporte, toutes les fois que son inquiétude affective renaît et que l’angoisse de se sentir « de trop » devient aiguë.
Semblable par son mécanisme psychologique est le cas de ce jeune homme de vingt-trois ans, R. T., qui réagit à toute critique, observation ou insuccès de la manière suivante: loin de se regimber, il s’accable, augmente ses torts, étend ses auto-accusations à l’ensemble de sa vie, se lamente d’être un bon à rien, ce qui met bientôt l’interlocuteur dans l’obligation d’atténuer le caractère péjoratif de ses jugements. De cette façon, notre sujet s’en tire à bon compte ; s’il abdique sur toute la ligne, c’est en fait pour n’avoir rien à admettre de façon précise. Dès qu’il aura réussi à apitoyer son juge, il retrouvera son calme sans avoir cédé d’un pouce. C’est ainsi que ce jeune homme, fort peu sûr de lui-même, défend son moi contre toute atteinte par ce « truc », dont il use très innocemment sans se rendre compte des mobiles qui le font agir. Sa mère, personne sensible, s’est toujours laissé prendre à ce jeu dont la réussite durant l’enfance a assuré un usage répété et durable.
Il n’est pas nécessaire de citer d’autres exemples de ces mécanismes de régression, relativement simples dans leur structure bien qu’infiniment variés dans leurs moyens d’expression. Plus complexes sont les processus d’auto-punition, expression inconsciente d’une instance morale hyper-sévère, Cette instance morale se forme progressivement en l’individu par l’action convergente de la contrainte éducative et d’identifications successives à des êtres aimés, parents en tout premier lieu, dont l’enfant intériorise l’image idéalisée. Cette instance morale constitue ce que Freud a appelé le sur-moi, terme souvent mal com pris, dont nous préciserons le sens tout à l’heure. Disons, dès mainte nant, que ce sur-moi ainsi construit fait partie de l’inconscient de l’individu et qu’il ne doit pas être confondu avec l’idéal moral, le but spirituel librement réfléchi et discuté par une personnalité autonome qui s’est dégagée de l’emprise morale subie pendant ses années d’enfance et qui a osé adopter une attitude personnelle. Il est bien évident que même alors, après le travail critique que permet le recul des années, il subsiste dans une attitude dite personnelle à l’égard des problèmes moraux de nombreux éléments de base provenant de l’éducation. Cependant on peut admettre que chez un individu normal, que ne lient pas des fixations pathologiques à son enfance, ces éléments de base ont été travaillés, remaniés, dans le sens d’une meilleure adaptation aux caractères propres de sa personnalité. Par [p. 100] contre, beaucoup d’êtres, n’étant jamais parvenus à ce stade d’autonomie, demeurent sous le contrôle d’un sur-moi exigeant, produit intact de leur enfance. Ce sur-moi agit à la façon d’une tendance dont l’individu n’aurait qu’une conscience très vague, c’est-à-dire de manière impulsive et particulièrement contraignante.
C’est à l’action du sur-moi qu’il faut rattacher les sanctions punitives que l’individu s’inflige à lui-même, quelquefois consciemment, mais le plus souvent sans qu’il établisse aucun lien entre son senti ment de culpabilité, dont il ne mesure souvent pas la force, et le fait désagréable qui tient lieu de sanction. Généralement, il s’explique ce fait par des raisons naturelles et absolument extérieures à lui.
Comme exemple d’auto-punitions conscientes, je citerai des comportements d’enfants aux prises avec des conflits sexuels. Les manifestations infantiles de la sexualité, curiosité ou masturbation, étant celles qui éveillent la plus vive réprobation de la part de l’adulte, c’est dans ce domaine que le sur-moi de l’enfant se montre le plus sévère. Il n’est pas rare de rencontrer des enfants qui se mordent le doigt, se font aux mains des entailles, chaque fois qu’ils ont cédé à la tentation. D’autres se griffent le visage pour ne plus plaire à leur partenaire. Certains garçons — et leur nombre est plus grand qu’on ne le pense — vont jusqu’à des tentatives réelles de castration.
Je ne mentionne ces faits, qui par leur caractère conscient ne nous intéressent pas directement ici, que pour montrer combien violentes peuvent être les réactions du sur-moi. L’intensité des impulsions punitives s’explique aisément, si l’on réalise que la formation d’un sur-moi rigide s’accompagne immanquablement de sentiments forte ment agressifs de la part de l’enfant envers ceux qui l’ont trop rude ment maté. Jamais extériorisée, mais ressentie comme une grave faute, cette agressivité se retourne contre celui qui l’éprouve et qui devient ainsi sa propre victime.
Il est aisé de déduire de ce qui précède le caractère de ténacité que revêtent fréquemment les mécanismes d’auto-punition et les résistances auxquelles se heurte l’analyste lorsqu’il s’efforce d’en libérer le malade, surtout lorsque celui-ci a eu recours à ces mécanismes durant une bonne partie de sa vie. Je n’en citerai qu’un exemple, mais avec quelques détails.
Il s’agit d’une personne de quarante-quatre ans, mariée, mère d’un garçon de douze ans, et qui présente depuis l’adolescence des périodes fréquentes et plus ou moins durables d’angoisse et de [p. 101] dépression. Fortement anxieuse pour les motifs apparents les plus variés, elle court les médecins, les prêtres, les psychologues de pas sage, implorant de chacun des conseils qu’elle ne suit pas, tout occupée qu’elle est à en demander d’autres. En fait, malgré l’état douloureux dans lequel elle se trouve, cette personne ne désire nulle ment la guérison, et si elle se joue à elle-même comme elle la joue aux autres la comédie de rechercher activement le remède, c’est pour opposer une résistance d’autant plus grande aux traitements qu’on cherche à lui appliquer. Elle ne peut en effet se passer de ses maux physiques et psychiques, qui lui tiennent lieu de moyen d’expiation.
Cette femme, que j’appellerai Mme C., est une personne intelligente, riche en ressources intérieures. Sa forte névrose a fait d’elle un être occupé sans cesse à se plaindre et incapable d’aucune activité suivie. Son affectivité est presque totalement inhibée. Indifférente à tout et à tous, elle néglige son ménage, ne prend aucun soin de son mari et souhaite se décharger sur moi du soin d’élever son fils. Elle a abandonné depuis plusieurs mois sa profession de couturière.
Avant-dernière de dix enfants, Mme C. a été élevée dans un milieu catholique très pieux et très strict quant aux observances religieuses. Cependant, exception faite des devoirs religieux auxquels ces enfants ont été astreints de bonne heure, ils n’ont reçu aucune éducation réelle, tout échange vrai et libre entre enfants et parents étant exclu. Les cadets surtout ont poussé à leur guise, très rarement conseillés et guidés, mais craignant Dieu et son implacable justice au même titre qu’ils redoutaient les indignations paternelles. Cette éducation fit de la personne en question un être craintif, timide, scrupuleux, toujours prêt à s’accabler de reproches pour des vétilles. Bientôt elle souffrit de la contradiction entre les principes religieux de ses parents et leur manque de tendresse. Elle leur en voulut âprement de ce qu’elle ne pouvait se confier à eux, ni attendre d’eux aucune protection. Hyper-morale et scrupuleuse, l’enfant ne se permit jamais de protes ter contre cet état de choses, mais s’accusa bien au contraire de manquer de respect envers ses parents. Renfermée, craintive, elle cultiva si bien cette tendance à retourner contre elle les griefs qu’elle pouvait avoir envers d’autres qu’elle fit de sa vie une continuelle expiation des mauvais sentiments dont elle s’accusait. Tout lui fut prétexte à s’infliger inconsciemment les punitions les plus cruelles, maux physiques innombrables, séries d’accidents, pertes d’argent, ennuis et soucis moraux de toutes sortes. [p. 102]
Durant toute une période de son analyse, Mme C. présenta des crises de rage d’une violence et d’un caractère nettement enfantins dans lesquelles elle laissa s’extérioriser l’agressivité contre tout et tous, que, depuis son enfance, elle s’interdisait de ressentir. Dès lors, elle commença à saisir ce qui s’était passé en elle et le rôle expiatoire à l’égard de cette rancune cachée que jouaient dans sa vie les multiples incidents fâcheux dont elle souffrait. Cette prise de conscience et l’apaisement de sa culpabilité déclenchèrent nécessairement le travail critique de sa raison, ce qui l’amena peu à peu à employer ses forces psychiques non plus à expier le passé, mais à reconstruire sa vie. Jusqu’alors anxieuse et tourmentée, incapable de s’intéresser à rien ni à personne, cette femme intelligente et d’une riche affectivité a repris une place normale dans sa famille comme dans sa profession.
Pour terminer cette première partie de mon exposé, je voudrais parler de l’état d’esclavage intérieur dans lequel vivent les « éternels obéissants ». La soumission persistante et passive aux contraintes de l’éducation est un facteur psychologique qui se retrouve chez beaucoup de névrosés. Il n’est pas besoin cependant d’être atteint d’une véritable névrose pour subir son action inhibante, et nous savons bien que, parmi les individus dits normaux, nombreux sont ceux gui ne deviennent jamais des personnalités autonomes. Leur sur-moi tyrannique les en empêche.
Nous avons vu comment se constitue le sur-moi, simple introjection de la contrainte morale adulte. C’est là une instance morale qui, lorsqu’elle a été fortement établie, reste toujours extérieure au sujet, ne fait pas corps avec lui. Elle n’est pas assimilée, du fait simplement qu’échappant en grande partie à la conscience de l’individu, elle ne peut pas être discutée et n’évolue pas en même temps que lui. Normalement, l’être prend progressivement conscience du code moral qu’il porte en lui, quand les circonstances extérieures laissent à l’enfant déjà, puis à l’adolescent, suffisamment de liberté pour qu’il fasse des expériences personnelles. A la lumière de ces expériences, il critique et corrige les règles morales qui lui ont été inculquées, saisissant leur portée et leur raison d’être, ou alors les rejetant. Mais, lorsqu’une éducation stricte, basée sur l’obéissance passive, empêche ce travail personnel de contrôle et d’adaptation, l’individu n’intériorise pas la règle morale.
Des travaux récents, celui de Piaget sur Le jugement moral en particulier, ont bien montré que la contrainte adulte en isolant [p. 103] l’enfant, dont elle ne respecté pas la personnalité naissante, le main tient dans son égocentrisme. Du défaut de coopération qui en résulte naît une observance littérale de la: règle morale, considérée comme l’expression de la volonté des parents, observance tout extérieure qui, n’entraîne pas l’adhésion totale de l’individu à une mesure de réciprocité dont il n’est pas à même de reconnaître la véritable raison d’être.
Il faut se rendre compte que les facteurs psychologiques qui retiennent l’individu à un stade d’obéissance passive sont de deux ordres, l’un plus intellectuel, l’autre surtout affectif. Quand un enfant a été soumis, souvent durant de longues années, à une obéissance absolue et insuffisamment motivée, il manifeste plus tard une incapacité réelle à se diriger par lui-même, une inexpérience totale de la vie et des choix qu’elle implique, disons même un manque de sens moral. Car l’être maintenu dans son égocentrisme ne peut en même temps être une personnalité morale. Il est donc naturel qu’un tel être, cédant d’une part à la loi du moindre effort et à l’habitude, d’autre part au senti ment de son incapacité à prendre des initiatives, recoure sans cesse aux ordres et aux conseils d’autrui. Mais le facteur le plus actif, celui qui contraint l’individu non pas seulement à chercher aide et protection dans son entourage, mais à s’asservir littéralement à ses proches, est un facteur affectif, qui échappe absolument à sa con science. Celui qu’on a appelé « l’éternel obéissant » est toujours un être qui a été bridé dans son évolution normale par une éducation trop sévère, et qui en a souffert, souvent de manière très aiguë. Faible, il s’est laissé réduire à l’impuissance par la loi du plus fort. Mais comprend-on ce qu’une telle soumission cache de rancœur refoulée, d’animosité contenue ? Si de tels êtres ne parviennent pas à l’autonomie, ce n’est pas avant tout par incapacité, mais bien plutôt parce qu’ils sont liés, absolument à leur insu, par leur agressivité refoulée envers ceux qui les ont matés. Cette agressivité est souvent si violente qu’ils ne peuvent la réduire au silence autrement qu’en faisant bonne mine à mauvais jeu. Car il serait intolérable à leur conscience morale d’admettre cette agressivité. Ils se défendent donc contre elle en s’asservissant à leur famille, compensant par leur soumission apparente, d’ailleurs sincère sinon réelle, la sourde révolte qu’ils portent en eux. Certains cas de dévouement et d’abnégation sans limite, que l’on cite en exemple, n’ont pas d’autre fondement.
Pour illustrer ces remarques théoriques, je citerai le cas d’une jeune fille de vingt-cinq ans, de milieu aisé, fort bien douée au point de vue [p. 104] intellectuel et artistique. Entre autres symptômes, Mlle A. présente une attitude absolument infantile d’obéissance familiale. Il y a chez elle un décalage frappant entre le plan de la pensée et le plan de l’action. Au contraire de ce qui se passe chez l’enfant, c’est le plan de l’action qui est en retard sur celui de la pensée. Mlle A. a beaucoup lu, beaucoup réfléchi, se dégageant ainsi des manières de penser courantes dans son milieu très religieux et assez étroit. Elle a ses idées bien à elle, et à l’entendre on pourrait penser avoir affaire à une personnalité très normalement évoluée.
Cependant, sur le plan des réalisations, il n’en est rien. Mlle A. en souffre d’autant plus que ce n’est pas pour donner le change qu’elle s’exprime comme elle le fait, mais bien réellement parce que ses opi nions sont l’objet, de sa part, d’une conviction sincère. Mais, dès qu’il faudrait agir en conséquence, Mlle A. n’éprouve plus que timidité, craintes, inhibitions. La peur de mécontenter ses proches, ou plus simplement d’avoir à leur dévoiler une divergence de point de vue, la met dans une angoisse intolérable. Pleurant comme une enfant, elle renonce finalement à agir en fonction d’elle-même et se soumet de nouveau à l’ambiance familiale. Ce sont là des expériences quasi-quotidiennes qui la laissent tout d’abord abattue, puis de plus en plus en colère. Des phrases comme : « Tout le monde me gâche ma vie », « J’en veux aux gens », témoignent, en essayant de la détourner de son objet réel, d’une agressivité très forte, dirigée contre les parents, le père surtout.
Au début de son analyse, les réactions d’abattement et de dépression sont les plus fréquentes, suivies parfois d’explications larmoyantes aux parents vis-à-vis de qui la jeune fille s’accuse de ne pas montrer assez de soumission. Le conscient refuse encore d’admettre l’existence de l’agressivité, dévoilée pourtant par ce besoin d’obéir davantage aux parents, chaque fois que se produit sur le plan de l’action un échec dont ils sont tenus pour responsables.
Lentement, au cours des deux premiers mois de l’analyse, Mlle A. accepte de prendre conscience de son agressivité envers ses parents, au fur et à mesure qu’elle comprend que cette agressivité déguisée fausse absolument leurs rapports. Mais à chaque prise de conscience succède une réaction de culpabilité à l’égard des parents, de rancœur vis-à-vis de l’analyste qui oblige à voir clair. Chaque fois, Mlle A. éprouve le besoin impérieux, le soir de sa séance ou le lendemain, de faire une concession nouvelle à ses parents en compensation des [p. 105] sentiments agressifs à leur égard qu’elle a osé exprimer. Elle se prive d’une sortie avec un camarade, refuse une invitation à un bal ou une soirée au cinéma, prétendant que ce sont là choses défendues, que son père réprouve. En fait, le père ne montre aucune intolérance à ce sujet, et c’est bien la jeune fille qui s’exagère le rigorisme paternel pour s’en rendre esclave encore davantage. Il faut donc, comme dans tout traitement de ce genre, avancer lentement, en rassurant sans cesse le sujet afin d’éviter de trop fortes réactions de culpabilité.
Vient ensuite une période où Mlle A. convaincue enfin qu’elle ne pourra établir des rapports normaux entre ses parents et elle-même qu’à la condition de liquider sa révolte envers eux, laisse pleinement s’extérioriser ses sentiments agressifs durant ses séances analytiques. Elle constate bientôt une détente entre son père et elle, et la possibilité d’un accord fait non plus de concessions regrettées, mais d’une entente véritable. Quelques expériences dans ce sens l’encouragent à dévoiler entièrement sa rancune.
C’est à partir de cette période seulement que Mlle A. entre dans la phase constructive de son analyse. Libérée de ce qui l’obligeait, bien à contre-cœur, à se faire le jouet de l’autorité paternelle, elle se découvre elle-même, prend conscience de ses possibilités non seule ment sur le plan de la pensée, mais sur le plan de l’action. Le pont est jeté entre les deux. Dès ce moment, et toujours plus fréquemment, elle parvient à agir spontanément en accord avec son point de vue personnel, en accord avec elle-même. Et c’est chaque fois avec la joie d’une esclave qui voit tomber ses chaînes qu’elle raconte ses expé riences nouvelles dans lesquelles s’exprime la totalité d’elle-même.
*
* *
C’est à dessein qu’en vous citant ce dernier exemple de l’action subtile et profonde des mécanismes inconscients, j’ai dépassé l’exposé du mécanisme lui-même, pour vous indiquer brièvement comment le sujet s’en est trouvé libéré. Car c’est le processus de cette libération que je voudrais maintenant préciser.
Quels que soient les facteurs psychologiques inconscients qui perturbent le caractère ou le comportement du sujet (je n’ai cité ici à titre d’exemples que quelques-uns des plus importants), le fait essentiel de la guérison consiste en une prise de conscience. Il est clair que nous ne pouvons juger nos actes ou nos pensées, les critiquer, en un mot exercer sur eux un contrôle, que dans la mesure seulement [p. 106] où nous en avons conscience. Si, chez nous tous, nombre de pensées, de sentiments, d’actes même demeurent inconscients, chez certains, sous l’action de traumatismes psychologiques ou de facteurs constitutionnels laissant à l’individu une moins grande force de synthèse psychique, le champ de la conscience est particulièrement restreint, si bien que les éléments essentiels de la personnalité demeurent ignorés. Du même coup, ces éléments échappent au contrôle de la pensée coordinatrice et sont isolés à l’état de pulsions latentes, qui se manifestent inopinément. Ces manifestations inconscientes, nous l’avons vu, sont toujours inadéquates, en désaccord avec l’ensemble de la personnalité qui se trouve elle-même, du fait de ces éléments qui ne font plus corps avec elle, diminuée dans ses possibilités, limitée dans des sens divers.
C’est à recréer l’unité psychique de l’individu, en réintégrant dans le tout les parties refoulées en deçà du seuil de la conscience, que vise le traitement psychanalytique. Il s’agit que l’individu se sente un et non plus divisé entre ses désirs conscients et des pulsions inconscientes dont il n’a plus la direction. Tout ce qui fait sa vie psychologique, et j’entends par là aussi bien ce qui concerne son affectivité, ses relations avec les autres, ses capacités intellectuelles, l’exercice de sa profession, que son attitude en face de la vie instinctive, de la sexualité en particulier, doit être clairement connu. Il faut ici ouvrir une parenthèse pour préciser un point au sujet duquel circulent les opi nions les plus erronées. Le domaine sexuel étant celui auquel l’individu peut réfléchir le moins librement du fait qu’il est généralement l’objet d’une sorte de mystère réprobateur, et cela dès les années d’enfance, il s’ensuit que c’est là un élément de la personnalité qui demeure souvent isolé, très peu conscient et, partant, très fréquemment en dehors du contrôle de l’individu. De là des troubles allant soit dans le sens d’une hypertrophie des préoccupations sexuelles, soit dans celui d’un refoulement exagéré, troubles qui se rencontrent chez presque tous les névrosés. La psychanalyse ne s’étant pas effrayée de ce domaine et cherchant à le normaliser en le replaçant dans sa situation relative par rapport aux autres éléments de la personnalité, on a conclu couramment qu’un traitement psychanalytique ne prend en considération que la vie instinctive du sujet. C’est là une erreur absolue. Les cas que j’ai cités en auront été la preuve, puisque pour tous le nœud des conflits résidait ailleurs, dans une fixation affective au passé. Chez tous, il est vrai, ces fixations à un stade de vie qui aurait [p ; 107] dû être dépassé ont entraîné des perturbations de la vie sexuelle, importantes à corriger, mais non pas essentielles quant à la formation de la névrose.
Ce point éclairci, nous pouvons établir que l’analyse, en s’efforçant de recréer l’unité psychologique de l’individu par la prise de con science des éléments qui lui échappent, vise bien à une unité aussi complète que possible, à un équilibre psychique satisfaisant résidant précisément en une juste relation de tous ces éléments entre eux.
Le mécanisme de cette prise de conscience n’est pas si simple qu’on pourrait le supposer au premier abord. Car ce n’est pas seulement à la compréhension intellectuelle du sujet que s’adresse l’analyste, lors qu’il s’efforce de faire saisir à l’analysé les mobiles inconscients de sa conduite. C’est toute la vie affective qui est alors en cause et qui se défend contre cette révélation. Il ne s’agit pas que l’analysé se borne à comprendre une idée nouvelle qui lui est présentée, mais qu’il accepte le contenu de cette idée, avec les conséquences que cela comporte. Inutile de dire qu’il peut s’écouler parfois bien des semaines, si ce n’est des mois, entre le moment de la compréhension intellectuelle et celui de la conviction entière qui entraîne l’acceptation. Pen dant ce laps de temps, l’analysé est divisé, en lutte contre lui-même. Car il tient à ses attitudes anormales, à ses comportements erronés, qui toujours lui rapportent des satisfactions momentanées. Nous l’avons vu dans le cas de Mme C. pour qui toutes les sanctions auto punitives qu’elle s’infligeait représentaient une expiation nécessaire et un soulagement de conscience d’un instant, comme aussi chez Mlle A. qui, malgré sa vive intelligence, ne put admettre que très lentement la forte agressivité qui l’asservissait à son milieu familial, mais qui en même temps la protégeait contre la nécessité d’endosser elle même les responsabilités de la vie. Ce n’est pas pour rien que l’individu a refoulé dans l’inconscient ce qui le gênait trop considérablement, et ce n’est pas sans peine qu’il accepte de l’exhumer pour en corriger les erreurs et récupérer ce qui constituait jusqu’alors des lacunes dans l’ensemble de sa personnalité.
Ce n’est pourtant que lorsque l’analysé accepte de se livrer à ce travail de réflexion et de critique des mobiles inconscients que l’analyste lui révèle, qu’il se libère de leur contrainte. Il saisit alors qu’il ne s’agit là que de compromis qui ne résolvent en rien la situation, mais qui le maintiennent au contraire dans un état fort peu satisfaisant. Du même coup ces raisons d’agir perdent de leur poids. Peu à [p. 108] peu leur valeur est annulée par la pensée consciente qui, les voyant à l’œuvre, les juge et les reconnaît impropres à exprimer la totalité du mol.
Ainsi chez le jeune voleur que je citais au début de cet exposé. Ce garçon qui s’était mis à dérober par rancune contre un milieu déplorable, rancune qu’il reportait sur la société entière, fut guéri lorsqu’il comprit le rôle que jouait dans son comportement cette agressivité contenue; il admit alors le besoin profond de sympathie et d’affection que masquait sa rancune et il put juger combien ses vols, qui n’exprimaient que son amertume, allaient à l’encontre de ses besoins et de ses désirs les plus profonds. Dès lors, et selon son expression, « il put ne plus voler ».
C’est dans cet accord retrouvé avec les éléments les plus profonds et les plus stables de la personnalité que consiste la libération exprimée si fréquemment par l’analysé guéri ou en voie de l’être. Les mobiles inconscients, qui relèvent de sentiments refoulés, n’expriment jamais qu’une part restreinte du moi et par surcroît une part encore forte ment infantile. Restés en dehors du champ de la conscience, ces sentiments sont demeurés tels qu’ils étaient à un stade de son évolution que l’individu a dépassé, ou qu’il devrait normalement avoir dépassé — car il faut tenir compte ici du rôle de frein que jouent ces éléments inconscients sur le développement de la personnalité dans son ensemble. Ils n’ont pu être adaptés progressivement aux besoins réels du moment. L’individu qui est soumis à leur action reste lié par eux en deçà de lui-même, tourné vers le passé.
Le « je peux ne plus voler » du jeune garçon de tout à l’heure n’exprime-t-il pas au contraire l’essence même de l’acte libre, tel que nos observations nous permettent de le concevoir, tel du reste que le situent certaines pages de Brunschvicg lorsqu’il écrit : « Ce qui est juste à ses yeux (aux yeux de l’homme libre)… c’est ce qui a surmonté l’épreuve de son jugement, même si, ou à plus forte raison si ce juge ment marque une étape de réflexion ou d’action qui, pour lui-même ou pour les autres, par rapport à la coutume ou à son propre passé, rectifie son idée, affine sa norme de la justice » (1).
N’est-ce pas là cet « effort constant de dépassement de soi » dont M. H.-L. Miéville dans l’ouvrage si suggestif qu’il a publié [p. 109] récemment (2) montre qu’il est la condition même de la liberté r J’ai été vivement frappée, en lisant les pages que M. Miéville consacre au problème de la liberté, d’y trouver synthétisée de façon remarquable l’essence même des observations qu’une pratique psychanalytique permet de noter quotidiennement. « La liberté vraie », écrit M. Miéville, « ne se réalise que dans la mesure où l’accord est obtenu du comportement de l’individu avec une haute et large conception de la condition humaine et des fins humaines. Voilà pourquoi le « Je ne puis autrement » du saint n’est pas comparable au « Je ne puis autrement » de l’égoïste, du faible ou du vicieux. Toute ascension vers la liberté, toute libération a pour condition un élargissement et un approfondissement de la conscience que 1’individu possède de ses relations avec le milieu humain et le milieu cosmique où il vit. Tout ce qui borne et rétrécit cette conscience, borne et rétrécit sa liberté et la menace ». (p. 200).
Lorsque l’individu, par la prise de conscience et le travail critique qui la suit, se libère progressivement de son égocentrisme, des fixations infantiles qui le maintenaient tourné vers le passé, des mécanismes inconscients de tout genre qui le liaient à une fausse notion de lui même et des autres, il voit alors son horizon s’ouvrir. Et ce n’est pas un des moments les moins poignants de la cure analytique, que celui où l’analyste assiste, tout en la dirigeant, à cette expansion d’une personnalité, expansion au dedans de soi d’abord et vers les autres. Dès lors, c’est en fonction de ce moi agrandi que l’analysé peut régler sa conduite.
Si l’acte libre est celui qui naît d’une personnalité à la fois élargie et consciente de son unité, il faut insister encore sur le fait qu’il exprime le sentiment intime qu’éprouve l’individu affranchi de ses attaches anciennes, d’évoluer toujours, de se transformer sans cesse. Alors que, sous l’action des mécanismes inconscients, l’être subit les conséquences du passé et agit dans le prolongement d’un moi ancien, il se libère de ce passé lorsqu’il est conscient de lui même, il se rend compte du dynamisme intérieur qu’il possède et, se fondant sur l’évolution qui se poursuit en lui, il a bien plutôt ten dance à conformer son action à un stade psychologique marquant déjà un dépassement sur celui qu’il réalise dans le présent. L’esprit se montre là véritablement créateur. En fonction d’un moi en devenir se [p. 110] forment des synthèses nouvelles conditionnant une action de plus en plus adaptée, d’une part à la réalité, d’autre part à la personnalité dans son ensemble.
Bien entendu, il ne doit pas y avoir un véritable décalage entre les possibilités présentes du sujet et l’action qu’il entreprend en fonction de l’étape prochaine qu’il commence à entrevoir. Car alors l’action serait vouée à l’échec, l’individu n’étant pas suffisamment convaincu de sa justesse. Il y a là un écueil à éviter, pour l’analyste au cours de ses traitements, comme pour nous tous au cours de la vie. Il ne sert à rien de brûler les étapes. Aller trop vite en ce domaine, c’est agir en fonction d’un élan d’amour-propre ou d’ambitions que d’autres peuvent manifester à notre égard. De toutes manières, c’est perdre de vue la totalité de l’être et se comporter dans le seul sens d’un désir partiel.
Cette réserve faite, nous dirons que, pour nous, l’homme le plus libre est celui qui se connaît assez à fond pour pouvoir agir avec justesse, lors même qu’il éprouve encore en lui des résistances, sans se laisser arrêter par elles, sachant sûrement distinguer le cas où son action, conforme à son moi profond, entraînera presque immédiatement l’adhésion complète de sa personnalité.
Les considérations qui précèdent soulèvent nécessairement le problème de la responsabilité morale. Constamment, devant la préoccupation analytique de trouver aux défauts de caractère et aux erreurs de conduite une cause inconsciente, la question est posée aux analystes : « Que faites-vous de la responsabilité morale, de l’effort individuel ? »
Je ne songe pas à trancher ici en quelques lignes une question aussi complexe. Fidèle à ma position non de philosophe, mais de praticienne, je me bornerai à indiquer ce qu’est mon attitude pratique en face de ce problème, attitude qui découle des observations que je viens d’exposer.
« Attitude pratique » en face de la responsabilité morale, ai-je dit.
Ce terme trahit déjà ma pensée.
Je crois en effet que l’on a trop cherché à donner à la notion de responsabilité morale un sens métaphysique, une valeur d’absolu. Cela tient sans doute à ce que l’on craint en général de voir s’écrouler la morale tout entière si l’on n’établit pas en dogme la complète responsabilité de l’individu. Sur ce point, des esprits, qui par ailleurs ne songeraient pas à nier le déterminisme, ne craignent pas la contradiction, tant ils la jugent nécessaire. Question d’attitude pratique encore, car c’est en fonction de la vie, de l’action quotidienne, qu’ils acceptent cette contradiction gênante pour la pensée. [p. 111]
Ma position personnelle en face de ce problème n’est pas davantage une position théorique. Elle me paraît plus conforme aux faits et surtout plus efficace du point de vue de la vie.
Dire qu’un individu est moralement responsable de ses actes, c’est impliquer que, lorsqu’il a commis une erreur, il n’a pas exercé un pouvoir qui était cependant à sa disposition. D’où une culpabilité totale.
Or, si nous nous référons aux faits qu’une analyse met en évidence, nous voyons constamment des êtres, qu’aucun psychiatre n’aurait tenus pour irresponsables, se comporter, souvent à leur détriment et à regret, comme s’ils étaient pris dans un véritable mécanisme, ce mécanisme ne cessant de jouer que dès le moment où ses rouages secrets ont été dévoilés. Il y a là un indiscutable déterminisme, sur lequel il nous est possible d’agir, sachant que si nous déclenchons tel phénomène, tel autre se produira immanquablement. C’est ainsi que, par exemple, nous pouvons souvent prévoir d’une séance à l’autre, en fonction de ce qui a été dit, quel sera le comportement du sujet, tandis que le sujet lui-même n’a aucune conscience du processus qui s’est déroulé en lui.
Nous rejetons donc l’idée de responsabilité totale de l’individu pour tout ce qui est antérieur à une prise de conscience réelle. Dans la majorité des cas, il n’y a aucune prise de conscience des mobiles pro fonds de l’action et il est erroné de croire, en regardant en arrière, qu’on aurait pu agir autrement qu’on ne l’a fait. Seuls, le recul vis à-vis du fait et la plus grande lucidité intérieure venant de ce recul alimentent cette illusion.
Illusion grave, lourde de conséquences. Car admettre cette possibilité de bien non exercée, c’est se charger du pesant fardeau des regrets et des remords, c’est rester tourné vers le passé, c’est entra ver tout élan intérieur par un sentiment d’impuissance. Nombreux sont les êtres si cruellement tourmentés par cette illusion qu’ils gâchent toute une vie en fonction d’erreurs anciennes dont ils pensent, à la lumière du présent, qu’elles auraient pu être évitées.
Il y a cependant une réserve à faire. Dans certains cas, et nous en trouverions des exemples dans chacune de nos vies, la possibilité d’erreur avait été prévue, le fait avait été jugé dans ses éléments positifs et négatifs, et après cet examen par la pensée, une décision avait été prise. Cependant, le moment venu, l’erreur est commise sans qu’il soit tenu compte des réflexions antérieures. Que conclure ? Il est certain [p. 112] que la prise de conscience de la complexité du problème n’a pas été suffisante. Le sujet n’a pas été assez « profond » en lui-même pour saisir ses désirs et ses sentiments les plus intimes. L’aurait-il pu ? Je ne le crois pas. Cependant, le fait qu’il avait pu élucider certains éléments de la question le charge d’une responsabilité relative, atténuée par l’idée que dans son état intérieur du moment il n’était pas capable d’une prise de conscience plus complète, donc plus efficace.
Et c’est ici que nous rejoignons ce qui me paraît être l’élément positif de la notion de responsabilité morale. Pour nous trouver dans un état intérieur tel que nous puissions être lucides avec nous mêmes, clairvoyants, sans être gênés par notre amour-propre, objectifs, c’est-à-dire ayant éliminé tout parti pris, sincères, sans crainte d’aucune sorte, il faut un lent et patient travail de préparation. Il faut que, de façon continue et surtout en dehors des périodes de crise, nous préparions l’action juste. Travail double. D’une part, prise de conscience de ce gue nous sommes, par tout ce que les expériences de la vie et la critique des autres nous apprennent quant à ce que nous aurions tendance à ignorer en nous. D’autre part, prise de conscience du sens social de nos actes, et de la grande solidarité qui nous lie tous. Extension vers l’intérieur, extension vers l’extérieur.
Pour que nos actes soient fortement motivés, il faut cet élargisse ment de nous-mêmes, car chacun d’eux fait alors partie d’un tout et les mobiles qui les dictent sont étroitement liés à d’autres auxquels nous tenons. Il ne faut pas perdre de vue le rôle que joue ici l’affectivité. Nous ne faisons bien que ce que nous aimons, nous n’avons la force de surmonter les obstacles que lorsque nous désirons fortement le but auquel nous tendons. Pour que l’action juste rencontre l’adhé sion de notre moi le plus stable et le plus profond, et pour qu’elle s’impose, il faut qu’elle aille dans le sens d’une conception de nous mêmes et des autres clairement pensée et à laquelle soient liés nos sentiments.
C’est dans ce travail intérieur, préparation lointaine et indirecte, mais préparation nécessaire à une action consciente et juste, que me paraît résider notre responsabilité morale.
Pour ce qui est du passé, nous constatons une conscience de nous même souvent nulle, toujours imparfaite, point de départ de nombreuses erreurs. Mais prendre conscience de soi n’est pas chose aisée ni rapide. Les erreurs seules, parfois, nous éclairent, comme au cours d’une expérience scientifique les échecs révèlent les techniques [p. 113] insuffisantes. Et pour continuer la comparaison, de même que l’homme de science reprend après l’échec la préparation de l’expérience nouvelle en la croyant possible, de même en fonction du présent et de l’avenir croyons-nous agir efficacement, pour préparer l’action juste, en travaillant à prendre possession de la totalité de nous-même.
En conclusion il me paraît intéressant de rappeler ici le point de vue d’African Spir. Dans ses Esquisses de philosophie critique, Spir s’attache à montrer que le problème de la responsabilité morale est mal posé lorsqu’on entend par liberté le libre-arbitre et que l’on admet que l’homme, pouvant opter aussi bien pour le mal que pour le bien, choisit le mal sans cause. Si l’on admet par ailleurs que l’homme est un être moral, c’est-à-dire conscient que le bien est seul conforme à sa nature normale et à ses intérêts profonds et que le mal leur est opposé, on se trouve en face d’une inéluctable contradiction.
Pour Spir, cette contradiction n’existe pas. « La liberté », écrit-il, « est la part de l’absolu dans l’homme ; or, son individualité ne renferme rien d’absolu, puisqu’elle est un produit de causes ; la part de l’absolu, dans l’homme, ne peut donc être autre chose que sa con science de l’absolu, c’est-à-dire de la nature normale des choses, qui est précisément sa conscience morale témoignant que le bien et le vrai sont seuls conformes à la nature normale ou absolue des choses, et, seuls, ont le droit d’exister. Toutes les impulsions de la nature physique de l’homme qui le portent à l’erreur, au vice et à l’injustice, ne lui sont donc pas vraiment propres ». Et encore : « L’homme n’est libre moralement qu’autant qu’il se porte au bien; au contraire, il cesse d’être libre quand il se laisse entraîner au mal » (3).
Cette pensée résume admirablement, me semble-t-il, les observations psychanalytiques que j’ai essayé d’exposer ici. Quand un être commet des actes mauvais et nuisibles, il agit toujours « à faux » par rapport à l’ensemble de sa personnalité et en fonction seulement d’automatismes inconscients ou d’impulsions peu conscientes qui sont, comme nous l’avons vu, des éléments isolés du moi. Lorsque ce même être se transforme par une prise de conscience progressive, il ne cesse pas pour autant d’être déterminé, mais les mobiles qui le dirigent émanent d’un sentiment profond de son unité et il tend toujours davantage à conformer sa conduite à la totalité de son moi, orienté vers une fin qui le dépasse.
Germaine GUEX.
Notes
(1) L. BRUNSCHVICG, Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale. Alcan, 1927, t. II, p. 744.
(2) H.-L. MIÉVILLE, Vers une philosophie de l’Esprit ou de la Totalité. Ed. des Trois Collines, Lausanne, 1937.
(3) Esquisses de philosophie critique (Paris, Alcan, 1930), p. 72.

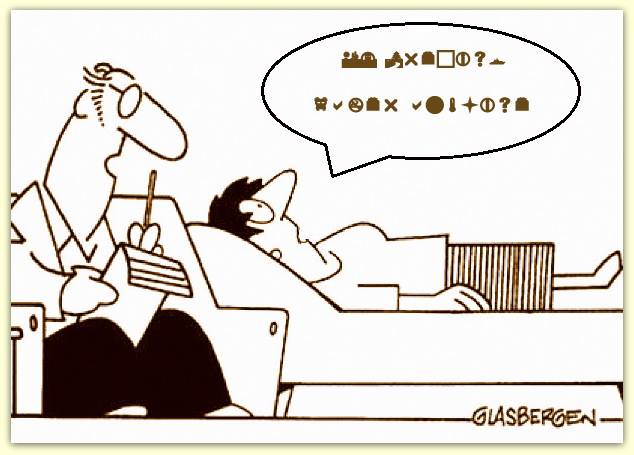

LAISSER UN COMMENTAIRE