Léon Marillier. Etude de quelques cas d’hallucination observés sur moi-même. Article parut dans la « Revue philosophique de la France et de l’Etranger » (Paris), tome XXI, février 1886, pp. 205-214.
Léon-Louis)Marie Marillier (1862-1901). Philosophe et historien. Créateur, vec Charles Richet et Théodule Ribot, de la Société de psychologie physiologique en 1885 et de la Soucié de psychologie l’année de son décès. Outre des très nombreux articles, traductions, en particulier l’ouvrage de Gurney, Myers et Podmore, Les hallucinations télépathiques, de préfaces, nous avons retenu ces deux ouvrages et une introduction :
— La suggestion mentale et les actions mentales à distance. Article paru dans la « Revue Philosophique de la France et de l’Étranger », (Paris), douzième année, tome XXII, janvier à juin 1887, pp. 400-422. [en ligne sur notre site]
— La liberté de conscience, rapport présenté au nom du jury du concours sur la liberté de conscience, Paris, Armand Colin, 1890, 280 p.
— La sensibilité et l’imagination chez Georges Sand, Paris, H. Champion, 1896, 118 p.
— Introduction à l’ouvrage de A. Lag. Mythes, cultes et religion (1896).
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr
[p. 205]
ÉTUDE DE QUELQUES CAS D’HALLUCINATIONS OBSERVÉES SUR MOI-MÊME
On a beaucoup discuté sur l’hallucination, sur les analogies et les différences qui existent entre elle et la perception. On n’a guère d’observations faites par les observateurs sur eux-mêmes avec quelque précision ; presque toujours en effet les troubles sensoriels sont accompagnés d’autres troubles psychiques, de troubles intellectuels surtout, qui ne permettent pas à ceux qui les éprouvent de décrire avec exactitude et d’étudier scientifiquement les phénomènes dont ils sont les sujets.
On en est donc réduit d’ordinaire à étudier du dehors un phénomène qui par essence est un phénomène interne ; on ne saurait en avoir ainsi qu’une connaissance incomplète. À plusieurs reprises, j’ai eu des hallucinations de divers sens, j’ai pu étudier le phénomène à loisir et le regarder de son vrai point de vue, je veux dire, du dedans : aussi les faits que j’ai pu observer sont-ils, à ce qu’il me semble, de nature à éclaircir la question.
Mes hallucinations m’ont laissé des souvenirs qui sont au nombre des plus vifs et des plus précis que j’aie conservés. Les idées et les sentiments que j’ai eus au cours de ma vie forment une trame d’événements internes qui donnent à ma conscience sa forme et son contenu, et ces sentiments, ces idées, même quand j’ai cessé de les sentir ou de les accepter, c’est à moi comme sujet que je les rapporte. Il y a un ordre entre les souvenirs que j’ai gardé des événements de ma vie intérieure, ils forment une chaîne et, s’il y manque des chaînons, je sais que c’est aux lacunes de ma mémoire qu’il faut m’en prendre ; je m’aperçois que ces lacunes existent, et les souvenirs de mes amis peuvent me servir à les combler. Chacune de mes idées, chacun de mes sentiments vient se placer à un moment déterminé de ma vie, et les événements extérieurs eux-mêmes, d’après l’époque où ils se sont produits, se sont reflétés dans mon esprit avec des couleurs différentes qui me permettent de les situer dans le temps avec quelque précision.
Les souvenirs que j’ai gardés de mes hallucinations sont nettement séparés de tous les autres, ils ne sont point liés entre eux, ni aux autres événements de ma vie psychique ; ils forment des groupes distincts, isolés de toutes les idées, de tous les sentiments, de toutes les images qui les avoisinent ; je n’ai aucune raison pour placer les phénomènes dont ils sont les traces à tel ou tel moment de ma vie psychique et ce n’est que leur coïncidence avec tel ou tel événement extérieur qui me permet de les situer en un point déterminé du temps. Il me faut un effort pour me considérer comme le sujet de ces phénomènes, tant est grande l’incohérence qui existe entre eux et tous les autres événements de ma vie mentale.
Il semble qu’il y ait en moi quelque chose qui ne m’appartienne pas, qui me soit étranger, que parmi les états de conscience qui constituent [p. 206] ma pensée, il y en ait qui ne soient pas réellement mes états de conscience. Si je n’avais pas des preuves nombreuses et extérieures aux faits mêmes que je vais rapporter de la réalité des hallucinations que j’ai éprouvées (notes prises au moment même, circonstances extérieures qui m’ont frappé et dont j’ai gardé le net souvenir, fréquentes conversations avec des amis, où j’ai discuté la nature et les causes de ces phénomènes), si je n’étais pas sûr pour les raisons que j’ai dites de les avoir bien réellement observées en moi telles que je vais les décrire, je croirais que ma mémoire est infidèle et que je suis le jouet d’une illusion ; je serais persuadé que je me suis imaginé après coup avoir été le sujet de ces phénomènes, mais que c’est là une erreur, tant ces souvenirs me semblent faire peu partie du train habituel de ma vie intérieure. On éprouve un sentiment analogue lorsqu’après un très vif chagrin qui vous a jeté hors de vous-même, l’on se ressaisit et que l’on se retrouve ce que l’on était avant de traverser cette crise : les sentiments qui ont été les vôtres pendant cette période vous sont devenus comme étrangers ; c’est une impression du même genre, et plus vive encore, que l’on ressent quand on relève d’une maladie grave. L’impression que j’éprouve, c’est que ce n’est pas de moi qu’il s’agit, que j’ai lu ce que je vais raconter, ou plutôt que j’ai vu au théâtre un personnage qui percevait et sentait ce que j’ai perçu et senti, que j’ai assisté à sa vie sans qu’elle se mêlât à la mienne et que c’est d’elle que je vais parler. Au moment même où j’étais le sujet de ces hallucinations, elles m’impressionnaient parfois assez vivement et n’étaient pas pour ma sensibilité comme des étrangères, mais j’avais la très nette conscience de vivre de deux vies, qui se développaient l’une à côté de l’autre sans se mêler ; je rapportais également à moi les perceptions normales et les perceptions hallucinatoires ; elles coexistaient, je les distinguais cependant, ce qui me donnait presque irrésistiblement l’impression d’une sorte de dédoublement de ma personne.

Mathias Grünewald (né vers 1475-1480 – mort en 1528). – The Temptation of Saint Anthony (détail) 1515.
Voici maintenant les faits :
En 1875, je passais les vacances chez ma grand’mère à la campagne. On avait dansé le soir au salon. Il y avait environ une heure et demie ou deux heures que je dormais, quand je me réveillai subitement ; je vis devant moi une grande lueur, puis le salon où nous avions passé la soirée m’apparut, vivement éclairé ; deux ou trois couples dansaient ; leur danse, lente d’abord, devint plus rapide. L’un des danseurs s’empara du piano et se mit à valser avec lui. Je voyais très nettement toute cette scène, et cependant j’avais clairement conscience d’être dans ma chambre située à l’autre bout de la maison. Mon frère et un de mes amis couchaient dans la même chambre que moi ; je leur dis ce que je voyais. Encore très jeune alors, je compris mal ce qui s’était passé, mais d’une part j’étais assuré que ce que j’avais vu ne correspondait à rien de réel et d’autre part je savais très bien que j’étais éveillé et que je n’avais pas rêvé. Mon frère alluma une bougie et tout disparut. Il m’avait semblé être dans la pièce même que j’avais devant mes yeux ; j’avais vu [p. 207] les meubles, les tableaux à leur place habituelle, et je n’aurais guère pu distinguer cette perception d’une perception réelle, si je ne m’étais aperçu en même temps que j’étais dans mon lit et que mon frère et son ami que je voyais devant mes yeux, dansant et causant avec d’autres personnes, étaient eux aussi couchés auprès de moi.
Depuis lors, j’ai eu fréquemment des hallucinations de la vue, de l’ouïe et du toucher ; je ne rapporterai que les plus caractéristiques, celles dont le souvenir m’est resté très précis et très vivant.
Ma famille habitait les environs d’Autun ; c’est un pays de forêts et de landes ; je passais une grande partie de mes journées à courir à travers les genêts et les bruyères, et parfois je voyais passer devant moi d’immenses lueurs et le Christ vêtu de blanc, entouré d’un nimbe, apparaissait à mes yeux ; je ne le voyais qu’un instant, puis tout disparaissait.
Au mois de septembre 1877, toutes les fois que j’entrais sous bois, je voyais devant moi à quelque distance une jeune femme blonde, vêtue de blanc, couronnée de feuilles vertes, qui me regardait ; elle marchait devant moi et se retournait de temps à autre pour me dire ce seul mot : « Viens. » Souvent je l’ai suivie des heures entières ; j’avais conscience de n’avoir devant moi qu’un fantôme que j’avais créé moi-même ; la grâce, le charme puissant et doux de cette forme légère qui me guidait à travers la forêt m’entraînait à ne pas lutter contre moi-même et à ne pas faire usage d’une trop sévère critique. Peut-être aurais-je réussi à dissiper cette vision, si j’avais réagi fortement ; j’en doute un peu cependant, tant est grande la netteté avec laquelle, à huit ans de distance, je revois encore ses mouvements, sa façon de marcher, son geste quand elle s’arrêtait et se tournait vers moi. Je retrouvais dans cette jeune femme quelques traits d’une amie plus âgée que moi que j’aimais d’une ardente amitié (cette amitié n’était pas de l’amour, j’avais quatorze ans à peine) mais ce n’était pas elle cependant. Cette hallucination persista trois semaines environ ; dès que j’entrais sous bois, je voyais apparaître cette femme vêtue de blanc ; elle me quittait dès que je quittais la forêt.
Au mois de janvier 1881, débuta une hallucination fort complexe, la plus intense et la plus nette de toutes celles dont j’ai gardé le souvenir, et qui persista jusque vers la fin du mois de février. J’étais alors étudiant à la Faculté des lettres de Dijon. J’avais eu beaucoup de soucis et d’ennuis ; des déceptions de toute sorte, des chagrins de famille, des préoccupations d’argent m’avaient attristé et ébranlé très fortement ; j’avais beaucoup souffert du cœur (palpitations, spasmes, douleurs aiguës à la pointe du cœur), et le travail continu auquel je m’étais soumis m’avait fatigué si profondément qu’il m’était devenu pénible de causer et d’agir ; jamais, en revanche, ma pensée n’a eu plus de clarté et n’a été plus complètement maîtresse d’elle-même. Le soir, vers neuf heures, quand j’étais assis à mon bureau, j’entendais ouvrir la porte de mon antichambre, celle de ma chambre ; on traversait ma chambre, [p. 208] j’entendais le bruit des pas sur le plancher, le frôlement d’une jupe. Quelqu’un se penchait sur moi ; je sentais son haleine sur ma joue, sa main qui s’appuyait sur mon épaule, parfois ses cheveux qui me frôlaient le visage, ses vêtements qui me touchaient. C’était une jeune femme, celle-là même dont j’ai parlé plus haut ; mais cette fois c’était bien elle ; je n’aurais pu, je crois, distinguer, autrement que par sa situation, l’image hallucinatoire de l’image réelle si je les avais perçues toutes deux à la fois. Je voyais clairement les traits de son visage et les détails de ses vêtements, je sentais l’odeur qui s’exhalait de sa personne et que je n’aurais pas confondue avec une autre ; puis elle se relevait, me parlait, je voyais remuer ses lèvres, je reconnaissais le timbre de sa voix ; elle me parlait de ce dont nous causions à l’ordinaire, et l’illusion était si complète que, plus d’une fois, je me surpris à lui répondre. Elle me tendait alors la main, je sentais le contact de sa main, la douceur de sa peau, sa chaleur ; je serrais cette main, et je sentais une résistance à ma pression ; j’avais donc une hallucination du toucher actif. Is… s’écartait alors un peu de moi, elle se plaçait devant un fauteuil de ma chambre qu’elle me cachait, et sa tête me cachait aussi une partie d’une gravure pendue au-dessus du fauteuil ; mon hallucination faisait donc écran comme un corps opaque. Je voyais à la fois le mur de ma chambre et la personne qui était placée devant, et il m’était impossible de saisir aucune différence de netteté ou d’intensité entre ces deux perceptions, l’une réelle, l’autre hallucinatoire. Je continuais à travailler (je m’occupais alors de l’étude philologique des Perses d’Eschyle), et lorsque je levais les yeux de dessus mon livre, je voyais Is… immobile à la même place où je l’avais vue un instant auparavant. Puis je cessais de la voir, sans que j’aie jamais pu saisir le moment précis où elle disparaissait.
Cette hallucination s’est reproduite plusieurs fois par semaine, pendant près d’un mois et demi. Pendant tout le mois de mai, je vis sans cesse, voltigeant chez moi, se posant sur ma table, fuyant sous mes doigts, une plume d’autruche blanche, l’une de ces plumes que les femmes portent sur leurs chapeaux. Au mois de juin, après avoir regardé longtemps le ciel embrasé par le soleil qui se couchait au milieu, de nuages de sang, je vis en rentrant chez moi, dans une chambre un peu sombre, plusieurs des Dieux scandinaves couverts de leurs armes se dressant au milieu de flammes rouges et vertes. En même temps, un immense dragon vert, les ailes étendues, me mordait la nuque ; je sentais sa morsure et son poids, et je le voyais, bien qu’à la place qu’il occupait, il m’eût été impossible de percevoir une image réelle. J’étais avec un ami quand j’eus cette hallucination.
Je partis au mois d’août pour l’Allemagne. Je m’installai chez des amis à Heidelberg ; je souffris beaucoup du cœur pendant quelques jours, et j’eus un peu de jaunisse ; de nouveaux phénomènes hallucinatoires se produisirent. Je transcris ici ce que j’ai écrit au cours de l’une de ces hallucinations : [p. 209]
« Heidelberg, 27 août 1881.
La pluie tombe fine et serrée, le ciel est d’un gris uniforme pâle et doux ; sur les montagnes traînent des nuages qui s’accrochent aux arbres comme des draperies en lambeaux ; pas un rayon de soleil ; des enfants qui jouent dans le corridor, le bruit des portes qu’on ouvre et ferme, et c’est là tout. Ma vie jamais cependant n’a été plus pleine, jamais je n’ai senti avec une telle intensité. Seul à savoir le français comme langue familière, ne parlant ni l’anglais ni l’allemand, je suis isolé ici, volontairement isolé du reste ; j’ai besoin d’être seul et pourtant, seul avec moi-même, j’étouffe ; c’est une insurmontable tristesse qui me monte à la gorge et me met les larmes aux yeux ; hier du moins, dans cette fête de lumière, je pouvais m’échapper à moi-même ; un nuage de pourpre, une douce teinte verdâtre d’un coin du ciel qu’un rayon d’or vient traverser sont assez vivants, assez réels pour qu’on s’absorbe en eux et qu’on oublie. Mais aujourd’hui rien : cette angoisse me saute à la gorge et m’enfonce ses crocs dans le cou. Il me semble parfois qu’un homme me plonge la main dans la poitrine pour me serrer le cœur de ses doigts ; je le sens, je le vois. Puis il s’assoit en mon cerveau pour en faire l’inventaire, il secoue chaque cellule ; comme il est content de ses découvertes ! il entasse autour de lui celles qui lui plaisent : c’est si beau une cellule du cerveau qui renferme une sensation nouvelle ! Puis il jongle comme avec des grelots, et il faut le laisser faire. Si je lui dis de sortir, il a tôt fait de me saisir le cœur et de le presser plus fort. Je lutte bien alors, mais que faire ? il est mon maître. Je voudrais me délivrer, ne plus réfléchir, ne plus me disséquer ainsi ; j’essaie, je veux rire, mon rire est une grimace ; je marche toujours, lancé droit devant moi, et toujours il me faut me torturer, supplier mon bourreau de me faire plus souffrir et aller avec ce loup pendu à ma gorge qui ballotte devant moi… Je suis seul et, comme un arc tendu, je vibre sans cesse ; je n’ai plus qu’une sensation immense, infinie : toutes les autres s’y ajoutent, la grandissent ; je suis seul et j’ai froid au cœur, et mon esprit est toujours clair, plus aigu, plus tranchant : c’est comme un scalpel qui fouille dans ma chair saignante, mais elle ne saigne plus que par une blessure, elle est tout entière cette blessure. Jamais je n’ai senti si fort ; je vis dans une demi-hallucination, je ne puis plus trouver mes mots pour parler ; il faut que je m’échappe, je ne puis plus me supporter me torturant ainsi. Si l’on ne réagissait pas, vivant seul, une telle angoisse au cœur, on sentirait sa raison s’ébranler. »
J’ai tenu à citer cette page tout entière pour bien faire comprendre l’étrange état de sensibilité où j’étais alors ; je n’ai, je crois, jamais eu d’hallucinations qui m’aient donné plus complètement l’impression d’être des perceptions vraies. L’illusion était parfois si complète, qu’instinctivement j’écartais de la main le corps de ce loup qui pendait à ma gorge et me gênait pour marcher. Je voyais clairement l’intérieur de mon cerveau, comme si mes yeux avaient été retournés et avaient pu [p. 210] regarder dans mon crâne ; c’est encore un exemple de ces localisations visuelles impossibles dont j’ai parlé plus haut. La sensation morbide fondamentale était alors cette double impression de chatouillement, de démangeaison à la tête et d’oppression du cœur. C’est autour d’elle que je groupais toutes mes perceptions ; elle devenait l’objet unique de mon attention, du travail de ma pensée ; je m’ingéniais à l’expliquer, à lui trouver une cause, et cette tension intellectuelle provoquait des perceptions hallucinatoires. Toute autre activité m’était devenue difficile. Cette sensation régnait en maîtresse sur ma volonté et mon intelligence, et je me reprochais comme une faute de ne pouvoir me soustraire à cette obsession. Je cherchais à causer littérature ou politique avec les personnes qui m’entouraient, j’affectais un profond intérêt à ce que je disais, et cependant il me semblait que c’était un autre qui parlait : le moi, sujet de mes hallucinations, était bien près alors de devenir mon moi véritable. Mon esprit était infécond, stérile, aucune idée nouvelle n’y pouvait germer ; je souffrais beaucoup et cependant ma souffrance me laissait presque indifférent. Cette apathie intellectuelle, ces sensations exaspérées et tant de détachement des douleurs que j’éprouvais, cette incapacité à me fixer sur un objet, à concentrer mon esprit, accusaient une profonde dépression de la volonté. Cette volonté fut cependant assez forte pour que j’aie essayé de me guérir. De longues courses à travers bois, qui me fatiguèrent beaucoup, parvinrent à me rendre à moi-même ; et dès que ma santé se fut un peu raffermie, les hallucinations disparurent et, avec elles, disparut aussi cet étrange état de ma sensibilité. Pendant cette période, il me sembla voir une fois le cimetière de la ville, les morts dans leurs cercueils et les vers qui les dévorent ; ce fut une sorte de vision, un tableau qui passa rapidement devant mes yeux et qui n’avait pas le caractère de réalité vivante des hallucinations que j’ai rapportées. Au mois de novembre de la même année, je revis encore, pendant une soirée que je passai seul à la campagne en Beaujolais, le vieux château de Heidelberg passer devant mes yeux avec tout un cortège d’étranges visions très peu cohérentes que j’ai du reste notées. Depuis lors, je n’ai plus eu d’hallucinations très nettes ; parfois encore, je vois des lueurs, j’entends des craquements, des bruissements, je sens en moi ce sentiment d’attente anxieuse qui précède d’ordinaire l’apparition d’une hallucination ; mais rien ne paraît : l’hallucination est réduite avant même qu’elle ait eu le temps de se produire. Je ne crois pas à vrai dire que cela tienne à ce que je dispose de réducteurs plus puissants des images hallucinatoires, mais tout simplement à ce que ces images sont moins intenses.
Je puis diviser les hallucinations que j’ai éprouvées en trois classes : 1° les interprétations inconscientes de sensations morbides, interprétations qui provoquent l’apparition d’images visuelles, d’images tonales, de sensations tactiles qui sont aussitôt objectivées (le loup qui me pendait à la gorge, l’homme qui me plongeait la main dans la poitrine, etc.) ; 2° les visions, je veux parler de ces hallucinations très rapides [p. 211] que je localisais sans précision, et qui passaient rapidement devant moi, un peu comme les images d’une lanterne magique ; elles ont beaucoup d’intensité, mais les contours ont moins de netteté et les figures moins de relief que dans les autres hallucinations ; ce sont toujours des hallucinations visuelles et toujours très lumineuses (les apparitions du Christ, le cimetière de Heidelberg, etc.) ; les caractères de cette classe d’hallucinations sont à peu près ceux des hallucinations hypnagogiques ; 3° les hallucinations véritables que l’on ne saurait, par des caractères intrinsèques, distinguer des perceptions réelles (la femme vêtue de blanc, Mlle Is… G., la plume d’autruche, etc.). C’est à cette classe que se rapportent les hallucinations du toucher actif.
Les hallucinations des divers sens ne créent pas en nous des tendances de même intensité à croire à la réalité de leurs objets. On peut les classer à ce point de vue dans l’ordre suivant : ouïe, vue, toucher passif, toucher actif. Les hallucinations du toucher actif ne permettent pas de douter de la réalité de leur objet ; ce n’est seulement que lorsqu’elles ont cessé (elles ne durent qu’un instant très court) que la réflexion est capable de distinguer entre elles et les perceptions vraies. Cette distinction ne repose du reste sur aucun caractère intrinsèque des perceptions ou des hallucinations. Les hallucinations qui donnent avec le plus d’intensité l’impression d’être vraies sont les moins persistantes ; l’ordre dans lequel disparaissent les hallucinations est d’ordinaire l’ordre inverse de celui que nous venons d’indiquer. Il m’est possible, dans certaines conditions, de provoquer chez moi des hallucinations ; mais ce ne sont jamais que des hallucinations de l’ouïe et de la vue.
On peut diviser en trois classes les hallucinations de la vue que j’ai éprouvées : 1° Les unes sont localisées comme le seraient des perceptions vraies ; elles sont situées à la distance et dans la direction où je situerais l’objet d’une perception normale ; 2° d’autres hallucinations (les visions) ne peuvent être localisées avec précision ; leurs rapports de position avec les objets réels m’échappent (ces objets, du reste, disparaissent d’ordinaire pour moi quand j’éprouve des hallucinations de cette nature) ; je ne pourrais indiquer ni la place de l’image que j’ai objectivée, ni la distance à laquelle elle se trouve ; cela tient peut-être à leur très courte durée, à la rapidité avec laquelle elles me passent devant les yeux et à leur grande intensité lumineuse, qui efface les couleurs de tous les objets avoisinants ; 3° une troisième classe d’hallucinations (ce sont d’ordinaire des interprétations inconscientes de sensations morbides) est caractérisée par ce fait que l’image hallucinatoire est extériorisée en un point où un objet réel ne saurait être perçu. J’ai vu ainsi des objets ou des parties de mon corps qu’il m’eût été impossible de voir en raison des conditions physiques de la vision, si j’avais eu affaire à des objets réels donnant naissance à des perceptions vraies, au lieu d’être le sujet de perceptions hallucinatoires que je localisais faussement par une fausse interprétation inconsciente. J’ai vu un dragon me mordant la nuque, comme je l’ai mentionné plus haut, et je ne [p. 212] voyais pas ma tête devant moi comme un objet extérieur, mais elle était située à sa vraie place – dans ses rapports habituels de position avec les autres parties de mon corps : je percevais par des sensations musculaires et tactiles sa place exacte, et, cependant, je voyais sa partie postérieure comme si j’avais été moi-même placé derrière moi. Je rappellerai aussi cette vue très nette de mon cerveau que j’ai eue à Heidelberg. L’image, très certainement, devrait être située à une certaine distance en avant de l’œil ; si elle est localisée en arrière de l’œil, en un point d’où il ne peut parvenir à l’œil aucun rayon lumineux, c’est que les sensations musculaires et tactiles que j’éprouvais étant rapportées au point où j’aurais rapporté normalement ces sensations, je rapportais au même point, par une sorte de confusion, l’image visuelle qu’elles provoquaient et dont je concevais l’objet comme cause de ces sensations. Si j’osais risquer une explication, je dirais qu’étant donné que nous extériorisons toujours les sensations d’origine périphérique, il est naturel qu’éprouvant à la fois deux sensations, l’une provenant d’une excitation pathologique des centres sensoriels, l’autre d’origine périphérique, il est naturel, dis-je, que nous rapportions les deux sensations au point où nous aurions rapporté la sensation périphérique, puisque nous n’avons aucune habitude depuis longtemps acquise qui nous permette de localiser en un point précis une sensation centrale.
Je n’ai jamais pu déterminer aucun caractère intrinsèque qui permette de distinguer une hallucination complète (exemple : la femme vêtue de blanc, etc.), d’une perception vraie. Les seuls réducteurs de l’image hallucinatoire que j’ai pu déterminer sont les suivants : 1° la courte durée de l’hallucination, sa disparition brusque, comparée à la persistance des perceptions normales ; 2° nous continuons à percevoir un objet réel tant que les conditions grâce auxquelles nous pouvons le percevoir subsistent, tandis que l’hallucination disparaît brusquement, sans qu’aucun éloignement ou déplacement de l’objet nous ait prévenu de sa disparition prochaine. C’est un fait intéressant à noter que les hallucinations n’apparaissent pas d’ordinaire d’emblée, mais qu’elles se développent et grandissent, se rapprochent peu à peu, tandis qu’elles disparaissent toujours brusquement ; 3° l’incohérence des sensations ou des séries de sensations hallucinatoires avec les sensations normales ; 4° leur incohérence avec nos souvenirs ;. 5° l’impossibilité de faire percevoir à autrui ce que nous percevons nous-mêmes ; 6° le jugement abstrait. Exemple : je vois une personne que je sais avec certitude être à 200 kilomètres de moi ; je sais qu’elle ne peut être là, je ne crois pas à ma perception ; 7° la comparaison entre ces hallucinations identiques aux perceptions vraies et les hallucinations qui s’en distinguent à quelque degré, dont j’ai parlé plus haut. Les localisations absurdes aident beaucoup à séparer les unes des autres les perceptions réelles et les perceptions sans objet.
Les hallucinations sont d’ordinaire précédées chez moi par un sentiment d’angoisse, d’attente inquiète ; je suis en proie à la terreur vague, [p. 213] indéfinie de l’instant d’après. Pendant l’hallucination, ce sentiment disparaît pour faire place à d’autres sentiments très divers, agréables ou pénibles, et qui eux dépendent de la nature des hallucinations. Lorsque les hallucinations sont très nombreuses et très persistantes, surtout lorsqu’il se produit des hallucinations du toucher et de la sensibilité générale, il se crée un état de sensibilité tout spécial qui correspond aux perceptions hallucinatoires et qui est fort différent de l’état de sensibilité qui correspond aux perceptions vraies. Ces sensations anormales ne font pas sur le moi la même impression que les autres sensations ; elles ne provoquent chez moi ni des sentiments, ni des actes qui soient semblables à mes sentiments et à mes actes habituels. Mais ma vie psychique ordinaire subsiste néanmoins à côté de cette vie nouvelle ; de là l’impression qui se crée très vite dans mon esprit, de deux moi qui coexistent dans ce même individu, sans se mêler, sans presque communiquer l’un avec l’autre, mais qui se regardent l’un l’autre sentir et penser. Les perceptions hallucinatoires et les sentiments qu’elles provoquent forment un tout plus ou moins cohérent ; les sentiments et les idées de la vie normale en forment un autre beaucoup plus un et plus cohérent, distinct du premier. Si les facultés abstraites de l’esprit sont atteintes à leur tour, on en viendra non plus à se représenter soi-même à soi-même comme étant deux, mais à croire que réellement et en fait l’on est deux. D’ordinaire, le moi hallucinatoire est d’une couleur plus sombre que le moi normal qui souffre de son voisinage, qui serait heureux de se défaire de lui et ne peut y réussir ; on passe aisément à l’idée délirante qu’un autre s’est emparé de vous et vous possède. L’attention attirée sur ce point, l’on reconnaîtra facilement dans ce moi malveillant quelques traits vagues, que l’on rendra plus précis par l’attention avec laquelle on les examine, du caractère d’un homme que l’on craint ou que l’on hait, ou qui a pris sur vous plus d’influence que vous ne l’auriez désiré ; et l’on arrivera à se croire possédé par tel individu déterminé. Cela n’est point étonnant, si l’on songe que ce que nous font voir nos hallucinations, c’est ce que nous avons dans l’esprit et que, par conséquent, il nous est très naturel de doter notre moi hallucinatoire des traits de caractère et des façons de sentir qui nous sont familiers.
Les conditions qui favorisent chez moi la production des hallucinations sont la solitude, l’alimentation insuffisante, la privation de sommeil, les douleurs nerveuses du cœur, l’extrême fatigue physique, la très grande tension intellectuelle.
Un homme cultivé et réfléchi, tant que ses facultés intellectuelles resteront intactes, ne croira pas à ses hallucinations, bien qu’elles n’aient pas en elles-mêmes de caractères qui permettent de les distinguer des perceptions vraies. La croyance à l’objectivité d’une hallucination provient d’une induction mal faite, d’une erreur de jugement. Les causes de cette erreur peuvent être fort diverses. Ce qui produit la croyance, c’est la durée et la cohérence de nos perceptions ; le rôle de notre jugement est d’apprécier cette cohérence et cette durée. S’il en [p. 214] est incapable, soit par suite d’un état morbide des centres d’idéation, soit par défaut de culture (c’est le cas du paysan qui croit à l’apparition qu’il a vue), l’esprit croira à la réalité objective des images qu’il a perçues. Je ne sais pas au reste comment il serait possible de distinguer des perceptions vraies un groupe d’hallucinations qui seraient aussi cohérentes et aussi persistantes que les perceptions elles-mêmes. Je crois que le seul critérium dont nous disposerions alors serait que nous pouvons agir sur les objets de nos perceptions, tandis que nous ne saurions avoir aucune action sur les images hallucinatoires que nous avons objectivées.
Léon Marillier

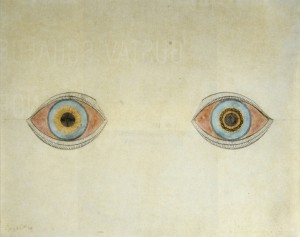

LAISSER UN COMMENTAIRE