 Docteur Albert Prieur. Essai sur le la psychologie du dépeçage criminel. Article parut dans la revue « Mercure de France », (Paris), tome XXXVIII, avril juin 1901, pp. 289-319.
Docteur Albert Prieur. Essai sur le la psychologie du dépeçage criminel. Article parut dans la revue « Mercure de France », (Paris), tome XXXVIII, avril juin 1901, pp. 289-319.
Nous savons très peu de chose d’Albert Prieur, sinon qu’il fut collaborateur France Médicale, et un des fondateurs de la Société d’Histoire de la Médecine en 1902. Nous avons retenu de ses autres publications :
— Criminologie Le péril de l’heure, par M. le docteur Albert Prieur. Le Gaulois, littéraire et politique (Paris), 1868.
— La science et le théâtre, de l’Évasion aux Avariés, Mercure de France, décembre 1901.
— La science et le théâtre, Mercure de décembre 1901
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. — Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. — Par commodité, nous avons renvoyé les notes de bas de page en fin d’article. — A part la première et la dernière gravure, les images ont été rajoutées par nos soins. — Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr
[p. 289]
ESSAI SUR LA PSYCHOLOGIE
DU
DÉPECAGE CRIMINEL
Bien peu de gens commettent un assassinat par des principes philanthropiques ou patriotiques, et je répète ce que j’ai dit une fois déjà au moins : pour la majeure partie des assassins, ce sont des personnages tout à fait incorrects.
(THOMAS DE QUINCEY, De l’Assassinat considéré comme un des beaux-arts.)
— Voyons, mon cher Maître, il serait peut-être temps de laisser de coté, dans les travaux futurs, cette habitude qui consiste à donner comme préambule à toute étude sur le dépeçage criminel, celle du dépeçage religieux, du dépeçage guerrier et du dépeçage judiciaire ? Les uns conservent cette évocation préalable pour montrer les premiers anneaux d’une chaîne ininterrompue, pour relier le présent au passé, pour prouver que le dépeçage criminel d’aujourd’hui est l’aboutissant ou le reliquat des [p. 290] dépeçages d’autrefois, — les autres pour montrer la ressemblance qui existe entre ceci et cela, et pour, en fin de compte, après bien des pages inutiles, conclure qu’après tout les manifestations actuelles n’ont peut-être rien à voir avec les coutumes du passé… Qu’en pensez-vous ?
Et je m’adressais ainsi, un matin de février dernier, au très érudit et très excellent professeur Lacassagne qui avait bien voulu me consacrer quelques moments de son court séjour à Paris. Le feu flambait, bien que la matinée fût ensoleillée ; et, assis en d’hospitaliers fauteuils aux deux coins de la cheminée, nous devisions de ces choses et de bien d’autres, au fil de l’heure qui coulait.
— Je pense que vous avez raison, répondit M. Lacassagne, et pourtant je dois vous avouer que j’ai coutume, à Lyon, de suivre ces errements, et de montrer ainsi le dépeçage sous son triple aspect. La question me semble alors complètement fouillée, et les élèves mieux documentés…
— Mais ne craignez-vous pas qu’on puisse penser à trois étapes différentes d’une même évolution ? Et, à mon avis, cette erreur serait d’autant plus dangereuse que vous êtes le seul qui ayez consacré à cette question de notables écrits, que ceux qui l’ont traitée après vous sont, vos élèves, et qu’ainsi il n’est pas dans la littérature scientifique d’autre opinion que la vôtre pour faire comprendre leur erreur à ceux qui auraient mal interprété votre enseignement…
M. Lacassagne ne parut pas croire que pareille erreur pût se commettre et que des esprits fussent assez étourdis pour faire une confusion à laquelle il ne s’était jamais prêté. Je n’insistai pas, et la conversation évolua doucement vers un autre sujet. [p. 291]
« Le dépeçage n’est pas une invention toute moderne des criminels et des plus habiles d’entre eux, destinée à faciliter la disparition d’un cadavre devenu compromettant pour celui qui en est le détenteur. En étudiant l’histoire, on est étonné de voir que les mêmes procédés que les criminels emploient depuis déjà fort longtemps… l’ont été de tout temps, soit par les prêtres, soit par les chefs d’État, tantôt dans un but politique ou judiciaire, et tantôt dans un but religieux. L’étude des différentes sortes de supplices adoptés par les peuples anciens depuis la formation des sociétés, et celle des sacrifices de tous genres faits en l’honneur de la divinité depuis les temps le plus reculés jusqu’à nos jours, montrent qu’il ne s’agit le plus souvent que d’un dépeçage qui, bien qu’ordonné par des juges ou par un prêtre, a plus d’un point de ressemblance avec celui qui est aujourd’hui l’apanage des grands criminels (1). »
J’ai souligné à dessein certaines parties du préambule du travail de M. Ravoux, car je crois qu’il n’est pas possible de trouver en si peu de lignes· deux erreurs plus évidentes. C’est un peu àce passage, d’ailleurs, que je faisais allusion dans ma conversation de tantôt avec M. Lacassagne, dont M. Ravoux fut l’élève.
Et, d’autre part — chose curieuse — je ne sache pas qu’il soit d’erreurs plus amplement réfutées par la série des documents qui s’échelonnent au long de ce même travail.
Entre le Phénicien Hillu, qui, 2000 ans avant [p. 292] notre ère, inaugura, paraît-il, les sacrifices humains, en offrant à la divinité les morceaux du corps de son fils ; — entre tous ceux qui depuis lors, aux quatre coins de la terre, voulurent se rendre les dieux favorables en accompagnant leurs cantiques d’offrandes semblables (2) ; entre ceux même qui, comme les Skoptsy, dans des moments d’exaltation mystique, coupent et mangent le sein des vierges (3), ou, comme les indigènes de l’État de Maranhao, vont déterrer des corps d’enfants pour les découper, les assaisonner et en faire des sortilèges, et Billoir, coupant en morceaux le corps de la femme Le Manach, qu’il avait tuée dans un moment de colère en la frappant d’un coup de pied au ventre, y a-t-il Ia moindre connexion, un rapprochement quelconque,
entre ce même Billoir, s’affolant à l’idée de la justice, et tous ceux qui, juges, au nom de la loi, ordonnaient ou encourageaient la mutilation ou le dépeçage des suppliciés, — ou guerriers, au nom des traditions et des coutumes, livraient à leurs soldats, pour s’en faire des trophées, des morceaux de leurs prisonniers : tètes servant d’oriflammes, [p. 293] crânes servant de coupes, chevelures servant de parure, chair pantelante servant aux festins, — y-a-t-il une commune mesure ?
Oui, le couteau.
Mais ce n’est pas assez que la banalité de l’instrument, car entre les acteurs, entre les mobiles, il y a le fossé — large comme un monde — qui sépare l’erreur du crime, la colère de la peur.
Oui, la peur, surtout la peur. Cette peur misérable, oppressante, qui affole le criminel après l’acte accompli, — ou la peur froide, tranquille, raisonnante, qui ordonne de prendre tous les moyens pour échapper au châtiment alors nettement perçu… l’une ou l’autre de ces deux peurs-là, mais non la peur mystique, superstitieuse, religieuse des sacrificateurs humains tremblant devant les dieux et joyeux de leurs massacres ; non la peur du juge dépeceur qui, redoutant la contagion du crime, veut par des raffinements dans le supplice et des outrages au cadavre, arriver à faire respecter la ou sa loi.
Aussi, je ne comprends pas que M. Nina, Rodrigues (4), qui a cependant écrit sur le dépeçage des pages exactes, ait pu affirmer ceci : « Il est maintenant facile de démontrer que le dépeçage religieux et le dépeçage judiciaire, de même que le dépeçage criminel défensif, sont tributaires de la peur. Il est certain que le sacrifice et le supplice impliquent tous deux l’admission d’une croyance animiste qui suppose qu’après la vie terrestre il subsiste quelque chose dont la possession est agréable aux dieux s’il s’agit du dépeçage religieux, et, dans le dépeçage [p. 294] judiciaire, que le cadavre et ses fragments possèdent une animation particulière qui les rend sensibles, même après la mort, aux souffrances infligées. Mais le mobile fondamental du dépeçage religieux est sans aucun doute la crainte de la colère divine ou celle de perdre les bonnes grâces de la divinité, exactement comme dans le dépeçage judiciaire est la crainte de voir renouveler le délit que l’on avait en vue de punir par le dépeçage, qui devrait avoir aussi la propriété de servir d’exemple aux futurs transgresseurs du précepte social offensé. »
Je ne veux pas relever la contradiction flagrante qui existe entre les parties de ce paragraphe, M. Nina-Rodrigues ne paraissant pas comprendre d’une façon précise que, dans le dépeçage religieux, l’idée maîtresse est la valeur du sacrifice d’un vivant, tandis que, dans le dépeçage judiciaire, cette idée maîtresse est le raffinement dans l’outrage à la mort, — mais ce qui est particulièrement regrettable, c’est de lire la phrase qui immédiatement suit : « Le dépeçage social a, dans ce cas, le même caractère défensif que le dépeçage criminel au moyen duquel l’assassin cherche à faire disparaître les preuves de son crime et s’inspire rigoureusement du même sentiment : la crainte du châtiment qui l’attend. »
Il n’y a pas, dans cette phrase, un seul mot qui ne soit une erreur : et cela est d’autant plus surprenant que c’est M. Nina-Rodrigues lui-même qui a eu l’heureuse idée de diviser le dépeçage criminel ordinaire en forme offensive et forme défensive, désignant ainsi, chez le dépeceur, deux mentalités absolument différentes ; il arrive à les confondre ensuite à ce point qu’il range sous la forme défensive le dépeçage judiciaire qui est certainement, avec le dépeçage [p. 295] des foules criminelles, le type du dépeçage offensif : le mobile étant ici la vengeance ou la colère, et là le châtiment.
§
Certes, la division en deux formes de M. Nina-Rodrigues est excellente. Il définit d’ailleurs fort bien la forme offensive :
« La forme offensive est plus ancienne : elle vient directement de l’impulsivité presque réflexe des sauvages et peut actuellement dépendre soit de la haine, cette forme concentrée et ajournée de la colère, soit d’un accès violent, bien qu’indomptable, d’une colère aiguë, où encore d’une impulsivité morbide tout à fait inconsciente selon qu’elle se manifeste chez un individu sain ou chez un malade. A cette forme de dépeçage appartiennent le dépeçage pratiqué par les fous et les épileptiques, le dépeçage vindicatif après lequel le criminel sert en ragoût à son ennemi les restes mutilés d’un être cher, et enfin le dépeçage par les criminels violents qui, non contents d’avoir ôté la vie à leur victime, éprouvent encore de la jouissance à en mutiler le cadavre (5). »
C’est par cette forme offensive que nous pouvons [p. 296] pénétrer dans un coin, isolé, du dépeçage criminel moderne. Si elle offre avec les dépeçages des siècles passés et des peuples encore primitifs quelque accointance, elle diffère autant qu’il est possible du dépeçage criminel ordinaire ; mais elle nous servira tout au moins, par les quelques cas que j’en donnerai rapidement, de transition artificielle pour arriver jusqu’à lui.
Les colères de la foule étant en tous les temps toujours à peu près les mêmes, elle est capable aujourd’hui comme hier de dépecer sa victime et de s’en partager les morceaux. Elle n’a plus comme autrefois, dans les pays dits civilisés, les occasions de terminer de cette façon l’œuvre du bourreau (6) ; elle est obligée d’attendre les émeutes et les révolutions. Alors elle se rattrape. Deux points à noter : le rôle prépondérant de la femme, — et ce fait, aujourd’hui bien connu, que, dans les neuf dixièmes des cas, chacun des individus composant la foule assassine, pris en son, particulier, serait incapable de commettre l’acte auquel il coopère (7).
C’est dans cette catégorie qu’on pourrait ranger le dépeçage guerrier dont M. Nina-Rodrigues a voulu faire, avec raison, à mon a vis, une division particulière. La cruauté mutilante guerrière, chronique chez les peuples non civilisés, mais n’existant chez les autres qu’à l’état de crises aiguës, n’est pas la même que celle de la foule, non pas tant par ses manifestations que par ses origines. Elle dépend de facteurs particuliers, tels, que le patriotisme surexcité et dévoyé, qui ne sont que la déviation momentanée de principes sociaux [p. 297] explicables, et peut revêtir des formes pour ainsi dire raisonnées qui sont le résultat de l’immixtion dans les idées de colère et de vengeance de principes stratégiques au préalable mûris et combinés. Où le dépeçage guerrier présente d’intimes rapports avec celui des foules, c’est lorsque l’on est en présence d’une foule armée plus ou moins organisée, gardant alors ses caractères d’excitabilité propre ; un bel exemple en vient d’être mis en lumière par l’étude écrite il y a quelques jours par M. Matignon sur la révolte des Boxeurs (8).
La haine. — Les cas en sont plus rares qu’on ne croit. Quelques auteurs les ont crus plus nombreux parce qu’ils ne séparaient pas assez, scrupuleusement les cas où la haine avait dicté l’assassinat de ceux où elle avait été assez puissante pour passer à la mutilation et même au dépeçage, toute idée de sécurité personnelle étant écartée par l’assassin.
Il est des cas mixtes, où les deux, sentiments se mêlent.
En 1886, à Barnas, Claude Faure, propriétaire, disparut. On arrêta le frère de la victime, Jean, la femme de celui-ci et le frère de cette femme. Puis on chercha des traces de Claude. On n’avait encore aucun résultat, quand un chien déterra, dans un champ de pommes de terre, « un paquet de chairs velues qui semblaient bouillies et qu’on reconnut pour être les organes génitaux d’un homme (9) ». Les inculpés tirent des aveux. On sut que Jean avait assommé son frère avec une barre de fer, et, aidé de sa femme, descendu le cadavre dans l’écurie. « Il fallait maintenant faire disparaître les traces [p. 298] du crime et le cadavre lui-même. Le concours de de l’agent Planchier (le beau-frère) devenait indispensable, et l’ex-gardien de la paix, faisant appel à ses souvenirs, n’hésita pas à les diriger et à les aider dans leur horrible besogne. Les taches de sang répandues dans l’escalier soigneusement lavées, Jean, muni d’une scie et d’une hache, commence à dépecer le cadavre. « Je ne le couperais pas, je le mangerais, s’écriait-il avec rage… » On fit bouillir les morceaux, etc., etc. Ce que je voulais signaler c’est le cri de Jean ..
Le crime de Monterotondo .présente aussi ce caractère mixte dont je parlais tout à l’heure.
« Les Tozzi tiennent à Monterotondo une boutique de boucherie foraine ; en face sont les Poggi, des concurrents ; entre les deux familles existait une haine héréditaire.
« Dans le courant de l’année 1884, un jeune homme, Menicuccio Poggi, devint amoureux de la cadette des demoiselles Tozzi. Une nuit, le frère de la jeune fille, Antonio Tozzi, attira sous un prétexte Poggi en sa maison. Il le tua, et le lendemain le sang du mort fut vendu au public mélangé avec du sang de mouton. »
Le domestique des Tozzi, qui avait assisté au dépeçage, raconta qu’à ce moment « le père enleva le couteau que tenait son fils, en lui disant : Laisse-moi faire, je vais t’enseigner comment on désarticule les membres. Il se mit à l’œuvre, et le dépeçage avait commencé, quand la femme Tozzi lui arracha à son tour le couteau des mains pour faire subir au mort une dernière mutilation en lui enlevant les parties génitales. »
(A noter ce dernier fait, assez fréquent dans les cas de dépeçages, même purement, défensifs, et [p. 299] qu’on retrouve dans les manifestations les plus publiques des foules ameutées. Les émotions violentes, la colère notamment, ont, chez les femmes, une sorte de retentissement génital qui se manifeste par les mutilations de ce genre. La célèbre scène décrite par Zola, dans Germinal n’a rien d’exagéré. C’est ce même phénomène qui se passe chez certaines femmes prises d’une crise érotique quand elles ont été battues, et qui sont d’autant plus attachées au mâle brutal qu’il les bat davantage : c’est là, le plus souvent, non un cas de passivité exagérée par la peur, mais d’exaspération génitale momentanée succédant à une irritation intense, à un grand effroi… et peut-être même à l’acuité de la douleur physique.)
Le cas des Tozzi vendant au public le sang de leur victime peut être rapproché de celui de José Ramos que rapporte M. Nina-Rodrigues.
Ramos (quand il fut arrêté) se livrait depuis longtemps au commerce de chair humaine. Il attirait chez Iui les personnes sur qui il avait jeté son dévolu, des enfants de préférence, et les invitait à s’asseoir sur une chaise placée sur une trappe à bascule, puis, profitant du moment où les malheureux étaient distraits, il leur assénait sur la tête un énorme coup de hache, faisait jouer la bascule et les précipitait dans le souterrain qui lui servait d’atelier pour son singulier travail. Il dépouillait ensuite les victimes de tout ce qu’elles possédaient et, avec les chairs soigneusement détachées des os, fabriquait des saucisses et des saucissons renommés qu’il vendait à sa nombreuse clientèle (10). »
C’est le dépeçage appliqué au commerce. Nous [p. 300] abordons là une catégorie particulière, heureusement assez restreinte, où le cynisme s’exagère et frôle la pathologie. M. Nina-Rodrigues (11) cite le cas du métis Sol-Porto qui, chargé par son complice de faire disparaître le tronc d’une femme assassinée par, eux, pensa qu’il pourrait arriver à le vendre pour de la viande de porc. « Il promena pendant deux journées son panier dans la ville. Il a été parfaitement établi que, pendant la journée du 18 (12), il est allé offrir son contenu dans une pâtisserie où son offre a été rejetée sans examen ; à la nuit il demanda et obtint la permission de déposer son panier dans une boucherie où il est allé le chercher le lendemain matin. Ce jour-là, après avoir pris des informations dans le but de connaître quelqu’un qui pourrait acheter de la viande de porc, il alla dans un restaurant, discuta du prix avec le restaurateur et conclut le marché. Mais lorsque le panier arriva, le maitre de l’établissement resta atterré en reconnaissant qu’il se trouvait en présence de restes humains et non de viande de porc. »
À côté de ces gens qui, indifférents au scrupule, inconscients des éléments moraux — préjugés ou lois, — frigides aux exigences de la conscience sociale auxquelles, d’un tacite accord, doivent se plier une foule d’incitations individuelles ; — à côté de ces gens, allant jusqu’aux fioritures du crime par manque de réaction morale, par insuffisance de sensibilité, par rétrécissement du champ de compréhension, se placent, avant d’arriver aux fous proprement dits, ceux qui sont sollicités par une exagération de [p. 301] cette même sensibilité qui manquait aux autres, par une durée plus longue — sans intervention de la raison inhibitrice — du réflexe brutal qui caractérise les manifestations excessives de colère et de haine. Parmi eux, figurent à la place d’honneur les dépeceurs qui, voluptueusement, offrent ou font manger à autrui ou mangent eux- mêmes les morceaux de leur victime,
Ou, à notre époque, ces pratiques sont si habilement cachées que la justice les ignore, ou elles n’existent pas — ce qui est bien improbable. Toujours est-il que nous n’en possédons guère de cas exactement rapportés, et que nous sommes obligés de nous contenter des exemples anciens qui pullulent dans l’histoire. Pourtant, M. Pellereau, médecin de la police et des prisons de Port-Louis, en l’île Maurice, commentant une série de quarante-six assassinats commis dans l’île de 187l à 1881, cite, un cas dans lequel, « après que le corps fut littéralement haché, des membres furent servis en curry (13) dans un festin auquel furent conviés des amis ».
D’autre part, Moreau de Tours rapporte qu’à Messine une femme du nom de Tiburzio, âgée de 60 ans, a tué à coups de couteau une nommée Stella, qui lui offrait des fruits qu’elle venait de cueillir. Après l’avoir tuée, elle s’est mise à la mordre férocement, en lui arrachant’des morceaux de chair qu’elle jetait à son chien après les avoir mâchés (14).
C’est bien là le même mouvement — la haine ou la colère — qui se prolonge dans une exaspération [p. 302] suprême pour aboutir à une sorte de vertige dans lequel tous les éléments frénateurs tourbillonnent et s’annihilent : si le dernier geste est fou, le premier est très humain.
Les folies, les voici. Elles s’avancent en une longue théorie qui naît au fond du passé lointain et se perd en silhouettes encore plus touffues dans l’effroi de l’avenir menaçant. Ni les temps, ni les mœurs n’ont rien pu sur elles : si, grossir leurs rangs. Car il est logique d’admettre que, alors que toutes les déviations morales aboutissant au dépeçage d’ordre religieux d’ordre guerrier, d’ordre judiciaire, d’ordre criminel pur, auront à jamais disparu, les exploits des fous, trouvant dans la douleur croissante de vivre un terrain chaque jour plus propice, resteront intangibles, en dehors de tout, au-dessus de tout, agissant dans la superbe indépendance que crée la folie et contre laquelle se brisent nos volontés.
Et le champ de la folie est ici de vaste étendue. Il va des superstitions de la vie de chaque jour (15) aux aberrations les plus paradoxales et pourtant froidement choisies et combinées.
On trouve dans l’histoire des traditions germaniques des faits très singuliers et bien instructifs. On y voit, entre autres choses, que les voleurs, pour se rendre invisibles, se procuraient de la graisse de femme enceinte pour en faire des bougies, ou croyaient aux vertus des doigts d’un fœtus : le nombre des femmes éventrées et fouillées est incalculable, et certainement cette croyance n’a pas encore disparu. Dans la nuit de la Saint-Silvestre 1864, un ouvrier de Neukirch assomma une jeune [p. 303] fille de 23 ans, découpa un fragment de son ventre de neuf pouces carrés et le fit rôtir chez 1ui. « En ajoutant, du suif à cette graisse humaine, il s’était façonné une chandelle de cambrioleur, et avait mangé les graillons restants (16). »
La vertu des bains de sang a fait des ravages énormes. Wagener raconte l’extraordinaire histoire de la comtesse Nadasky, laquelle alla jusqu’à faire périr 650 jeunes filles : pour plaire aux hommes, elle prenait des bains de sang dans une auge à quatre heures du matin (17).
Un vieux médecin de Naples avait préparé un élixir de longue vie « en tuant ses enfants avec des préparatifs et des solennités particuliers, en leur ouvrant la poitrine et en leur enlevant le cœur ».
Le 14 avril 1892, l’artilleur Radoulowitch tua un de ses camarades, lui ota le larynx, lui arracha le cœur et aspergea de son sang certains endroits où il croyait trouver un trésor.
« Jahn a communiqué un travail à la Société d’anthropologie de Berlin, le 7 avril 1888, sur l’affaire Bliefernichl de Sage, jugée par le jury d’Oldenbourg. D’après les dépositions des témoins, Bliefernicht vivait dans l’illusion que ceux qui mangent de la chair de jeunes vierges pouvaient tout se permettre sans jamais encourir de responsabilité. Il assassina deux fillettes de six â sept ans. L’un des cadavres avait la tête tranchée et le ventre béant, montrant à nu les entrailles, le cœur et le foie. Une grosse parcelle du bassin avait été découpée anatomiquement et n’avait pu être retrouvée, le monstre l’ayant précisément dévorée (18). » [p. 304]
Faut-il encore d’autres exemples ?
Prochaska cite le fait d’une femme de Milan qui attirait les petits enfants chez elle pour les tuer, les saler et en manger tous les jours. Laugius raconte qu’une femme, qui désirait manger de la chair de son mari, l’assassina et en sala une grande partie pour prolonger son plaisir (19).
C’est aussi. Maria de las Dolores mangeant le cœur de son père (20 mars 1825) ; c’est William Comstock mangeant le cœur de son père et de sa mère, et s’endormant auprès des cadavres qu’il avait dépecés (16 juin 1858).
« En juillet 1827, une paysanne alsacienne, d’un hameau voisin de Schlestadt, tua son fils de 15 mois de trois coups de· couteau au cou ; puis elle lui désarticula le membre inférieur droit et le fit cuire avec des choux, pour en manger et en faire manger à son mari (20). »
En 1865, un maçon âgé de 32 ans tue une vieille femme, la découpe, la fait cuire avec des pommes de terre et la mange… puis raconte le tout, tranquillement, à la justice.
C’est aussi le cas de J .-J. Goldschmidt : un passant est assommé, bouilli et mangé (21).
Maudsley (22) rapporte le cas suivant : un clerc d’avoué d’Aiton rencontre un jour en se promenant plusieurs petites filles et en emmène une dans un champ voisin. Quelques heures après, on découvrit les restes de l’enfant horriblement mutilés et une perquisition faite chez le coupable fit découvrir cette note dans son journal tenu au jour le jour : [p. 305] « Tué aujourd’hui petite fille ; c’était chaud et bon. »
Là nous pouvons clore la première catégorie du dépeçage moderne que M. Nina-Rodrigues a qualifiée d’offensive. Par les quelques exemples que J’ai donnés on peut voir qu’elle se subdivise elle-même en catégories secondaires qui n’ont cependant qu’une importance apparente, un même caractère général les réunissant toutes solidement les unes aux autres : le dépeçage est ou bien la fin que se propose l’acteur, ou bien la suite logique du meurtre, ceci se continuant par cela par une sorte d’exaltation croissante ou par une association d’idées dont les dominantes sont l’hostilité contre le mort, l’indifférence de son propre péril ou certaines impressions délirantes qui peuvent se greffer sur tout. C’est dans cette catégorie de dépeçage offensif qu’on peut placer ces mutilations sadiques dont les deux grands protagonistes modernes sont Jack l’Éventreur et Vacher, mutilations prises au sens propre du mot, localisées à une partie très limitée et toujours la même du corps humain, dont la réalisation fait partie d’une ligne de conduite arrêtée d’avance et qui ne varie que dans ses plus négligeables détails. Toute l’activité psychique tendue vers la convoitise de l’acte sadique presque toujours identique à lui-même, l’esprit immobilisé par le désir de s’approprier ou de violenter un organe toujours le même. Jack et Vacher sont des dépeceurs au même titre que les superstitieux sanguinaires dont nous venons de parler : ce qui les en rapproche, c’est ou bien qu’ils ne mutilent pas parce qu’ils ont tué, ou bien que la mort n’est qu’un incident accessoire, une complication possible, fréquente mais négligeable, [p. 306] un moyen même quelquefois indispensable dans ta réalisation implacable de leur érotique désir d’un morceau d’être vivant.
§
Autant le dépeceur offensif est varié dans ses allures, si les caractères de son acte obéissent à une sorte de loi — autant le dépeceur défensif est d’une banalité qui tranche souvent avec les caractères d’horreur surnaturelle qui peuvent accompagner le crime.
Je m’explique.
De ce qµe le dépeçage préventif est l’effet d’une cause toujours la même, la peur, ce phénomène déprimant par excellence, annihilant même quelquefois jusqu’à toute trace d’activité ou de lucidité chez des cerveaux pourtant lucides et actifs, — il se traduit en général par une série d’actes de courte étendue, presque toujours les mêmes et dont les épisodes paraissent calqués les uns sur les autres.
Même dans les cas plus rares où la peur, par le bouleversement qu’elle produit dans le système nerveux de l’assassin, par le choc, produit une réaction, un éveil, une exaltation d’énergie, le but étant toujours le même, les mêmes façons d’agir tendent à se répéter, d’autant que dans l’évolution, à travers le temps de cette catégorie de dépeçages, un grand rôle est dévolu à l’imitation.
Les variétés de dépeçage criminel offensif que nous avons décrites tout à l’heure sont au dépeçage défensif ce que l’anormal est à la loi. C’est bien celui-ci qui est le véritable dépeçage criminel de nos jours. D’ailleurs, il est né pour ainsi dire avec notre époque, il n’appartient comme système qu’à un temps relativement récent, il est appelé à se perfectionner [p. 307] en raison des obstacles qu’il rencontre et dans lesquels il puise un regain de vie… Il est aussi appelé à disparaître dans un temps donné, du moins il n’est pas absurde de le croire, tandis que le dépeçage criminel offensif est éternel.
Le dépeçage défensif, qui consiste à faire disparaître, en la fragmentant, la trace principale d’un crime, est né, à proprement parler, non de la peur de Ia justice qui, bonne ou mauvaise, sérieuse ou ridicule, paternelle ou féroce, a de tout temps existé… mais de la peùr de la police.
Il fut un temps, pas loin de nous, où il était plus difficile de tuer un homme que, de faire disparaître son cadavre. La justice se contentait de son majestueux et théâtral appareil, et se souciait fort peu de se faire aider d’une façon efficace par des auxiliaires subalternes, qui sont aujourd’hui ses plus ordinaires pourvoyeurs. Quand elle tenait un inculpé elle épuisait sur lui tous ses moyens d’action, et se lamentait encore plus que celle d’aujourd’hui quand il n’était pas coupable : on s’arrangeait d’ailleurs le plus souvent pour ne s’être pas dérangé pour rien.
La police, mal organisée, mal payée, mal vue des grands seigneurs de la loi, avait peu de raisons pour montrer beaucoup de zèle : la.découverte d’un crime lui causait plus d’ennuis qu’elle ne lui rapportait de bénéfices ; pour la découverte du criminel, c’était encore pis.
Il lui en coûtait quelquefois tant de se montrer indiscrète — et la discrétion au contraire, était si souvent pour elle une source de profit, — qu’elle était arrivée à ne plus trop s’émouvoir d’un cadavre trouvé derrière une haie, pendu à un arbre, déposé dans une mare ou confié au lit protecteur de la [p. 308] rivière. Il fallait, pour qu’on cherchât et qu’on découvrît le coupable, ou que celui-ci fût bien maladroit, ou que la victime ait des protecteurs bien puissants. Le plus souvent on ne le cherchait guère et on ne le trouvait pas.
Cet état de choses peu à peu changea. A. coup de bouleversements, de révolutions et de cataclysmes on finit par faire cornprendré à la police un peu de son rôle dans une société se disant organisée, et ainsi se créa une police qui, d’insouciante qu’elle était, devint, insensiblement, d’une extraordinaire curiosité. La sécurité publique étant le but avoué, la politique n’eut aucun scrupule de s’occuper de la chose et d’en profiter. Les gouvernements firent des sacrifices en conséquence : on arriva ainsi à s’occuper énormément de tout le monde, y compris les voleurs et les assassins. Pour ceux-ci l’âge d’or disparaissait ; il fallut songer, à la prudence. Un cadavre devenant, un objet encombrant, chacun chercha le moyen le plus sûr de s’en défaire. Le bon sens, en tous cas, indiquant, en attendant mieux, qu’il est plus facile de cacher des fragments de cadavre qu’un cadavre entier, on le coupa tout simplement en morceaux.
C’était simple et adroit… Mais c’était en même temps la lutte avec la police. Celle-ci se piqua au jeu, redoubla de zèle : les assassins, plus méfiants, redoublèrent d’adresse et arrivèrent à de véritables prodiges d’habileté. Les progrès de l’industrie furent utilisés d’un côté comme de l’autre, et bien, que la photographie, puis, l’anthropométrie, soient venues donner à la police un secours inappréciable, on peut dire que la police et les assassins comptent un même nombre de victoires à leur axquit. [p. 309]
Comme je le disais tout à l’heure, cet état de choses n’aura qu’un temps. Tôt ou tard le dépeçage sera brûlé après avoir été de plus en plus difficile. Quelques virtuoses se montreront encore, de temps en temps, audacieux et habiles, comme le remarquable dépeceur de Belleville, mais il faudra trouver autre chose… .
Nous n’en sommes pas encore là.
Le dépeceur (23) peut-il se superposer à tout assassin ?
Issei Sagawa, dépeceur et cannibale japonais.
On ne peut pas répondre oui, ce qui serait absurde, mais on ne peut pas répondre catégoriquement non. Quiconque se mêle d’être assassin ne peut pas répondre à l’avance qu’il n’ira pas jusqu’au dépeçage ; on ne sait jamais de quelle peur on est capable : le plus froid récidiviste n’en sait rien. Tel est devenu assassin et dépeceur du même coup qui, une heure avant, ne s’en doutait guère. Quoi qu’on en ait dit, ce fut certainement le cas de Billoir.
Toutefois il est des prédispositions à ce rôle particulier, de même qu’il est des causes occasionnelles puissantes.
Nous arrivons ici à un point qui fut assez vivement controversé.
Il y a d’abord le terrain.
Après ce qui vient d’être écrit plus haut, on comprend combien paraît étrange ce passage de M. Nina-Rodrigues : « C’est certainement grâce à l’évolution esthétique, à l’évolution religieuse, à l’évolution juridique que les dépeçages ornemental, religieux et judiciaire ont disparu. Et c’est encore grâce et [p. 310] avec l’évolution des sentiments sociaux en général que le dépeçage s’est réduit, comme il l’est aujourd’hui, à de simples manifestations sporadiques de ces individus anormaux que la réversion atavique transporte de temps à autre aux phases inférieures de la civilisation. »
Cela n’est exact ni pour le dépeçage offensif, exceptionnel, ni pour le dépeçage défensif, le véritable dépeçage criminel. Nous venons de faire voir que celui-ci est, au contraire, un produit presque nouveau. Toutefois M. Nina-Rodrigues pose dès lors la question de l’intervention de l’atavisme dans le terrain du dépeceur.
« On a donc commis une erreur, ajoute-t-il, en supposant que l’on peut renier l’existence de l’atavisme criminel en opposant comme chose distincte la dégénérescence à la transmission atavique : et cette erreur vient de ce qu’on n’a pas compris que cette transmission n’est pas autre chose qu’une vraie dégénérescence psychique, un arrêt, une suspension de la transmission héréditaire des qualités psychiques plus récentes qui ne laisse librement en action que les qualités plus lointaines des parents plus éloignés, des aïeux. »
Ce passage n’est pas clair, mais on finit par comprendre ce qu’a voulu dire M. Nina-Rodrigues. S’appuyant sur cette opinion — fausse — que toutes les formes de dépeçage se tiennent et se continuent, depuis les plus anciennes jusqu’aux plus modernes, il croit revoir chez celles-ci un réveil de celles-là, réveil rendu possible par un arrêt survenu, à un moment donné, dans l’évolution naturelle et successive de l’hérédité.
Cette intervention de l’atavisme, je le dis ici tout net, je ne l’accepte pas. [p. 311]
Qu’il y ait dans certains cas de dépeçage criminel des indices des errements de nos ancêtres, à tel point qu’on pourrait, sans trop d’exagération, les leur attribuer, cela n’est pas douteux et se retrouve à un degré quelconque dans presque tous nos actes : mais, à mon avis, c’est dans le dépeçage criminel qu’on le retrouve le moins. Les formes les plus anciennes du dépeçage ont chez nous absolument disparu, et les cas qui s’en rapprochent le plus dans la catégorie du dépeçage offensif sont dus à des influences passionnelles ou morbides qui sont de tous les temps.
Ce qui intervient sûrement, et ce que M. NinaRodrigues a dit malgré lui, tout en le niant, c’est l’influence du retard dans l’évolution morale et de la dégénérescence.
Toutes choses égales d’ailleurs — pure hypothèse — aura plus de raison de pousser le crime jusqu’au dépeçage, c’est-à-dire d’ajouter à l’acte anti-social, qu’est le crime, l’outrage anti-humain, qu’est le dépeçage, celui qui ne sera pas en harmonie de sentiments ou d’idées avec son milieu, soit en raison des différences de civilisation (24), soit en raison d’un retard subi par son évolution propre. Sur celui-là, les obstacles apportés par la civilisation et l’organisation de la société ne seront pas assez puissants pour empêcher le crime, et il acceptera volontiers, même d’avance, les conséquences de son acte, en se résolvant à le terminer par une pratique qui, effraierait de plus perfectionnés que lui.
M. Lacassagne l’a appelé un type retardé. [p. 312] L’expression est heureuse et nous l’adoptons volontiers, bien que M. Lacassagne ait semblé quelquefois faire de ce type retardé, candidat à notre dépeçage défensif criminel, un aboutissant du dépeçage offensif d’autrefois.
À côté du retard dans l’évolution intervient certainement la dégénérescence.
On a usé et abusé de ce mot. Beaucoup, même parmi ceux qui l’ont le plus répandu et expliqué, en sont las et n’en veulent plus. Il meurt de la faveur dont il a joui. Pourtant il peut encore rendre service.
Il n’est pas téméraire de se servir de lui quand on veut parler, de ces influences progressives et accumulatives qu’ont sur un individu ou sa descendance certaines pratiques ou certaines actions absolument contraires au jeu normal d’une saine physiologie. Il n’est pas téméraire de parler de dégénérescence quand il s’agit par exemple de l’action destructive de l’alcool qui lentement arrive à troubler à ce point le libre fonctionnement cérébral qu’il annihile l’action inhibitrice de la raison et de la volonté pour laisser le champ libre aux impulsions passionnelles. C’est bien un dégénéré celui dont les centres supérieurs sont réduits à l’impuissance et qui est désormais l’esclave de ses besoins. Ce que l’alcool réalise d’une façon frappante comme une expérience de laboratoire, d’autres tares moins violentes arrivent jusqu’à le réaliser, et ainsi se trouvent multipliées les causes qui rejettent l’individu au niveau de ce type retardé dont nous parlions tout à l’heure et même plus loin encore dans la chaîne des désarmés contre ce qu’ils ont de plus mauvais en euxmêmes, contre les pires tentations du dehors. [p. 313]
Et puis — et M. Lacassagne l’a bien vu pour son type retardé — c’est sur le retardé et le dégénéré qu’opère le plus l’influence indéniable de 1’imitation. Alors que les troubles apportés dans l’évolution de leur vie psychique les prédisposent aux pires choix dans le domaine du conscient, de même, inconsciemment, ils s’offrent en pâture à la contagion de l’acte criminel, d’autant plus sûrement que celui-ci a ému plus profondément la société.
Dans son beau livre sur la Contaqion du meurtre, M. Aubry a mis en relief cette influence de l’imitation, d’ailleurs logique, puisque cette forme de la suggestion a d’autant plus de chances de se produire que la disjonction est plus complète entre les fonctions psychiques supérieures et inférieures (25). Elle est logique et elle est prouvée par les faits. M. Aubry a remarqué qu’en douze ans, depuis le meurtre du boucher Avinain (1867) jusqu’à l’affaire du bijoutier Vétard (1888), on compte 24 cas de dépeçage criminel, tandis qu’en six ans, de 1887 à 1892, on en compte 36. (On en avait à peine découvert une quarantaine de 1721 à 1888.)
L’influence de l’imitation vient ici s’ajouter à celle de l’activité croissante de la police pour multiplier, dans ces dernières années, le nombre des dépeçages criminels.
Luka Magnotta dépeceur canadien
Donc, comme causes prédisposantes, comme terrain favorable, nous avons le retard dans l’évolution et la dégénérescence (nous laissons la folie dans la catégorie du dépeçage offensif). Comme cause occasionnelle prépondérante, nous avons l’imitation. Mais celle-ci n’est pas isolée. Interviennent aussi les sollicitations de la profession : le boucher, [p. 314] l’étudiant en médecine penseront plus que tout autre au dépeçage et seront certains de s’en mieux tirer. L’agent de police se croira plus capable de dépister les recherches et fera mieux son plan d’avance. Un des plus remarquables exemples est le gardien. Prévost qui, après avoir assassiné et dépecé la fille Blondin, sans avoir été découvert, prenait déjà ses mesures et arrêtait son plan pour un futur dépeçage qui devait se réaliser sur le bijoutier Lenoble.
D’autres circonstances, en apparence banales, peuvent d’une façon inattendue inspirer à un individu l’idée du dépeçage. M. Nina-Rodrigues rappelle avec raison qu’il est des cas où la nécessité d’introduire un cadavre trop grand pour la caisse qui lui est destinée « suggère spontanément aux criminels, comme tout à fait logique, la désarticulation des membres inférieurs ».
Enfin reste la cause efficiente celle qui plane, évolue sur tous les cas de dépeçage défensif, c’est-à dire sur presque toutes les manifestations du dépeçage criminel moderne : LA PEUR.
Nous avons parcouru toutes les observations recueillies par ceux qui ont écrit sur la question ; elles forment un tout imposant qui donne à notre dépeçage une physionomie particulière et le mettent en dehors de tout rapport avec les dépeçages d’autrefois. Parmi les trente-huit opérations recueillies par M. Ravoux, il en est qui sont, à ce sujet, bien caractéristiques. S’il faut déplorer — et la chose était d’ailleurs impossible — que l’auteur ne nous ait pas donné des renseignements sur la psychologie des criminels (son travail était fait d’ailleurs au point de vue des recherches médico-légales sur les [p. 315] cadavres), le point essentiel de cette psychologie se dégage de lui-même des quelques lignes qui racontent le crime.
Le cas suivant, typique, montre que la peur, pour conseiller le dépeçage, peut attendre un an après le crime.
« Henry Wainwright avait une maîtresse qu’il faisait passer pour sa femme et il prenait lui-même un faux nom dans les différents logements qu’ils occupèrent pendant l’année 1874. Elle quitta le logement commun le 11 septembre 1874. Depuis cette époque, on n’entendit plus parler d’elle. Les amis qui en demandèrent des nouvelles à Wainwright ne reçurent que des réponses évasives et fausses. Il chercha à leur faire croire qu’elle l’avait quitté pour un autre amant.
« Le 11 septembre 1875, c’est-à-dire exactement un an après la disparition d’Henriette Lane, Henry Wainwright fut surpris enlevant d’une tombe située dans des terrains attenants à une maison du quartier de Westchapel, dont il avait la clé, les restes d’un corps de femme. On apprit plus tard qu’Henriette Laue avait quitté son logement le 11 septembre 1874, était venue en voiture jusque vers le terrain où le corps avait été retrouvé et avait pris congé de ses enfants et d’un de ses amis. Elle avait eu probablement une entrevue avec Henry Wainwright. D’autres circonstances firent supposer que cet homme l’avait assassinée et avait enterré son corps sous le plancher d’une des chambres de la maison attenant aux terrains de Westchapel. En septembre 1875, la propriété devait passer en d’autres mains, aussi Wainwright crut-il prudent d’enlever les restes du cadavre et de les transporter dans une autre cachette appartenant à son frère, et c’est pendant cette [p. 316] opération qu’il fut surpris avec un cadavre au sujet duquel il ne put donner que des explications mensongères. Le corps avait été récemment dépecé (26). »
C’est la peur qui affole à ce point un berger de l’Eure qui, en 1877, ayant tué sa mère, découpe le corps avec une serpe, fait cuire la tête dans un four pour la rendre méconnaissable et jette les tronçons du cadavre au fond d’une marnière.
C’est la peur qui donne au fripier Mestag, d’Anvers, l’idée de couper sa femme en 153 morceaux (14 août 1877).
C’est la peur qui inspire les célèbres dépeceurs, Billoir, Barré et Lebiez, Menesclou, Pel, Avinain ; qui inspire aussi ces carnages de nouveau-nés dans les solitudes de chambre de bonne, la nuit, quelques heures après l’accouchement.
C’est la peur qui décide Pontes Visgueiro, juge à la cour d’appel de Maranhao, à désarticuler les jambes du cadavre de sa maîtresse que, par jalousie, il avait assassinée, et dont il devait enfermer le corps dans une caisse qui devait être jetée à la mer. Toutes les précautions avaient été prises…, mais la caisse, au dernier moment, se trouva trop, petite, et Visgueiro devint dépeceur malgré lui (27).
C’est la peur, toujours la peur. C’est elle qui est la caractéristique du dépeçage criminel actuel, c’est elle qui guide la main de l’assassin. Jack l’Éventreur et Vacher mis à part, je ne crois pas que celui qui entreprendra, comme M. Ravoux, de dresser le bilan des dépeçages depuis 1888 (28) jusqu’à aujourd’hui trouve beaucoup de cas où la peur ne soit pas l’instigatrice. [p. 317]
Souteneurs à l’affût des demi-mondaines, brutes guettant les garçons de recettes, vieux ou jeunes débauchés attirant les fillettes, — qu’ils aient ou non prémédité leur coup, ils ont, au moment du meurtre, l’excitation, quelle qu’elle soit, qui donne le courage de frapper. La résistance augmente même leur rage. Mais une fois l’excitation passée, la réaction se fait, une sorte de fatigue survient, et la terreur surgit du corps étendu là, sanglant.
Quelquefois le frisson est de courte durée et devant le péril l’énergie revient, chaque minute perdue étant un pas vers l’échafaud ; quelquefois, le frisson dure longtemps et ce n’est qu’après de longues heures d’angoisse que commence la triste besogne. « Quelquefois, écrit M. Lacassagne, fatigué par la lutte, brisé par l’émotion, l’assassin se repose, dort d’un profond sommeil. Au réveil, il faut faire disparaître le corps embarrassant, et c’est alors que surgit l’idée de le mettre en morceaux. »
Quelquefois le dépeceur est brutal : il casse, il déchiquette, il écrase. Le temps le presse ou la colère le prend. Une sorte de rage s’empare de l’assassin quand des morceaux de chair ne peuvent passer dans les latrines. Quelquefois, pour peu qu’il ait quelque pratique, tel qui fut cuisinier, tel même qui fut domestique chez un médecin et touchait des scalpels (29) — le dépeceur met une certaine coquetterie à faire une besogne convenable. Le boucher Tozzi montrait à son fils les façons élégantes de s’y prendre, et l’agent Prévost, qui trouvait que « couper la caboche à quelqu’un, c’est du chocolat, du velours (30) », ajoutait que, comme [p.318] ancien boucher, tailler de la chair humaine ça ne lui ferait pas plus d’effet que de débiter du mouton ou du veau (31).
Quelquefois le dépeçage ne suffisant pas, le dépeceur s’ingénie à détruire ou à cacher les morceaux. Tous les moyens sont employés : la cuisson, l’ébullition, la pâtée aux animaux, etc… La fille Lévèque, en 1865, jette le corps de son enfant dans un chaudron où bouillait la lessive. « Après l’y avoir laissé un certain temps elle le retire et se met à le déchirer avec les mains. Elle le divise en très petits morceaux, et à l’aide d’une pelle fait entrer violemment ces lambeaux dans la bonde d’un baril de vinaigre dont l’ouverture, n’avait que cinq centimètres de diamètre. »
Le plus souvent, ce que cherche le dépeceur, c’est non pas de fragmenter le corps à l’infini, mais d’en rendre les fragments méconnaissables. C’est en effet le moyen le plus sûr. Nous en avons la preuve actuelle dans le crime de Belleville, où il a suffi de couper le nez de la victime et de la scalper pour empêcher d’en reconstituer l’identité. C’est la tête qui est la pièce la plus compromettante ; aussi est-ce sur elle que le dépeceur en général s’acharnera. Mais quand une femme se trouve mêlée à un dépeçage, il est rare que sa présence ne soit pas signalée par quelque raffinement dans le travail ; il est bien rare aussi que les parties génitales ne soient pas l’objet d’une attention particulière dans le choix des mutilations.
Quelquefois on est plusieurs à la tâche : on s’excite les uns les autres, et c’est alors que les cadavres sont ordinairement le plus mutilés. Mais [p. 319] le plus souvent l’opérateur est solitaire, travaille la nuit, et va, au matin, porter les funèbres colis dans la cachette qu’il a choisie. Quand Pel, l’horloger de Montreuil, brûla le corps d’Élisa Bœhmer, les voisins, épouvantés et pressentant une scène horrible, voyaient à travers les carreaux de grands feux brûler la nuit dans la chambre, pendant que l’horloger allait et venait, sinistre, au milieu des lueurs…
§
Et ainsi ont disparu les dépeçages d’autrefois : sacrifices de prêtres aux divinités protectrices des cités, hécatombes des chefs guerriers aux mânes des ancêtres , tragédies terribles des justiciers impitoyables qui voulaient frapper fort et loin.
Ainsi ont survécu et survivront aussi longtemps que vivra l’homme, épisodes fugitifs des bouleversements agressifs de l’âme humaine, les dépeçages nés de la colère, de la haine, de la folie, de l’amour.
Ainsi a surgi, de la crainte de l’échafaud, de la lâcheté devant, I’expiation, de l’effroi de la mort qui grandit à mesure que l’homme sait mieux gâcher sa vie, le dépeçage moderne, le vrai dépeçage d’assassin, le DÉPEÇAGE NÉ DE LA PEUR.
DOCTEUR ALBERT PRIEUR.
NOTES
(1) RAVOUX, Du dépeçage criminel ou point de vue anthropologique et médico-judiciaire, Lyon, 1888.
(2) Y compris même les meurtres rituels, si tant est qu’ils existent ou aient existé, V. le livre de M. Strack, sur le Sang, la thèse de M. Marcus sur le Meurtre rituel au point de vue médico-légal, et la France MÉDICALE, le Meurtre rituel (décembre 1900).
(3) … « Après avoir décidé une vierge de 15 ans par force promesses, on lui extirpe le sein gauche pendant son immersion dans un bain d’eau chaude. Cette chair est alors découpée sur un plat en menus morceaux que les assistants consomment. Ensuite la jeune fille est retirée du bain et on la pose sur un autel à proximité. Toute la communauté exécute autour d’elle une danse folle et sauvage et entonne des cantiques… » (A. de Haxthausen, Etude sur la situation intérieure de la Russie, Hanovre, 1847).
(4) NINA-RODRIGUES, Des conditions psychologiques du dépeçage criminel, in Arch. d’Anthr. crim., janv. 1898.
(5) S’il fallait, dans la classification du dépeçage moderne, attribuer une place au dépeçage judiciaire, c’est certainement dans cette dernière catégorie qu’il faudrait le ranger. Il appartient à la phase violente de révolution de la justice qui ne frappait que pour punir, et qui voulait rendre le châtiment non seulement adéquat, mais supérieur à la faute. La cruauté de la peine était une doctrine qui trouvait d’ailleurs, souvent, dans la cruauté naturelle des juges, un appoint particulier. ..
Ajoutons enfin que nous prenons ici, pour plus de commodité, le mot de juges dans son sens le plus général, désignant ainsi tous ceux qui, à un titre quelconque, au nom d’un principe quelconque, coutume ou loi, avaient ou se croyaient le droit de prononcer une sentence.
(6) Comme au temps où elle mangea le cadavre de Ravaillac.
(7) SlGHELE : les Foules criminelles. 2e édit. (Alcan).
(8) MATIGNON, Comm. à l’Acad. de Médecine, 1901.
(9) RAVOUX, loc. cit.
(10) Jose Ramos mourut le 1er août 1893 au pénitencier de Porto-Alegre, État de Rio-Grande-do-Sul. .
(11) NINA-RODRIGUES, loc. cit.
(12) 18 septembre 1892. Rio-de-Janeiro.
(13) Annales d’Hyg. publ., 1883. Il s’agit d’un mets épicé préparé avec du safran. Cité par Ravoux, loc. cit.
(14) MOREAU DE TOURS, Crimes et suicides étranges.
(15) Qu’il faut bien distinguer des superstitions à caractère religieux, bien qu’ayant avec elles des points de ressemblance.
(16) Il fut condamné à mort par le jury d’Elbing, le 23 juin 1865.
(17) Etudes d’anthropologie philosophique. etc … Vienne, 1796.
(18) V. pour une multitude de faits de ce genre, STRACK : la Superstition du sang et les meurtres. [voir aussi : Hermann Leberecht Strack [1842-1922], Le sang et la fausse accusation du meurtre rituel, H. May, 1901.]
(19) LEGRAND DU SAULLE. Méd. lég..
(20) Ann. d’Hyg. publ., 1832. — Dr Marc. — Legrand du Saulle rapporte le même fait d’une façon encore plus pittoresque.
(21) LACASSAGNE, Arch. d’Anth, crim., 1888.
(22) LE CRIME ET LA FOLIE
(23) Le vrai, le dépeceur défensif, le dépeceur criminel tel qu’il se présente presque toujours, typique et banal.
(24) Il n’est pas question ici des peuples primitifs modernes, ce qui nous entraînerait trop loin. On se borne aux peuples civilisés occidentaux, et surtout aux Français.
(25) V. BINET : La Suggestibilité (1900).
(26) RAVOUX, loc. cit.
(27) NINA-RODRIGUES, loc. cit.
(28) Nous croyons savoir qu’un élève de M. Lacassagne prépare un travail sur ce sujet.
(29) NINA-RODRIGUES, loc, cit.
(30) MACÉ, cité par Aubry.
(31) MACÉ.



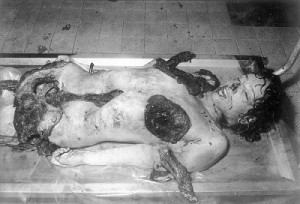
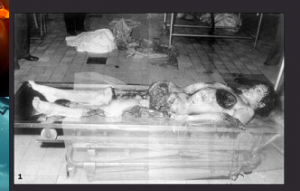

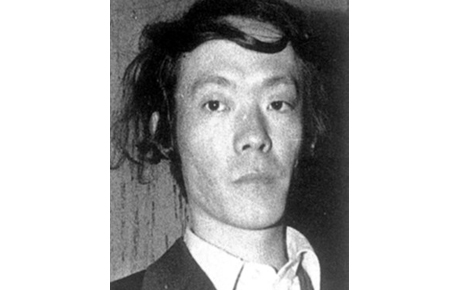


wow. your friend must be a wise man full of integrity and must occassionally where really tight shorts to work out in13#2#0;.i&882&7;d and anyone else would be luck to meet this fella.