Jacques Maritain (1882-1973). Philosophe venu d’un milieu abri-clérical convaincu, il devint portant un des plus important représentant de la pensée thomiste en France. Son héritage littéraire est considérable, mais le plus connu de sa production reste : Le paysan de la Garonne. Un vieux laïc s’interroge à propos du temps présent, Paris, DDB, 1966.
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Par commodité nous avons renvoyé les notes de bas de page en fin d’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr
[p. 95]
Le discernement médical du
merveilleux d’origine divine (1)
I
I. — Les idées que je voudrais vous proposer dans ce bref rapport m’ont été suggérées par la réflexion sur deux attitudes extrêmes qu’il n’est pas rare de rencontrer : pour l’une le merveilleux d’origine divine est discernable « scientifiquement » (au sens moderne du mot science), et même il n’est discernable qu’ainsi, c’est-à-dire par les seuls procédés d’analyse technique et de signalement sensor-mathématique des phénomènes, et en isolant le fait en question de son contexte humain non « scientifiquement » mesurable (dispositions bio-psychologiques du sujet et du milieu, valeur morale, développement spirituel, situation historique concrète des acteurs de l’événement) : en telle sorte qu’on pourrait — et devrait — obtenir finalement une certitude quasi-mathématique du merveilleux divin, ainsi que le réclamait Renan, quand il demandait qu’un miracle, pour être dûment vérifié, se produisît devant une commission de savants et de membres de l’Institut qui en fixeraient les conditions.
Pour l’autre attitude extrême, le merveilleux divin est scientifiquement indiscernable de toute façon, et en quelque sens que l’on entende le mot science ; (et il n’est pas discernable non plus à une connaissance valable d’ordre naturel et de type non scientifique) ; il n’est discernable qu’aux yeux de la foi.
2. — Ces deux positions extrêmes sont à mon avis erronées l’une et l’autre. Une troisième position est vraie selon moi, pour laquelle non seulement un discernement préscientifique bien fondé, mais encore un discernement scientifique du merveilleux divin est possible, — toutefois au sens thomiste du mot science, et [p. 96] selon que la science (déjà celle du médecin, et à un plan très supérieur celle du philosophe et celle du théologien) juge de l’être lui-même et du réel lui-même, autrement dit a une valeur « ontologique » et non pas seulement physico-mathématique.
Dans le cas actuel, où il s’agit de différentes sortes et de différents paliers de savoir pratique (médecine ou science pratique de la santé, philosophie morale et partie morale de la théologie), il faudra nécessairement tenir compte du contexte humain concret et singulier, ce qui conduira à une certitude « morale » ou « physicomorale ».
C’est avant tout en ce qui concerne la médecine que la question de ce discernement scientifique nous occupera.
II
3) — Il convient ici — ce sont des préliminaires indispensables — de rappeler la distinction fondamentale entre connaissance spéculative (par exemple la philosophie spéculative, — ou les sciences des phénomènes) et connaissance pratique (par exemple l’art-science du médecin). La notion de science pratique est largement méconnue de nos jours, ce n’est pas du tout une science (spéculative) appliquée, c’est une science, un savoir qui dès l’origine et dans sa structure même de savoir est ordonné à une action à produire. Ainsi la médecine est structuralement ordonnée à produire la santé dans l’être humain ; c’est pourquoi saint Thomas enseigne que la médecine « théorique » et la médecine « pratique » font partie d’un même habitus pratique qui est le savoir médical en général. Il suit de là que les nombreuses disciplines spéculatives utilisées par la médecine (bactériologie, chimie biologique, etc.) ne sont pas la médecine elle-même, mais des disciplines auxiliaires et des matériaux utilisés par la médecine (comme la psychologie est utilisée par la morale).
Je diviserai la présente étude en deux parties :
1° J’essaierai d’établir une correspondance analogique entre le cas de la connaissance spéculative et celui de cette science pratique particulière qu’est la médecine. Nous verrons que trois conceptions du savoir sont possibles en l’un et l’autre cas, — une faussée par un parasitage philosophique, les deux autres droites et valables (conception « empiriologique » ou « technologique », et conception « ontologique » du savoir).
Quand la question porte sur le discernement d’un fait réputé merveilleux, c’est le savoir de type « ontologique » qui est seul légitimé à se prononcer.
2° Il faudra alors examiner les conséquences méthodologiques [p. 97] de ces positions, et en tirer les conclusions intéressant notre sujet.
III
4) —Rappelons d’abord que dans le domaine de la connaissance spéculative de la nature, on peut rencontrer trois sortes de conceptions du savoir : une fausse, et deux bien fondées.
Les conceptions fausses sont par exemple de type positiviste, matérialiste ou mécaniciste : elles imposent aux sciences des phénomènes le carcan d’une fausse métaphysique (souvent inconsciente d’elle-même).
La première conception bien fondée concerne le savoir que dans mon vocabulaire de philosophe j’ai proposé d’appeler empiriologique (les « sciences » au sens moderne de ce mot) : ce savoir est une connaissance des phénomènes par l’observable et le mesurable comme tels ; les concepts y sont constitués et définis en fonction de l’observable et du mesurable, et finalement par l’assignation de procédés physiques de mesure. Un tel savoir porte sans doute sur les « causes », mais atteintes seulement dans un substitut ou un « symbole » défini selon ce type, et il tend à une reconstruction mathématique des causes avec des entités de raison.
La seconde conception bien fondée concerne le savoir que nous appelons ontologique (non pas en ce sens qu’il se confondrait avec ce chapitre de la métaphysique qu’on nomme l’ontologie, mais en ce sens qu’il vise à conquérir l’être lui-même des choses).
Tel est le cas de la philosophie de la nature. Ce savoir résout ses concepts, non pas dans l’observable, mais dans l’être intelligible, il est une connaissance de l’être par les causes réelles, et il tend à découvrir l’« essence » des choses (par exemple, la composition hylémorphique des corps).
Ces deux sortes de savoir « scientifique » et « philosophique » ne chassent pas sur le même terrain, et sont toutes deux nécessaires ; et non seulement compatibles, mais complémentaires.
5) —Passons maintenant au cas de la médecine. La médecine appartient au genre du savoir pratique (dans la ligne du « faire », to make : produire la santé). Par analogie avec le cas du savoir spéculatif, on peut distinguer dans son cas trois conceptions, une fausse et deux bien fondées.
La conception fausse sera par exemple une conception matérialiste.
Dans le cas qui nous occupe, elle déclarera le merveilleux d’origine divine impossible en principe. [p. 98]
Une première conception bien fondée concerne les disciplines empiriologiques ou technologiques « scientifiques » au sens moderne de ce mot), qui tendent à connaître les phénomènes par des procédés de laboratoire, à les décomposer et recomposer en dehors du malade réel individuel, en faisant correspondre à telle réaction spécifique telle indication thérapeutique. A vrai dire ce n’est pas là de la médecine proprement dite, mais plutôt une technique au service de la médecine, ou bien c’est une discipline biologique de nature spéculative : chimie biologique, sérologie, endocrinologie, réflexologie, etc. En portant les choses à l’extrême, si ces disciplines étaient prises pour la médecine elle-même, alors on aurait affaire à une médecine sans malade, celui-ci n’étant qu’une hypothèse abstraite servant à l’addition des indications séparées fournies par un nombre de plus en plus imposant de services spéciaux.
La deuxième conception bien fondée est proprement médicale (selon que la médecine est une « science pratique » au sens aristotélicien de ce mot). Étant essentiellement l’art de guérir, la médecine vise à procurer la santé d’un être humain, en servant la nature. Elle met en face, pour un dialogue où la vie et la mort sont en jeu, un malade individuel et un homme dont la science doit déclarer comment guérir ce malade. Il y a là un résultat « ontologique » à obtenir dans le concret individuel.
6° — Comparons maintenant en général le savoir ontologique et le savoir empiriologique. Le savoir de type empiriologique ou technologique (spéculatif ou pratique) recueille des faits vérifiés d’une façon d’autant plus détaillée et par des moyens d’autant plus parfaits que le contenu ontologique de la réalité lui échappe davantage. De soi il tend à une certitude de type mathématique ou physico-mathématique, et il y parvient dans une certaine mesure (v.g. l’existence des atomes). Quand il n’y parvient pas, alors c’est qu’il en reste à des hypothèses.
Au contraire, comme le savoir spéculatif de type ontologique établit des certitudes d’ordre philosophique, de même le savoir pratique de type proprement médical établit, lui aussi, des certitudes, mais celles-ci sont seulement des certitudes d’ordre moral. Je dis moral à dessein, bien qu’il s’agisse de l’établissement d’un fait physique. Les scolastiques caractérisaient la certitude morale comme une certitude valable selon les lois psychologiques et morales du comportement de l’être humain. La certitude médicale (quand elle est possible) est une certitude physico-morale, parce qu’elle concerne le composé humain, où le moral et le psychique [p. 99] ont leur part même dans les maladies somatiques et surtout dans le pronostic et le traitement (résistance morale du sujet, habitudes de vie, confiance, imagination…). En psychiatrie le rôle de cet élément est encore plus important.
Cela étant, j’emploie le mot certitude morale pour me tenir au degré le moins ambitieux de certitude, nous sommes sûrs ainsi de ne pas forcer les choses.
De plus, il s’agit ici d’une science pratique, la certitude y porte sur des cas singuliers, elle est d’ordre concret. Elle apparaît comme rare en un tel domaine, et comme la limite extrême d’une vaste région de probabilités plus ou moins fortes.
7° — Comparons après cela le savoir empiriologique ou technologique et le savoir ontologique au point de vue spécial de notre discussion présente.
Le savoir empiriologique (disons technologique dans le cas de la médecine et du savoir pratique en général) tend de soi à construire (en particulier des êtres de raison, fondés in re) et à vérifier ses constructions par les recoupements du réel ; il tend donc à constituer un univers à part, en discontinuité avec l’usage commun de la vie et les critères du « bon sens » (ainsi les temps einsteiniens, le principe d’indétermination, etc.). S’agit-il du discernement d’un fait merveilleux d’origine divine, il conduirait à faire dépendre ce discernement : 1° de l’isolement de tout contexte humain concret ; 2° de l’élimination de toutes les possibilités de reconstruire les faits moyennant n’importe quelle autre hypothèse, ce qui reviendrait à épuiser le réel.
Mais il est parfaitement déraisonnable de demander à une discipline non ontologique de dirimer une question ontologique comme celle de la réalité ou de l’irréalité d’un fait préternaturel ou surnaturel. Le terme même de miracle n’a pas de sens pour une telle discipline, non plus que les termes substance, cause efficiente, cause finale, etc. Elle ne connaît que des événements spatio-temporels et les formules des légalités mathématiques que nous établissons entre eux. A ses yeux ce que nous appelons miracle ne saurait être signifié que comme un événement exceptionnel, qu’il sera toujours possible de faire rentrer dans cette légalité symbolique, on n’a alors, comme le dit Philipp Frank, « qu’à prendre une formule plus générale, embrassant les cas antérieurs et le cas exceptionnel à la fois ».
8° — Au contraire, le savoir proprement médical a une valeur ontologique (ontologique pratique) : guérir ou ne pas guérir correspond à être ou ne pas être. [p. 100]
Ici le discernement de ce qui est ou n’est pas se fait en tenant compte du contexte humain concret et par voie synthétique-existentielle (les sciences pratiques procèdent modo compositivo) — non pas en construisant un univers de raison qui recoupe l’univers des choses, mais en pénétrant dans l’univers réel, en
ayant l’intelligence (verstehen) de tel de ses moments ou de ses aspects, en groupant les indices et en constatant s’ils convergent de manière à imposer une certaine vue ou intelligence synthétique du réel.
Et d’autre part le savoir proprement médical (ontologique pratique) se trouve en continuité avec l’usage commun de la vie. Il contrôle les faits avec rigueur, mais en usant avant tout des critères de la raison commune et du bon sens (ceux mêmes, dans le cas des faits merveilleux dont on cherche à savoir s’ils sont d’origine divine ou d’origine pathologique, qu’indiquent sainte Thérèse et saint Jean de la Croix), et en complétant naturellement ces critères ordinaires et premiers par tous les moyens de vérification procurés par les progrès du savoir empiriologique et de la technique scientifique. Tout cela cependant demeure orienté vers l’obtention d’une certitude morale ordinaire et non pas vers l’obtention d’une certitude mathématique extraordinaire.
IV
9° — A entendre le mot science au sens non pas moderne (exclusivement empiriologique), mais au sens traditionnel (non seulement empiriologique, mais aussi et d’abord ontologique) de ce mot, il y a lieu, nous l’avons noté au début, de distinguer un discernement non scientifique ou préscientifique (celui dont le « bon sens » est capable) et un discernement scientifique du miracle.
Dans ce discernement scientifique on peut discerner trois degrés : 1° l’établissement critique des faits (critique des témoignages, etc.) ; 2° l’examen des faits et le jugement porté sur eux par des sciences purement humaines, par exemple par la médecine et, à un plan supérieur, par la philosophie ; 3° l’examen des faits et le jugement porté sur eux par la théologie, seule proportionnée à juger du surnaturel comme tel.
Il est intéressant de noter que dans le discernement préscientifique on retrouve, sous les conditions propres de la connaissance « vulgaire » (qui est loin d’être méprisable), les mêmes degrés d’élaboration. Si entre discernement préscientifique et discernement scientifique il y a plus, épistémologiquement [p. 101] qu’une simple différence d’état, cependant les procédés fondamentaux de l’intelligence y sont les mêmes.
Je me permettrai ici une digression sur le discernement préscientifique du miracle, tel que l’Evangile nous en donne de nombreux exemples. Il s’agit là d’un comportement humain raisonnable (montrant, au-dessous des lumières surnaturelles, non pas crédulité, mais exercice de la saine raison), bref nous voyons là comment ont dû jouer les critères naturels du bon sens sous la grâce actuelle.
1° Matth., IX, 34. — L’Evangile donne raison aux « foules » contre les pharisiens. Qu’on se garde d’en tirer argument en faveur de la crédulité et contre l’usage de la science. Ces hommes ne sont pas crédules. Leur foi implique un jugement prudentiel, qui présuppose l’exercice du bon sens (de ce bon sens que la science — ontologique — doit continuer) et la convergence des signes.
Réponse de Jésus, XII, 25. — Il serait trop au-dessus de la portée des pharisiens auxquels il s’adresse d’éliminer directement, par une démonstration théologique, l’hypothèse que Jésus chasserait les démons dans la puissance de Beelzebuth. D’autre part, s’ils étaient de bonne foi, ils auraient vu indirectement, par la convergence des signes et des indices (caractère de Jésus, finalité du fait, etc.) qu’il ne peut pas en être ainsi. Jésus leur répond en évoquant un autre contexte (si c’est le diable, alors sa maison périra) où les générations postérieures trouveront un signe.
2° Épisode de Nathanael. Joan., l, 48-50. — Ici nous sommes en face de la certitude d’une appréciation singulière et concrète.
Pourrait-il s’agir d’un simple phénomène de « clairvoyance » ?
A priori et abstraitement cela serait possible ; dans le contexte concret des circonstances singulières, non. Il y a la vue de Jésus, présent au yeux de Nathanael : et, à l’intérieur, une lumière sans doute sur l’état de son âme tandis qu’il était sub fieu, — voilà des signes suffisamment convergents, à condition que l’âme elle-même du sujet soit parfaitement claire, droite et limpide
(vere Israelita).
3° Sanatio filii reguli. Joan., IV, 49-53. – La coïncidence n’est probante que dans le contexte concret des autres circonstances (vertus de Jésus, sa sagesse, etc.).
4° L’aveugle-né. Joan., IX, 16-17 ; 29-34. — Remarquons ici qu’il n’est pas requis que toutes les circonstances soient favorables.
Ici un élément manque aux yeux des Juifs fidèles à la loi mosaïque d’une façon toute littérale : l’observation du sabbat. (De même, dans le cas de Jeanne d’Arc, le port des vêtements d’homme [p. 102] n’était pas, pris en soi, un « indice favorable ». Ce qui est requis c’est une convergence des signes positifs suffisante pour exclure la possibilité soit de la fraude, soit d’un processus naturel apparemment merveilleux, soit d’une intervention diabolique. La simple sainte Thérèse ; celle de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ; ou même les symptômes d’hystérie purement matérielle dont Gustave Thibon a si judicieusement parlé à propos de certains cas de stigmatisation.) Il importe de distinguer l’absence d’un signe favorable et la présence d’un signe positivement défavorable comme l’hystérie formelle, le mensonge, etc. La certitude ne naît pas d’une addition purement quantitative de circonstances favorables. Elle suppose une totalité significative dans son unité synthétique, une convergence décisive des signes positivement favorables sans qu’il subsiste un signe ayant dans cet ensemble concret valeur positivement défavorable.
Nous venons de considérer divers exemples de discernement préscientifique bien fondé. Pierre Duhem disait que le fait d’expérience commune est plus sûr quoique moins rationnellement fouillé que le fait scientifique. On pourrait montrer semblablement que ce discernement préscientifique est de soi plus sûr (étant plus simple) que le discernement scientifique, mais moins prouvable ou moins apte à être intersubjectivé (la saine raison, en effet, s’y exerce normalement, mais sans rendre, comme dans la science, ses procédés de vérification objective indépendants en soi de l’état du sujet ; comme nous le disions à propos de Nathanael, la pureté du cœur de celui qui fait le discernement y joue un rôle indispensable, non seulement pour removere prohibentia, mais pour permettre au signe d’avoir sa valeur.)
10° — Après cette digression, je reviens à la question du savoir médical, pour essayer de tirer à son sujet quelques conclusions dans le cas qui nous occupe.
Si l’on prétendait (ce qui est déraisonnable, nous l’avons vu) discerner le fait merveilleux dans l’ordre et selon l’esprit des disciplines empiriologiques ou technologiques (auxquelles les modernes réservent abusivement le nom de « science », on exigerait, selon l’idéal mathématique de ces disciplines, des certitudes contraignantes telles que toute résistance de la mauvaise foi serait rendue impossible.
Au contraire, dans l’ordre et selon l’esprit de la science proprement médicale, qui tend de soi à des certitudes morales et non mathématiques, établies en continuité avec l’usage commun de [p. 103] la vie, c’est à un autre genre de certitudes qu’on tendra à des certitudes contraignantes dans leur ordre et intersubjectivables selon des règles fixes, mais auxquelles la mauvaise foi peut résister, et qui présupposent que les obstacles (prohibentia) dûs soit à la mauvaise foi soit à la crédulité sont écartés par une droite disposition intellectuelle et morale : une affectivité mal réglée peut en effet développer la crédulité chez un médecin et affaiblir son esprit critique, et d’autre part une droite disposition de la volonté à l’égard en général de l’éthique de la pensée, et en particulier des choses de la foi, peut débarrasser sa science de préjugés parasitaires qui deviendraient dans certains cas des empêchements à reconnaître le vrai.
Dans cette perspective-là, et en usant de ces critères-là, nous pensons que la science proprement médicale (somatique et mentale) est apte à discerner, le plus souvent d’une façon seulement probable, parfois avec certitude (certitude physico-morale) si un fait est ou non en dehors des possibilités de la nature telle qu’elle est connue du médecin dans l’état actuel de sa science ; le médecin agissant alors comme médecin (selon sa science de type ontologique pratique, et en tenant compte de tous les éléments du concret), non comme technologue.
Le médecin dira en pareil cas, exactement avec la même sorte de probabilité ou de certitude que pour ses diagnostics ordinaires, et sans avoir à envisager l’événement dans ses racines les plus profondes et ses causalités les plus foncières, ni à se prononcer sur son caractère positivement préternaturel, transnaturel ou surnaturel : « Dans l’état actuel de la science médicale on ne peut pas — ou on peut — rendre compte de ce fait (probablement ou certainement) par les facteurs naturels, plus spécialement par les facteurs morbides auxquels la médecine a à faire. Après cela, et comme médecin, je n’en sais pas davantage. » [Si le médecin, comme il arrive si souvent de nos jours, est plus technologue que véritablement médecin, alors il ne pourra même pas faire un tel discernement relatif et subordonné ; il apportera seulement au jugement d’un autre des matériaux et un détail de constatations abstraitement coordonnées auxquelles il ne saurait lui-même reconnaître de valeur ontologique.]
Il serait contraire à la nature des choses (voy. paragraphe 7) que Dieu soumît les interventions surnaturelles aux critères empiriologiques ou technologiques ; mais l’emploi des critères médicaux au sens propre du mot (et en continuité avec l’usage de la raison commune, et présupposant la bonne foi) est conforme à la nature des choses, bien qu’insuffisant par lui-même, [p. 104] relatif et subordonné, et devant être complété par les critères du philosophe et ceux du théologien
11) — La discrimination de la nature positive et des causalités profondes du fait en question est affaire, en effet, 10 de philosophie (2) — absolument parlant ce fait est — ou n’est pas — en dehors des possibilités de la nature, — de la nature seule ou de la nature aidée par la grâce ; après cela, qu’il soit préternaturel, transnaturel ou surnaturel ; qu’il soit ou non référé à l’ordre de la grâce sanctifiante et du salut, j’ai mon idée là-dessus, mais je laisse au théologien de trancher ex professa ») ; elle est affaire de théologie, et c’est la théologie qui se prononcera en définitive:
« Ce fait a — ou n’a pas — pour cause Dieu lui-même agissant en dehors du cours ordinaire de la nature et comme auteur de l’ordre surnaturel. »
Ce sera ainsi au théologien de porter le jugement définitif concernant le caractère préternaturel, transnaturel ou surnaturel du fait en question. Et ce jugement pourra fort bien différer de celui du médecin, déclarer non miraculeux par exemple tel fait que le médecin aura jugé « non explicable » dans l’état actuel de sa science, ou au contraire déclarer transnaturel ou surnaturel tel fait qui au regard de critères purement médicaux, et si l’on ne tenait pas compte d’éléments du contexte qui échappent à ces critères, aurait gardé une signification indéterminée.
JACQUES MARITAIN.
NOTES
1) Rapport présenté aux Journées de Psychologie Religieuse d’Avon, en 1936.
2) Comme il s’agit ici du discernement de la valeur d’un fait singulier concernant la vie humaine et pris dans son contexte humain, c’est la philosophie morale qui est ici en jeu, encore qu’elle utilise, pour le discernement en question, des vérités établies par la métaphysique et par la philosophie de la nature.
Nous pensons d’autre part que la philosophie morale n’est adéquate à son objet que si elle s’appuie ou se subalterne à la théologie; c’est pourquoi elle n’ignore pas ce qui est de la grâce.
Enfin, comme la théologie, il va de soi que pour juger d’un fait réputé merveilleux, elle tienne compte à leur rang des matériaux et des jugements fournis par les sciences de la nature et par la médecine.


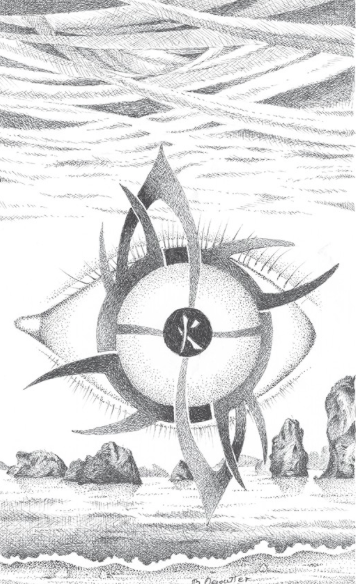
LAISSER UN COMMENTAIRE