 Ludovic Dugas et François Moutier. Dépersonnalisation et émotion. Article paru dans la « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), trente-cinquième année, tome LXX, juillet à décembre 1910, pp. 441-460.
Ludovic Dugas et François Moutier. Dépersonnalisation et émotion. Article paru dans la « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), trente-cinquième année, tome LXX, juillet à décembre 1910, pp. 441-460.
Cet article, avec les précédents, aboutira à l’ouvrage qui paraîtra l’année suivante, et qui fera référence sur la question : La Dépersonnalisation. Paris, Editions Félix Alcan, 1911. Dans la « Bibliothèque de philosophie contemporaine ».
Ludovic Dugas (1857-1942). Agrégé de philosophie, Docteur es lettre, bien connu pour avoir repris de Leibnitz, dans ses Essais sur l’Entendement humain, tome II, chapitre XXI, le concept de psittacus, et en avoir inscrit définitivement le concept de psittacisme dans la psychiatre française par son ouvrage : Le psittacisme et la pensée symbolique. Psychologie du nominalisme. Paris, Félix alcan, 1896. 1 vol. in-8°, 2 ffnch., 202 p. Dans la « Bibliothèque de Philosophie Contemporaine ». Il s’est intéressé précisément au « rêve » sur lequel il publia de nombreux articles. Il est également à l’origine du concept de dépersonnalisation dont l’article princeps est en ligne sur notre site. Nous avons retenu quelques uns de ses travaux :
— Observations sur la fausse mémoire. Article parut dans la « Revue de philosophie de la France et de l’étranger », (Paris), dix-neuvième année, tome XXXVII, janvier-juin 1894, pp. 34-45. [en ligne sur notre site]De de
— A propos de l’appréciation du temps dans le rêve. Article paru dans la « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), vingtième année, XL, juillet décembre 1895, pp. 69-72. [en ligne sur notre site]
— Le sommeil et la cérébration inconsciente durant le sommeil. Article paru dans la « La Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), XLIII, janvier à juin 1897, pp. 410-421. [en ligne sur notre site]
— Un cas de dépersonnalisation. Observations et documents. In « Revue philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), vingt-troisième année, tome XLV, janvier-février 1898, pp. 500-507. [en ligne sur notre site]
— Observations et documents sur les paramnésies. L’impression de « entièrement nouveau » et celle de « déjà vu ». Article parut dans la « Revue de philosophie de la France et de l’étranger », (Paris), dix-neuvième année, tome XXXVIII, juillet-décembre 1894, pp. 40-46. [en ligne sur notre site ]
— Un nouveau cas de paramnésie. Article parut dans la « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), trente-cinquième année, LXIX, Janvier à juin 1910, pp. 623-624. [en ligne sur notre site]
— Quelques textes sur la fausse mémoire : Dickens, Tolstoï, Balzc, Lequier. Extrait du « Journal de psychologie normale et pahologique », (Paris), onzième, 1914, pp. 333-338. [en ligne sur notre site]
— De la méthode à suivre dans l’étude des rêves. « Journal de Psychologie normale et pathologique », (Paris), XXXe année, n°9-10, 15 novembre-15 décembre 1933, pp. 955-963. [en ligne sur notre site]
 François Moutier (1881-1961). Médecin, neurologue et poète. Spécialisé dans la gastro-entérologie, après la neurologie et ses travaux sur le langage, la dépersonnalisation retint également son attention. Quelques publications :
François Moutier (1881-1961). Médecin, neurologue et poète. Spécialisé dans la gastro-entérologie, après la neurologie et ses travaux sur le langage, la dépersonnalisation retint également son attention. Quelques publications :
— L’Aphasie de Broca. Thèse de doctorat en médecine. Paris, Steinheil, 1907. 1 vol. 779 p.
— Traité de Gastroscopie et de Pathologie endoscopique de l’estomac. Paris, Masson, 1935. 1 vol. 347 p.
— (avec A. Cornet). Les gastrites. Paris, Masson, 1955. 1 vol. 404 p.
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Par commodité nous avons renvoyé les notes de bas de page en fin d’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr
[p. 441]
DÉPERSONNALÏSATION ET ÉMOTION
La dépersonnalisation est étroitement liée à l’émotion. C’est ce que nous remarquions déjà dans une étude publiée dans la Revue philosophique en 1898. Quoique nous n’eussions alors en vue que de contrôler par un fait nouveau la description, donnée par Krishaber et Taine, du trouble mental qu’ils désignent sous le nom de névropathie cérébro-cardiaque, nous prenions soin de faire observer que la dépersonnalisation renferme des éléments affectifs et a pour cause un état affectif. Elle est, disions-nous, « une dissolution de l’attention, provenant d’un affaiblissement général des émotions. L’apathie tant affective qu’intellectuelle, paraît être le trait essentiel et la cause de la dépersonnalisation ». Nous nous refusions à voir dans le trouble de perception, dont parle Taine, autre chose qu’une sorte de langueur, répandue sur tous les états de conscience, laquelle nous caractérisions ainsi : « Qui ne connaît par expérience ces moments de dépression et de torpeur morale, pendant lesquels rien en apparence n’est changé dans la vie, et pourtant on ne reçoit plus des êtres et des choses les émotions accoutumées ; pendant lesquels, sans qu’il y ait suspension des fonctions vitales psychiques, il y a abaissement du ton vital et affectif, et, à la limite, insensibilité totale ? La dépersonnalisation rentre dans cet état ; elle est un trouble intellectuel, produit par l’atonie morale (1). Nous serions [p. 442] tentés aujourd’hui d’écrire un trouble intellectuel qui traduit l’atonie morale.
Pour la clarté de l’exposition, nous considérerons (dans ce qui va suivre) la dépersonnalisation, d’abord, comme distincte de l’état émotif auquel elle est liée et dont, suivant les cas, on peut dire qu’elle provient ou qu’au contraire elle produit, ensuite comme ne faisant qu’un avec cet état ou comme n’étant elle-même qu’une émotion d’un genre spécial, laquelle il y aura lieu de définir (2).
Tout d’abord la dépersonnalisation est souvent le contre-coup d’une émotion forte. Une femme voit « tomber son fils à l’eau » ; le choc émotionnel est si violent qu’il brise en elle tout ressort, qu’il la frappe d’une sorte de stupeur ou mieux de stupidité morale. Elle cesse « d’être impressionnable, elle ne sent plus les joies ni les peines, elle est indifférente à tout ». De même Nem… est frappée par l’aspect effrayant d’un mendiant qui s’adresse à elle ; elle reste impressionnée et depuis elle ne retrouve plus la perception normale, elle trouve aux objets et surtout aux personnes un aspect drôle, étrange. To… est bouleversée par une déclaration obscène que lui fait un petit employé et depuis elle doute de toutes les choses présentes qui lui semblent avoir perdu leur réalité. M. Janet, qui rapporte ces cas et d’autres analogues en conclut que l’émotion « a une action dissolvante sur l’esprit, diminue sa synthèse », inhibe l’attention, la volonté, fait disparaître « les fonctions du réel : la confiance, la certitude », est, en un mot, une cause générale de perturbation psychique. Rien de plus vrai mais, pour simplifier, nous considérerons exclusivement ici les effets de l’émotion, non sur la perception en général, mais sur la perception des sentiments en particulier ; autrement dit, nous considérerons l’émotion comme cause, non de la dépersonnalisation tout entière, mais de la dépersonnalisation uniquement affective.
De tous les états auxquels le moi se sent devenir étranger, les états affectifs sont les plus fonciers, les plus intimes, ceux dont la [p. 443] perte doit donc le troubler le plus. En fait la forme la plus aiguë de la dépersonnalisation consiste, si on peut dire, à ne plus sentir ses sentiments. C’est ce que prouve le cas typique d’Alexandrine, remarquablement analysé par Revault d’Allonnes.
Cette femme, séparée des siens, enfermée à l’asile Sainte-Anne, se plaint de ne plus ressentir aucune émotion. « Je voudrais, dit-elle, avoir du chagrin, au sujet de mon mari, de mon fils, de moi-même. (Elle pleure.) Voyez ! monsieur, je pleure, eh bien ! cela ne me touche pas ; je ne sens rien. Autrefois, quand je pleurais, j’avais du chagrin, maintenant quand je pleure, cela ne me fait pas de peine. Elle est triste et connaît qu’elle doit l’être, en déduit les raisons, mais elle ne sent pas sa tristesse. C’est là ce qui la désespère plus que son malheur même. Le vrai malheur en effet est « de ne plus éprouver ni bien, ni mal, ni repos, ni chagrin… Oh ! écoutez ! il vaudrait mieux que je souffre et que je revienne comme j’étais, plutôt que de continuer à ne rien sentir. Son mari vient la voir à l’asile. Il lui dit de l’embrasser. Elle l’embrasse. « Cela me fait comme si j’embrassais cette table, monsieur ! la même chose. » On lui demande si elle l’aime. « En moi je l’aime, je suppose. Mais pas le moindre vibrement. Rien ne me fait vibrer sur la terre, rien au monde. Pas plus mon enfant que mon mari ». On fait entrer son fils. On lui demande si elle a plaisir à le voir. « Non, monsieur, aucune émotion, cela ne me fait pas chaud comme avant, cela ne me touche pas. Voyez ! voilà mon enfant ! (Sa voix s’altère.) Eh bien ! je ne ressens rien ; pas d’élan, mon cœur ne bat pas. Si ce n’est pas malheureux ! » L’égoïsme enfin est éteint ; elle est détachée d’elle-même comme des siens. On lui demande si elle souffre d’être internée parmi les folles. « Cela ne me fait rien. Croyez-vous que ce n’est pas malheureux ! Avoir été comme j’ai été et être aujourd’hui là (3) ! »
Cette insensibilité est singulière. Le sujet n’est pas proprement dénué d’affection, de sentiment ; il est seulement étranger à ses affections, à ses sentiments, il ne les sent plus comme siens ; ou plutôt il est à ses sentiments ce que serait un appareil enregistreur, supposé conscient, à des phénomènes qu’il inscrirait automatiquement il perçoit très exactement telle ou telle émotion, et il sait qu’il la perçoit, mais il n’éprouve plus l’état d’âme qui correspond à cette émotion ; il ressemble à ce personnage de la légende dont on avait dérobé le cœur ; il traverse, sans rien sentir, des périodes [p. 444] de sa vie où il sait qu’en d’autres temps il aurait été heureux ou malheureux ; il perçoit et juge les événements qui lui arrivent, mais il n’en est plus affecté.
Nous avons dit qu’une émotion forte serait le point de départ et la cause de cet état étrange ; elle l’est en effet d’ordinaire, mais non toujours. C’est à un double surmenage « émotionnel et physique » que Revault d’Allonnes attribue la dépression morale d’Alexandrine. Si l’émotion produit la dépersonnalisation, elle n’est donc pas seule à la produire si elle en est la cause, elle n’en est donc pas la cause vraiment spécifique. Il semble même que, dans les cas les plus fréquents, c’est la fatigue ou toute autre cause physique qui produit cette indifférence ou cette impression d’étrangeté du moi en présence de ses émotions.
Il y a plus l’émotion violente, à laquelle on serait tenté d’attribuer toujours une action déprimante, peut aussi avoir, et a, en bien des cas, une action excitante ; au lieu d’abaisser le niveau mental et affectif, parfois elle le relève ; au lieu de produire la dépersonnalisation, parfois elle la fait cesser. Il y a une émotion sthénique qui secoue le malade, l’arrache à son indifférence, rend à ses sentiments éteints la chaleur et la vie. Cette émotion n’a pas besoin d’être agréable (du genre de celles-ci un succès mondain, une demande en mariage, etc.) elle peut être un profond chagrin, un grand danger, un ennui sérieux. Il suffit qu’elle soit réelle et fasse rentrer le sujet dans sa vie réelle, l’arrache à lui-même, à ses obsessions, à ses chimères et à ses rêves, ou plutôt le rende à lui-même, l’éveille de sa torpeur et le ranime. A la mort de son père, Claire, une scrupuleuse, recouvre la santé morale. « J’avais des chagrins réels, dit-elle, mais les chagrins réels sont beaucoup moins pénibles que les reproches imaginaires de ma conscience ; j’étais plus énergique, j’avais plus de volonté ; ce qui m’a étonnée, c’est que jamais je n’ai si bien dormi, calme, sans rêves, sans cauchemars. » « Aussi, ajoute-t-elle, j’ai soif d’émotions, même de souffrances ; encore maintenant, quand une émotion arrive à me secouer, cela me fait remonter mieux que tous les raisonnements. » Lise de même, « quand elle a des enfants malades ou des ennuis sérieux, est mieux pendant plusieurs jours (4) ». Il ne [p.445] manque, à ce qu’il semble, à ces malades pour guérir que l’excitation des émotions fortes. Wo… se montre courageuse dans un naufrage ; mais, dans les situations ordinaires de la vie, un rien la trouble, la démonte. L’émotion forte, à laquelle nous avons attribué l’hébétude affective et la dépersonnalisation, produit donc également l’effet contraire, le relèvement du ton vital et affectif, la reprise de possession de soi et de ses sentiments.
Y-a-t-il là, comme, le prétend P. Janet, une contradiction dont nous devons prendre notre parti, même quand nous serions incapables de la lever ? Nous ne le croyons pas. La vérité est que la personnalisation, comme la dépersonnalisation, a ses espèces et ses degrés. Par l’ébranlement qu’elle cause, l’émotion tout d’un coup fait voir que le moi a perdu, sans qu’il s’en doutât, le pouvoir de percevoir certains états, de s’y adapter, ou mieux d’y prendre part, soit parce que ces états lui imposent un effort trop grand d’attention et de synthèse mentale, soit au contraire parce qu’ils ne lui offrent plus assez d’intérêt pour forcer et retenir son attention. Autrement dit, on éprouve tout d’un coup un désarroi mental en face de situations auxquelles on suffisait autrefois. On se sent alors comme retranché de la vie, à laquelle on assiste désormais indifférent ; on ne vit plus que machinalement ; on s’étonne de vivre, on ne s’intéresse plus à ses propres états, à ses sentiments, à ses actes. La devise de Valentine de Milan : « Rien ne m’est plus, plus ne m’est rien », pourrait être celle de nos malades. « Je n’ai pas de désir, pas de regret, pas d’ambition, dit Al. ; rien n’est mauvais, rien ne me gêne, rien ne me contrarie, rien ne me fait plaisir. » Il y a là une sorte de paralysie psychique. Mais cette paralysie n’est pas aussi complète qu’on pourrait croire. Le sujet, qui est censé ne s’intéresser à rien, s’intéresse, et très fort, à sa maladie ; le même sujet, qui est censé n’avoir plus d’émotion, s’émeut, si j’ose dire, de son indifférence ou absence d’émotion, en souffre, en est troublé. La dépersonnalisation serait donc relative. Elle serait de plus temporaire. En effet, que ces états mêmes, dont le moi est détaché, que ces sentiments, qu’il ne sent plus, se trouvent simplement relevés de ton, et le moi recouvrera le pouvoir de les percevoir comme siens. C’est précisément ce qui arrive sous le coup d’une émotion vive (5). Une telle émotion accuse donc [p. 446] également le commencement et la fin de la dépersonnalisation. Ce n’est pas assez de dire qu’elle accuse, elle produit ces états contraires. Mais elle ne les produit, si je puis dire, que parce qu’elle les accuse. Et voici comment. Le sujet constate, dans un cas donné, qu’il ne réagit plus contre les impressions reçues, qu’il cesse de les éprouver, de se les attribuer ; cet état étrange d’insensibilité et de stupeur, il le généralise, en en prenant conscience ; il se persuade qu’il n’en peut plus sortir, et en effet il n’en sort plus, en raison de cette persuasion même. Ainsi se produit ce qu’on a appelé la paralysie par auto-suggestion, paralysis by ideas. Mais inversement, sous le coup d’une émotion forte, soudaine, qui arrache le sujet à sa préoccupation ordinaire, qui l’empêche de se rappeler qu’il est incapable de sentir et d’agir, il éprouve un sentiment, il accomplit un acte, et le voilà guéri : l’expérience qu’il fait de son pouvoir d’être ému dans un cas donné, lui rend ce pouvoir pour tous les autres cas. C’est ainsi que le fils de Crésus, atteint de « mutisme hystérique », recouvre la parole à la vue de son père en danger de mort. Sans remonter si loin, c’est ainsi que l’aboulique de Billot retrouve dans un accident toute sa volonté.
Mais on peut contester qu’il s’agisse ici de dépersonnalisation proprement dite. Craignons de recourir à l’hypothèse commode de la suggestion et de verser un fait douteux dans le dossier de l’hystérie déjà trop bourré. Tenons-nous-en aux cas de dépersonnalisation authentiques. En voici un qu’on peut déclarer tel, tout romanesque qu’il soit, parce qu’il est décrit en termes d’une netteté saisissante, irrécusable. Kim, après une .grande fatigue, dit Rudyard Kipling, « sentit, sans pouvoir l’exprimer par des paroles, que son âme ne s’engrenait plus à ce qui l’entourait, roue sans rapport avec aucun mécanisme ». On reconnaîtra ici, sans doute possible, un accès de dépersonnalisation. Cet accès, une crise [p. 447] d’émotion y met fin. Kim « se prit à pleurer et sentit, avec un déclanchement presque imperceptible, les roues de son être remboîter à nouveau dans le monde extérieur. Les choses qui un instant auparavant traversaient le globe de ses yeux sans rien signifier reprirent leurs proportions convenables. Les routes étaient faites pour y marcher, les maisons pour y vivre. (Les êtres) étaient tous réels, sur leurs pieds, parfaitement intelligibles. »
La dépersonnalisation, que met ici en fuite une émotion salutaire, existe à l’égard des perceptions. Nous voudrions chercher si le même phénomène ne se produit pas dans l’ordre affectif, à l’égard des sentiments, et s’il ne se produit pas dans les mêmes conditions. Il semble que la crise nerveuse que raconte Stuart Mill, dans ses Mémoires, peut être rattachée à la dépersonnalisation ; le cas serait seulement moins net, en ce qu’il affecte, au lieu de la forme aiguë, la forme chronique. Or il s’agit ici d’une dépersonnalisation proprement affective, dont l’apparition et la fin auraient été marquées par une émotion violente et imprévue, soudaine. La crise débuta ainsi. Je m’étais, dit Stuart Mill, posé cette question : « Supposé que tous les objets que tu poursuis dans la vie soient réalisés sur l’heure, en éprouveras-tu une grande joie, serais-tu bien heureux ? — Non, me répondit nettement une voix intérieure que je ne pouvais réprimer. Je me sentis défaillir ; tout ce qui me soutenait dans la vie s’écroula. » Le philosophe tomba dans un découragement morne, dans une indifférence totale. Sa dépression morale, son ataraxie lui parurent être l’état que Coleridge décrit en ces vers : « Une douleur sans angoisse, vide, sourde, lugubre, une douleur lourde, étouffée, calme, qui ne trouve aucune issue naturelle, aucun soulagement dans les paroles ni dans les sanglots ni dans les larmes. » Ses sentiments, en particulier « son amour de l’humanité », étaient éteints. Ses goûts avaient disparu. Je revins « à mes livres favoris, je les lus sans rien éprouver, ou plutôt avec le même sentiment qu’autrefois, moins le charme ». Pendant cette période d’abattement, qui dura tout l’hiver de 1826 à 1827, Stuart Mill vaqua à ses occupations habituelles, prononça quelques discours, mais cela machinalement ; des événements de cette année « par la suite il ne se rappela presque rien ».
La maladie avait éclaté dans une crise de désespoir ou plutôt de désenchantement absolu et total ; elle se termina par une de ces [p. 448] crises d’attendrissement où tout le cœur se fond. Stuart Mill raconte qu’une scène des Mémoires de Marmontel, lui étant tombée sous les yeux, l’émut jusqu’aux larmes. Il pouvait pleurer, il était sauvé ! Il était donc encore accessible à l’émotion, il était donc capable de reprendre goût à la vie, d’en jouir !
Le rôle de l’émotion est bien mis en lumière dans ce cas si complet et à tous égards si remarquable. C’est l’émotion qui commande toute la maladie, qui préside à sa genèse et à son évolution, qui en dirige le cours. Mais nous n’invoquons pas ici une force mystérieuse, l’émotion en soi, qui aurait la vertu singulière de donner naissance et de mettre fin à la dépersonnalisation. C’est une émotion particulière, ou plutôt un état cénesthésique particulier, qui produit la dépersonnalisation, et une autre émotion, un autre état cénesthésique, qui la détruit. Il n’y a donc pas là de contradiction. On remarquera seulement le rôle capital de l’émotion dans les deux cas.
Nous tenons la dépersonnalisation pour un phénomène essentiellement émotionnel. Elle est un déséquilibre qui généralement se produit sous l’influence de chocs, tantôt violents, tantôt faibles, mais répétés, d’ordre physique et moral (surmenages, accidents, maladies — changements de situation sociale, voyages, dépaysements brusques, soucis et préoccupations de famille, de carrière, etc.). — On est, dans certains cas généralement de brève durée, tenté de la rattacher à des causes insignifiantes, comme un trouble digestif, mais il n’y a que chez les sujets prédisposés, chez les asthéniques, que de telles causes produisent de tels effets. Pour étudier la crise de dépersonnalisation dans les conditions les plus favorables, pour la saisir dans sa simplicité primitive, dans toute sa pureté, il faut écarter, parmi ceux qui l’éprouvent, l’intellectuel ou le dilettante comme Amiel, qui s’intoxique et se grise de son état, et le déprimé sur lequel agit le plus petit ébranlement nerveux, direct ou indirect. Reste alors le sujet aux prises avec l’émotion. Chez lui on peut suivre la genèse de la dépersonnalisation. L’émotion est la création d’un état d’âme qui entre en lutte avec l’état d’âme préexistant et tend à se substituer à lui. Il arrive alors ou que nous acceptons l’état nouveau ou que nous nous refusons à le faire nôtre. C’est dans ce second cas que se produit la dépersonnalisation. Au lieu de réagir par la joie et la douleur [449] contre l’état naissant, nous réagissons par le retrait ou la fuite, nous nous dérobons. La dépersonnalisation n’est donc pas un phénomène purement passif, au moins à l’origine ; une fois instaurée, elle est sans doute un état d’anéantissement ou de mort ; mais elle commence par être un moyen de défense du moi. Devant un choc violent nous nous replions sur nous-mêmes. Instinctivement, à la façon de la certilière ou de ces arthropodes qui, pour échapper à l’ennemi, lui abandonnent quelque membre subitement amputé, nous renions notre personnalité, nous nous en dépouillons comme d’un fardeau dangereux. Nous nous jouons ainsi une sorte de « comédie », car nous ne consentons à mourir que d’une mort provisoire et partielle ; nous sommes prêts à reprendre notre moi lorsque, grâce à l’apaisement produit par une anesthésie passagère, nous nous sentirons de force à affronter de nouveau les tristesses et les heurts de la vie réelle. Nous nous sauvons présentement par une mesure radicale : « cesser d’être pour un certain temps ». En effet il n’est point de dépersonnalisation sans fin. Si un tel état se constituait définitivement, il ressortirait à la folie, il différerait du tout au tout de la crise anesthésique que nous visons ici. Ainsi, pour échapper au vertige que lui cause le choc émotif, le sujet se dérobe et, sentant le monde qui lui échappe, s’immobilise devant la vie qui se meut autour de lui. Il s’enfonce dans cet état, s’abîme dans ses réflexions, dans ses angoisses, s’éteint dans ses sensations. Le monoïdéisme, la rumination incessante du même sentiment annihilent le moi. Le moi d’ailleurs abdique ; il n’a plus le désir ni la force de rattacher à la conscience individuelle des états émotionnels qui le déconcertent par leur violence ou leur nouveauté.
Mais allons plus loin. Ne doit-on pas dire que l’émotion n’est pas seulement la cause de la dépersonnalisation, mais qu’elle la constitue, qu’elle en est le fond ? Nous arrivons ainsi à la seconde question que nous nous étions posée.
II
Il faut d’abord analyser le trouble émotionnel dont s’accompagne la dépersonnalisation. Il consiste, non dans un sentiment proprement dit, mais dans une tonalité affective (Gefühiston, Stimmung). [p. 450] Tous mes sentiments, quels qu’ils soient, ont leur timbre, leur note propre, meum sonant. Si cette note ne résonne plus ou sonne faux, je perds, non la conscience en général, mais la conscience personnelle, j’éprouve le sentiment de dépersonnalisation. Il ne faut pas confondre ce sentiment avec les sentiments (ou autres états de conscience) qui nous le donnent ou à propos desquels il se manifeste ; il ne faut pas non plus le confondre avec le saisissement qu’il cause.
Nous sommes obligés de compliquer ici l’analyse de la dépersonnalisation des réactions auxquelles elle donne lieu, de la supposer constituée et développant toutes les conséquences qu’elle peut avoir, mais qu’elle n’a pas toujours. Nous devons mener de front, malgré la confusion qui en résulte, la description de l’état aigu et celle de la forme chronique. Nous n’avons pas d’autre moyen de distinguer le sentiment de dépersonnalisation des sentiments qui s’y rattachent (8).
La dépersonnalisation affective consiste à ne plus sentir ses sentiments. Il arrive alors aux sujets de réagir contre leur apathie, de courir après les émotions qui leur échappent, de s’acharner à la poursuite de l’une d’elles, jugée particulièrement « excitante », persuadés que, s’ils recouvraient celle-là, ils recouvreraient à la suite toutes les autres, ou bien d’essayer de toutes les émotions l’une après l’autre, comptant que le hasard leur fera rencontrer l’émotion remontante, sthénique, qui leur rendra le sens du réel et le goût de la vie. C’est ainsi que l’un recherche l’excitation génitale, qu’un autre s’adonne à l’alcool, à la morphine, aux poisons, qu’un autre demande des émotions au jeu, que chacun se démène et s’agite à sa façon, mais que tous ou presque tous éprouvent ce besoin caractéristique de « faire des sottises, des excentricités, n’importe quoi d’étrange, qui les sorte de leur engourdissement ». Les malades s’en prennent donc, pour combattre la dépersonnalisation, aux sentiments à propos desquels elle s’exerce et se manifeste ; ils voudraient réveiller ces sentiments. Mais ils ne voient pas qu’il faudrait pour cela réveiller d’abord le pouvoir d’éprouver des [p. 451] sentiments, l’émotivité en général. C’est ce pouvoir, cette émotivité qui, chez eux, semblent précisément éteints ou « engourdis » (benommen, OEsterreich).
C’est donc la perte de l’émotivité qui constitue la dépersonnalisation. En effet, tous les sujets sont atteints d’inhibition affective. M. dit que, pendant ses accès, s’il était atteint dans ses affections les plus chères, il ne se sentirait malheureux que par réflexion. Ka. de même se plaint de la disparition totale de ses sentiments ; il n’y a pas de représentation capable de l’émouvoir, pas même celle des personnes qu’il aime le plus. Parlant de la colère en particulier, il dit : « Je ne la sens que du dehors, dans ses réactions physiologiques ». Ti. est plus explicite encore : « Avenir, passé, mère, science, amour, tout cela est sans tonalité affective, sans aucun sentiment. J’aime ma mère, mais je n’ai pas le sentiment que je l’aime. » On pourrait croire qu’il manque d’imagination. Mais un malheur réel ne le touche pas davantage. A la mort de son père, il n’a point de tristesse ; pas d’autre sentiment que celui du vide, du néant de la vie. Ti. a une indifférence totale et résignée ; il ne souffre pas même de son apathie. Les dépersonnalisés sont d’ailleurs presque tous portés aux conceptions tristes, à l’interprétation pessimiste de la vie. Prau dit expressément que sa maladie se réduit à l’indifférence, qu’il ne lui manque que d’avoir des sentiments. « Que me sert-il de bien faire ce que je fais, si je ne prends aucun intérêt à mon travail et à mes actes ? Intérêt, joie de vivre, voilà ce dont j’ai besoin. Et je ne puis croire que cela puisse revenir (9). » Nous avons rapporté plus haut le cas typique d’Alexandrine, « l’automate lucide » de Revault d’Allonnes. Si la désaffectivation se rencontre ainsi chez tous les malades, ne faut-il pas dire, avec OEsterreich, qu’elle est le caractère essentiel, le fond même de la dépersonnalisation ?
Mais on conteste qu’elle se rencontre chez tous. Bien plus, on constate chez quelques malades, au lieu de l’indifférence, une « émotivité exagérée ». Osons dire qu’il n’y a peut-être point là de contradiction. En effet il faut s’entendre sur les émotions ressenties par les psychasthéniques. On nous dit qu’elles sont : 1° toujours en retard sur les événements, « rétrospectives » ; 2) indéterminées, [p. 452] sans rapport avec les événements, les mêmes dans toutes les circonstances, non appropriées à la circonstance présente, toutes faites, a priori, sorte de cliché affectif, ou bien calquées sur un souvenir émotif toujours le même (ce qu’un sujet, par exemple, appelait pittoresquement son émotion de chien enragé). Ne peut-on pas résumer cela d’un mot ? Ces émotions à côté ou en retard, aussi bien que les « émotions sublimes », extatiques, « où l’on est comme soulevé de terre », élevé au-dessus de soi-même, sont des émotions de tête, fausses, romanesques, par lesquelles les sujets se font illusion à eux-mêmes sur leur sécheresse réelle. On en voit la preuve dans les réflexions de M. Pierre Janet sur le caractère de ces malades, sur leur « besoin d’excitation » ou besoin de suppléer à l’insuffisance de l’émotion réelle par des entraînements voulus, sur leur besoin d’aimer et d’être aimés, de se réchauffer le cœur au contact des natures ardentes (10), de subir la contagion des émotions vraies, en un mot de se dégeler. Joubert a dit cela assez bien en son style précieux : « Je suis frileux ; j’aime qu’il fasse bon et chaud autour de moi ».
Le chapitre où M. Pierre Janet analyse « les sentiments d’incomplétude dans les émotions » chez les psychasténiques pourrait paraître en contradiction avec ce qu’il dit ailleurs de leur « émotivité exagérée », mais ne fait en réalité que confirmer ce que nous disons du caractère romanesque, illusoire de cette émotivité. Le témoignage des malades sur leur défaut de sensibilité est singulièrement net. « Mon existence est incomplète, dit l’un d’eux ; les fonctions, les actes de la vie ordinaire me sont restés, mais, dans chacun d’eux, il me manque quelque chose, à savoir la sensation qui leur est propre et la joie qui leur succède. Chacun de mes sens, chaque partie de moi-même est, pour ainsi dire, séparée de moi, et ne peut plus me donner aucun sentiment (Esquirol). » Chez Lise, chez Pot etc., aucune émotion, quelle qu’elle soit, physique ou morale, n’aboutit. L’émotion génitale, le plaisir de manger, aussi bien que la colère, la douleur, ne sont pas sentis. « Les émotions, dit Claire, s’arrêtent, n’arrivent pas jusqu’à moi ; une chose qui aurait dû m’effrayer, me laisse calme… Au fond tout m’est égal, je ne désire pas guérir, je suis insouciante. » « Tout m’est égal ! » Ce mot, par lequel le sujet [p. 453] traduit son insuffisance émotive, n’est pourtant vrai qu’à moitié. Car il réagit contre cet état, tout au moins il s’en désole. Il aimerait mieux souffrir, éprouver un sentiment quelconque, quel qu’il fût, pourvu qu’il fût net, défini. « J’aimerais tant, dit Claire, pouvoir avoir beaucoup de chagrin. » Gisèle explique cela fort bien : « Inquiétude, tourment constant, c’est là mon grand mal. J’ai peur pour mes sentiments, pour mes actions, j’ai peur pour mes idées, pour mon cerveau dont je ne me sens pas la maîtresse, j’ai peur de lutter, peur de tout, enfin, et au fond je ne sais pas si j’ai peur. » Et elle conclut comme Claire : « Il vaudrait mieux avoir une vraie peur, ce serait moins pénible ».
Inquiétude sans objet défini, agitation dans le vide, émotivité sans émotion vraie, telle est cette étrange maladie, bien connue de tout temps, qui a reçu bien des noms « vapeurs », « vague à l’âme », etc., et qui est la disposition romanesque, la prétention à la sensibilité, qui trahit et révèle le défaut de sensibilité vraie, la poursuite chimérique et vaine de l’émotion réelle par des âmes tièdes, langoureuses et des imaginations surchauffées. Nous relevons ce tour d’esprit romanesque, cette aspiration au sentiment et ce manque de sentiment vrai dans le carnet de jeune fille de Lucile Desmoulins récemment retrouvé et mis au jour : « Quand est-ce donc que j’aimerai ? dit-elle. On dit qu’il faut que tout le monde aime. Est-ce donc quand j’aurai quatre-vingts ans que j’aimerai ? Je suis de marbre. Oh ! la singulière chose que la vie » (11)
Ainsi, la sensibilité romanesque (« émotivité exagérée ») revenant à l’absence de sensibilité, la dépersonnalisation peut toujours être rattachée à une cause unique l’abaissement du ton émotif ou la [p. 454] désaffectivation. Mais nous devons distinguer deux cas celui où, par un effet de constitution organique (asthénie ou psychasthénie), l’émotion est toujours au-dessous du niveau normal et celui où elle tombe accidentellement au-dessous de ce niveau. Dans le premier, nous disons qu’il y a impersonnalisation les émotions « n’arrivent pas jusqu’au moi », elles avortent, demeurent inachevées ; il leur manque ce je ne sais quoi, cette « chaleur », cet élément de vie, sans lequel rien n’est réel ou du moins ne le paraît. De là « le sentiment d’incomplétude » dont parle Janet ; les émotions qu’éprouve le sujet sont pour lui comme si elles n’existaient pas il ne les sent pas vraies, il ne les sent pas siennes. Dans le second cas, les émotions n’ont pas toujours manqué ainsi de chaleur et de vie, n’ont pas toujours échappé au moi ; elles se sont engourdies, éteintes, détachées du moi c’est la dépersonnalisation proprement dite. En d’autres termes, ici la synthèse personnelle, le rattachement des sensations au moi, manque à se former ; là, elle se dissout.
L’impersonnalisation est une forme de tempérament, une disposition constante, un détachement de soi, auquel on s’habitue, qu’on finit par trouver naturel, qu’on ne s’étonne plus d’avoir. Au contraire, la dépersonnalisation est une dépossession brusque et violente de soi et de ses sentiments ; c’est comme si on se survivait ou on assistait à sa mort ; le contraste entre ce qu’on était tout à l’heure et ce qu’on est présentement saisit tout d’un coup par son caractère étrange et cause une angoisse, un véritable effroi. En un mot, tandis que l’impersonnalisation est un état, la dépersonnalisation est une crise. Cette distinction est capitale ; elle établit une ligne de démarcation entre le genre vague dans lequel on englobe tous les psychasthéniques, et l’espèce ou type de dépersonnalisés que nous cherchons à définir.
La crise de dépersonnalisation ne va pas sans un sentiment particulier. Elle est même en partie ‘une crise sentimentale. Nous y distinguerons trois facteurs ou éléments 1° l’émotion qui détermine la crise de dépersonnalisation; 2° l’absence d’émotion, qui marque essentiellement l’état de crise; 3° le sentiment éveillé secondairement en nous par la bizarrerie de cet état et dont nous n’avons guère conscience que rétrospectivement.
L’émotion consécutive à la dépersonnalisation est grande. Le [p. 455] sujet a beau être déprimé, abattu, et incapable de sentir ; il est lucide et la mort de ses sentiments, la perte de son moi le saisit d’étonnement. Sa pensée s’effare.
Transcrivons les notes de M. sur un accès de dépersonnalisation, qui le prit en wagon, dans un voyage de nuit, sous l’influence d’une grande fatigue physique et de graves préoccupations morales.
17 août 19…, 11 h. du soir.
Je suis hors du temps, hors de la vie. Il me semble sortir de moi-même, aller je ne sais où, vers un lieu sans pensée, sans désirs, sans regrets, sans souvenirs. Je ne suis plus qu’un reflet, reflet conscient d’un être fuyant, insaisissable, mais étiqueté, qui est un tel, qui est M. — M., c’est moi ! Il y a donc des choses qui doivent m’attrister, m’émouvoir ! Mais je ne sens rien de nature à m’attrister ni à me causer de la joie. Je fais un effort pour me ressaisir. Je sais, je me démontre qu’il y a famille, amis, occupations qui m’attendent. Que m’importe ! Je ne veux ni vivre ni mourir, je ne sens rien, il n’y a rien.
Je regarde mes mains qui écrivent ceci ! Comme c’est curieux ! Elles s’intéressent donc ? Je me regarde dans la glace du wagon, je me découvre étrange, nouveau. Pour un peu j’aurais peur de cette image que me renvoie la glace, de ce fantôme de mon moi. Il me semble que ma pensée se retire de mon corps et que de ma pensée se retire quelque chose de plus intime encore, et qui est en dehors de ma pensée, qui la contemple et s’en étonne, à savoir la conscience impersonnelle, qui s’étonne elle-même d’exister et regarde tout comme une vaste fantasmagorie.
Au bruit du train qui me berce, une sorte de vertige me prend. Je suis en dehors de tout ! Il me semble être un écho. Ce qui domine, c’est la surprise, la sensation que tout n’a été qu’un rêve, que tout n’en sera qu’un et que l’état présent durera toujours, toujours, sans réveil, sans changement possible.
Si étrange que soit la description de cet état, et quoique reviennent sans cesse les mots : « Il n’y a rien, je ne sens rien », on ne peut s’empêcher, l’interprétant du point de vue de la conscience normale, de supposer que le sujet doit éprouver un malaise intellectuel, voisin de la souffrance. Cependant ce malaise, s’il est réel, est léger, vague et demeure latent ; si on en prend conscience, c’est par réflexion, par raisonnement. Il importe ici de distinguer ce qui se passe pendant la crise et après la crise et d’interpréter exactement le témoignage des sujets. L’insensibilité que ceux-ci [p. 456] s’attribuent est-elle réelle ou n’est-elle qu’une façon de parler ? Nous prétendons qu’elle est réelle. Sans doute, pendant l’accès, le sujet se dit : Si j’étais normal, je souffrirais de ne pouvoir souffrir. Mais en fait il ne souffre pas. Il peut lui arriver ensuite, traduisant ce qu’il éprouve rétrospectivement, et trahi d’ailleurs par le langage, qui se prête mal à rendre des états d’âme exceptionnels, de donner à entendre qu’il a souffert. Il appelle alors effroi, angoisse, etc., un simple sentiment d’étrangeté, d’étonnement, de stupeur. Mais, à part la sensation très nette d’être tel qu’il ne devrait pas être, sa crise est réellement un état de néant sentimental.
Il en doit être ainsi si, comme on l’a dit plus haut, la dépersonnalisation répond à un instinct de défense elle assure le bénéfice de traverser une période de vie douloureuse, sans la sentir. M. n’a plus le sentiment de sa fatigue physique, de ses préoccupations morales. Il s’est allégé de son fardeau ; sa conscience s’est retirée de ce qui le trouble ; elle l’enregistre encore, mais ne le ressent plus.
On goûte une certaine volupté secrète à se sentir ainsi rejeté hors de la vie, quand on n’est plus de force à l’affronter, et on éprouve ensuite une véritable souffrance à y rentrer, à reprendre sa personnalité.
C’est ce qu’a éprouvé M. Vers la fin de sa crise, à une heure environ du matin, il est pris d’une angoisse qui va croissant. « Peut-être, écrit-il, dans cette espèce d’engourdissement de la personnalité où je me trouve, l’importunité des pensées tristes (se rapportant à la réalité) est-elle particulièrement atroce » ; mais, ce qui est certain, c’est que le retour à la vie normale produit la souffrance ; à mesure qu’on reprend conscience de soi, on a plus aigu le sentiment d’une « dissonance » ; et cela « vous rappelle qu’il y a un substratum réel à ce qui semblait être un rêve de la vie ». En d’autres termes, on cesse de goûter le bienfait du rêve qui libérait de la vie, on est rappelé à la réalité et on s’effraie de ce rêve même, qui en dérobait la vue, on est contraint de le tenir lui-même pour réel et, comme tel, pénible.
Ainsi c’est au point de rencontre, si on peut dire, des deux plans de conscience, que nous appellerons la personnalisation et la dépersonnalisation, que se place l’émotion particulière (anxiété, malaise) qui accompagne la dépersonnalisation. Cette émotion n’a rien de [p. 457] commun avec l’obsession de la perte de la personnalité qui se trouve chez un grand nombre d’aliénés. Ceux-ci vivent dans la crainte perpétuelle de ne plus être eux-mêmes, de ne plus rien sentir, de ne plus aimer les leurs ; au reste, ils ne présentent point la crise si nette de dépersonnalisation que nous avons décrite ; mais ils ont l’angoisse dont nos sujets sont exempts. Les dépersonnalisés sont en effet des raisonneurs, mais des raisonneurs que leur raisonnement n’affole jamais. Ils ont une tendance certaine à aimer leurs crises, grâce auxquelles ils échappent pour un instant à la fatigue ou à la douleur de vivre ; et s’il s’en trouve parmi eux qui parlent volontiers de leur inémotivité accidentelle et en font le thème ordinaire, le leit-motiv de leur conversation, il ne faut pas les croire pour cela aux prises avec une hantise obsédante. Cette hantise, si elle se rencontrait, serait la preuve qu’on est en présence, non d’une simple asthénie psychique avec crises de dépersonnalisation, mais d’un cas de mélancolie vraie.
L’angoisse est donc étrangère à la dépersonnalisation proprement dite. La fin de la crise de dépersonnalisation s’accompagne seulement d’un trouble léger, lequel traduit la dissonance entre le moi, amputé des sentiments et des perceptions habituels, apathique, étrange, lointain, et le moi, sur lequel reprennent peu à peu leur empire des sensations normalement interprétées et des émotions normalement ressenties. Mais la dépersonnalisation en elle-même est si peu un état de souffrance, un objet de crainte et d’horreur, qu’au contraire elle a la douceur de l’apaisement complet. Le sentiment qui y répond serait une quiétude attendrie, une résignation douce au néant. C’est ce sentiment qu’Amiel a merveilleusement décrit.
Quel que soit le charme des émotions, je ne sais s’il égale la suavité de ces heures de muet recueillement où l’on entrevoit les douceurs contemplatives du Paradis. Le désir et la crainte, la tristesse et le souci n’existent plus. On se sent exister sous une forme pure, dans le mode le plus éthéré de l’être, savoir la conscience de soi. On se sent d’accord, sans agitation, sans tension quelconque. C’est l’état dominical, peut-être l’état d’outre-tombe de l’âme. C’est le bonheur tel que l’entendent les Orientaux, la félicité des anachorètes qui ne luttent plus, qui ne veulent plus, qui adorent et qui jouissent. On ne sait avec quels mots rendre cette situation morale, car nos langues ne connaissent que les vibrations particulières et localisées de la vie, [p. 458] elles sont impropres à exprimer cette concentration immobile, cette quiétude divine, cet état de l’océan au repos qui reflète le ciel et se possède dans sa profondeur. Les choses se résorbent alors dans leur principe ; les souvenirs multipliés redeviennent le souvenir ; l’âme n’est plus qu’âme et ne se sent plus dans son individualité, dans sa séparation. Elle est quelque chose qui sent la vie universelle, elle est un des points sensibles de Dieu. Elle ne s’approprie plus rien, elle ne sent point de vide. Il n’y a peut-être que les Yoghis et les Soufis qui aient connu profondément cet état d’humble volupté, réunissant les joies de l’être et du non-être, état qui n’est plus ni réflexion ni volonté, qui est au-dessus de l’existence morale et de l’existence individuelle, qui est le retour à l’unité, la rentrée dans le plérôme, la vision de Plotin et de Proclus, l’aspect désirable du Nirvana.
Cette « joie passive », paradoxale et morbide de l’individualité qui se dissout et assiste, consciente, à sa dissolution, peut fort bien se comprendre. Comme on l’a dit déjà, le sujet s’arrache à un état pénible, se met en dehors et jouit de ne plus le sentir, de n’en plus être affecté, tout en gardant la conscience de cet état. Mais on comprend d’ailleurs également bien qu’un sentiment contraire de malaise et d’effroi accompagne la dépersonnalisation c’est alors le caractère original et étrange du phénomène qui est en saillie, et la sensation de l’anormal est toujours pénible en soi.
Telles sont les émotions diverses, mais non contradictoires, qui se trouvent liées à la dépersonnalisation ou mieux qui en sont l’effet. Revenons maintenant sur l’état affectif, qui en serait d’autre part la cause. Cet état, avons-nous dit, serait l’atonie, l’affaiblissement général ou la disparition complète des émotions. On a supposé que c’est parce que les états de conscience, quels qu’ils soient, n’ont plus de résonance affective, sont, du point de vue du sentiment, comme amortis, éteints, qu’ils se détachent du moi et apparaissent alors comme irréels et faux. L’hypothèse est vraisemblable et même séduisante. Nous croyons pourtant qu’elle est finalement à rejeter. L’atonie affective ne nous paraît pas pouvoir expliquer la dépersonnalisation autrement dit, nous ne voyons pas comment elle empêche la conscience personnelle de se former. Remarquons qu’il s’agit de sujets qui ont gardé la conscience et n’ont perdu que la conscience personnelle. Ces sujets se plaignent de ne plus sentir. Ils savent pourtant ce que c’est que sentir et ils le savent, comme on peut le savoir, par expérience personnelle. Nous [p. 459] avons supposé que l’absence d’émotion se trouve jointe à la dépersonnalisation et l’explique. Mais c’est là une vue incomplète ; on n’envisage que l’aspect négatif du phénomène. En réalité tous nos sujets sont des impressionnables ou des émotifs, en ce sens que, chez eux, les oscillations du niveau émotionnel sont à la fois fréquentes et extrêmes. Ils ont des émotions vives, suivies de périodes d’atonie, de sécheresse. C’est dans ces périodes que se placent leurs crises de dépersonnalisation ils ne se retrouvent plus, ils ont perdu leurs sentiments, leur vie et leur raison de vivre. Ils ont le souvenir de leurs émotions passées et ce souvenir forme un contraste violent avec leur sécheresse présente. Ils sont lucides ; ils mesurent toute la distance qu’il y a entre l’émotion vraie, dont ils gardent le souvenir et qu’ils cherchent parfois vainement à retrouver, et l’émotion factice ou l’agitation vide de leur état actuel. A la limite, le contraste est si grand qu’il leur semble être sortis d’eux-mêmes et avoir perdu leur moi ; mais de cette illusion ils ne seront jamais les victimes.
La dépersonnalisation, c’est donc le moi ne se retrouvant plus dans ses propres états, par suite d’un incompréhensible changement qui s’est opéré, soit en eux, soit en lui. Faut-il supposer que ce changement est la perte du sentiment ou simplement la baisse du ton affectif ? Suffit-il que toute émotion ait disparu pour que les autres états psychiques perdent du coup leur coefficient personnel ? L’émotion est-elle à ce point la base du moi ? OEsterreich le croit, mais d’autres le contestent. Pour nous, nous dirons que, s’il fallait choisir entre les états psychiques celui qui est lié le plus intimement au moi et par suite doit être l’élément essentiel de la personnalisation, c’est l’émotion ou l’état affectif que nous désignerions aussi ; mais nous ne croyons pas qu’un tel choix s’impose ni même soit permis. Car, si l’affaiblissement des émotions est la cause de la dépersonnalisation en général, on ne comprend pas comment les émotions affaiblies donnent en même temps matière et prise à la dépersonnalisation, autrement dit comment elles sont à la fois ce sur quoi porte la dépersonnalisation et ce qui la produit, comment elles sont à la fois dépersonnalisantes et dépersonnalisées. Or c’est un fait que les émotions sont, par rapport à la dépersonnalisation, sur le même pied que les autres états psychiques, que les perceptions par exemple ; le sujet assiste à ses états affectifs comme il [p. 40] assiste à ses perceptions, à ses souvenirs ; il y assiste indifférent et s’étonne de les éprouver. Il est retiré de lui-même, de son être affectif aussi bien que du monde extérieur, de ses perceptions. Il se voit sentir, comme il se voit agir, penser, de loin et du dehors. La dépersonnalisation n’est donc pas la perte du sentiment, puisqu’elle joue à l’égard du sentiment lui-même. Les émotions se détachent et s’aliènent du moi ; elles ne forment donc pas, à elles seules, la matière ou la substance du moi. La dépersonnalisation implique la désaffectivation, mais ne s’y réduit pas tout entière. Elle est en dehors et au delà du sentiment. Elle est la rupture du lien qui rattache la conscience personnelle à ses états et par là même elle est la croyance que tout est illusion en nous comme en dehors de nous, la magie du réel dissipée, l’exorcisation du sentiment comme celle des perceptions, l’idée que tout est fantôme, que le moi lui-même est fantôme et que tout ce qu’il éprouve est vain, n’existe pas. La désaffectivation est ce qui nous fait le mieux comprendre la dépersonnalisation ; elle en est l’élément caractéristique et essentiel, le contenu positif ou réel. Nous croyons pourtant qu’elle ne dissipe pas toutes les obscurités. Elle ne fait que nous conduire au seuil du mystère. Pourquoi une certaine forme de sentiment entraîne-t-elle la ruine de notre être et, avec elle, de tout être ? C’est ce que nous constatons sans le comprendre.
- DUGAS et F. MOUTIER.
NOTES
(1) Cf. Ribot. Problèmes de psychologie affective, p. 25. Cette perte du sentiment de la réalité, sous une forme mitigée et transitoire, n’est pas un phénomène rare. Beaucoup la connaissent par expérience. Pour ma part je l’ai subie quelquefois, pendant une heure au moins, sous l’influence d’un mauvais état physique ou d’une dépression mentale. On passe au milieu des hommes et des choses sans regarder, sans entendre, sans retour sur soi-même ou sur sa vie intérieure ; on lit machinalement les pages d’un livre sans rien en garder ; on parcourt de longues salles d’un musée comme un automate; tout est indifférent, rien n’attire, rien n’intéresse, rien ne reste. Ce texte concorde trop bien avec le nôtre pour que nous hésitions au plaisir de le citer. Cependant, il convient de le remarquer, l’état décrit par M. Ribot n’est peut-être pas la dépersonnalisation proprement dite ; celle-ci en effet implique toujours le retour sur soi. Au reste l’auteur nous avertit lui-même que « les termes de dépersonnalisation, perte du sentiment de la réalité, sentiment d’étrangeté ne sont pas complètement synonymes, qu’ils supposent des différences cliniques et même psychologiques ; mais, ajoute-t-il, ils supposent aussi un fond commun sous les variations individuelles ». Cela suffit pour justifier le rapprochement que nous faisons ici. Si ce n’est pas de la dépersonnalisation qu’il s’agit, c’est au moins d’un état très voisin.
(2) Obsessions et Psychasthénie, I, p. 517 et suiv. (F. Alcan).
(3) Revault d’Allonnes, Rôle des sensations internes dans les émotions et dans la perception de la durée, Revue philosophique, déc. 1905.
(4) P. Janet, ouv. cité.
(5) On pourrait encore définir l’émotion une rupture d’équilibre psychique, laquelle se produit sous deux formes ou l’on part de l’état normal (personnalisation) et l’on tombe au-dessous de cet état ; il y alors dépersonnalisation ; ou l’on part de l’état anormal de la dépersonnalisation et l’on est relevé, remonté au ton normal ; il y a alors retour à la personnalisation ou dé-dé-personnalisation.
(6) Billot raconte ainsi le fait : « Notre malle-poste passa par-dessus une femme que les chevaux avaient renversée. Mon malade recouvra toute son énergie et, sans attendre que la voiture fût arrêtée, rejeta son manteau, ouvrit la portière, et se trouva le premier descendu près de cette femme. (Cité par Ribot les Maladies de la volonté, p. 48.)
(7) P. Janet, ouv. cité, p. 386 et suiv. Nous disons presque tous. En effet il en est qui ne réagissent plus, se laissent aller. Exemple Lise qui, très malheureuse, parait admirable de résignation et de sagesse, mais est en réalité tombée dans une indifférence morbide, consent à l’abrutissement du chagrin.
(8) OEsterreich, Ouv. cité
(9) OEsterreich, Ouv. cité.
(10) De là leurs engoûments faciles, leurs béguins ou toquades.
(11) Ces lignes pourront paraître vagues. Mais le contexte les précise et justifie le sens que nous leur donnons. La « charmante Lucite » avait de la dépersonnalisation. Elle écrit dans son journal : « Samedi 26. Je suis comme une personne dont l’esprit est absent. Je ne me comprends pas, je ne sais pas pourquoi je parle, je ne sais ce qui me fait agir, enfin je suis comme une machine. Je ne puis comprendre ce que c’est que mon être. J’ai passé la matinée de même que l’après-midi de vendredi sans pouvoir rien faire, commençant et ne finissant rien… Après le diner, j’ai barboté dans le ruisseau, toujours avec cette même absence d’esprit, et le moment où je suis est encore de même. Lundi J’ai été me promener le soir avec maman. Elle n’a pas resté longtemps; moi, j’ai resté jusqu’à neuf heures du soir. Cette absence d’esprit ne me quitte point. Je n’ose pas en parler parce que je ne puis expliquer ce que je sens ; ne le comprenant pas, on se moquerait de moi (Le Te/~p~ La petite histoire les Confidences de Lucile Desmoulins, T. G. d’après Émile Michel, Camille et Lucile Desmoulins, notes et documents inédits. Amiens, 1908.)

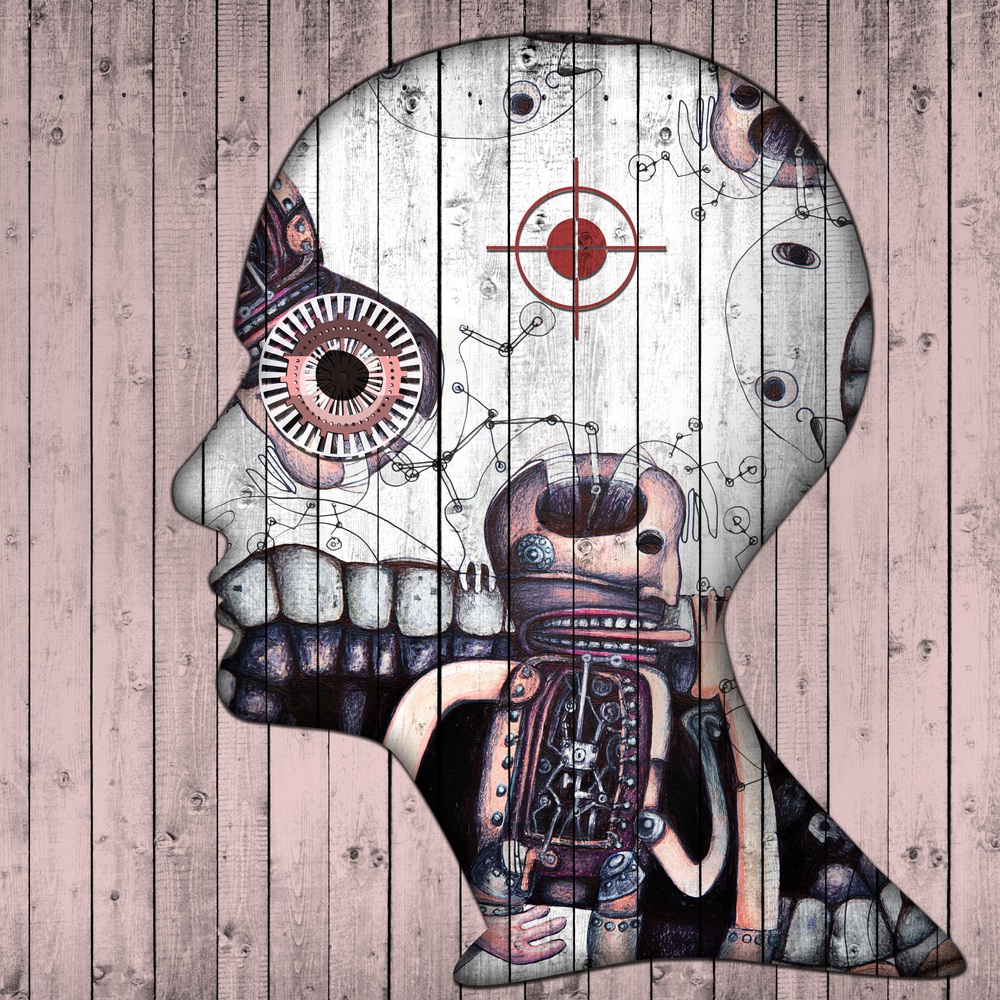

LAISSER UN COMMENTAIRE